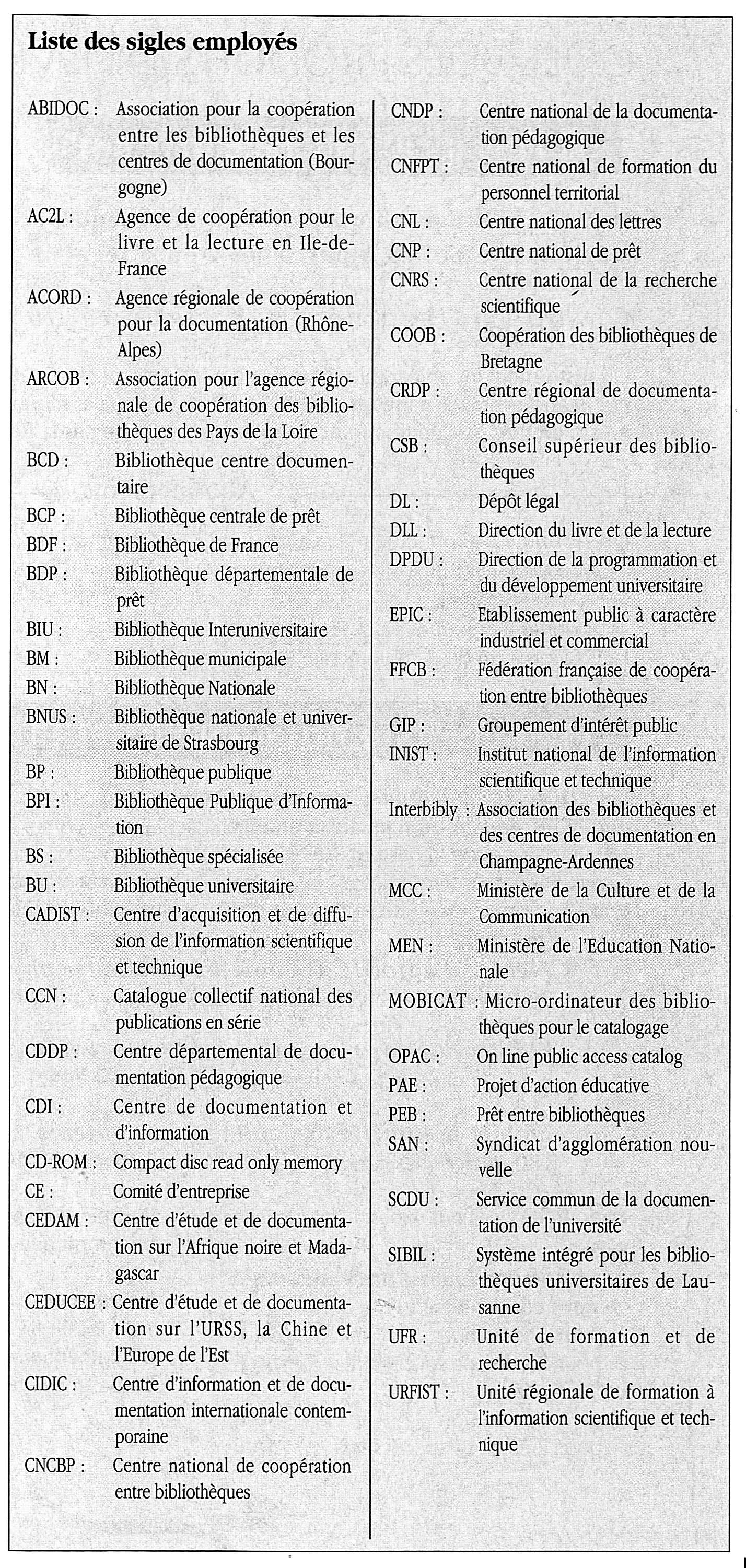Index des revues
- Index des revues
Les travaux de la commission "Etablissements et réseaux"
- la BM et ses annexes ;
- les bibliothèques de la Ville de Paris, y compris les bibliothèques spécialisées, les discothèques ou les bibliothèques pour enfants isolées, le Service technique (livres et phonogrammes) ;
- la BCP et ses annexes (ou points d'appui) ;
- les réseaux départementaux (politique de fonds particuliers départementaux) ;
- la BU et ses sections, voire les bibliothèques d'institut, de département ou de laboratoire ;
- les bibliothèques de CE regroupées en association fonctionnelle (l'ACENER à Nantes, le bibliobus inter-entreprises de Grenoble) ;
- les bibliothèques associatives para-communales (maisons de quartier, centres socio-culturels, etc).
- la bibliothèque publique partenaire de bibliothèques d'autres types :
- BM et Musées (municipaux ou non) : acquisitions réparties, informatisation commune (Saint-Etienne, Mulhouse) ;
- BP et bibliothèques scolaires : dépôts de livres aux BCD (BM) ou aux CDI (BCP).
- la bibliothèque publique partenaire d'autres structures :
- BP et hôpital (relations embryonnaires, difficiles) ;
- BP et prison (se développe) : don ou dépôt de livres, animation, formation ;
- BP et petite enfance : présence du livre dans les crèches, halte-garderies, PMI...
- les relations BP/BU.
- La Bibliothèque Nationale : outre son rôle majeur de production et diffusion de l'information bibliographique, sur lequel nous reviendrons, la BN occupe dans le réseau national un lieu de compétence, de référence et de dernier recours : le Centre National de Prêt, le Service Photo, le Service des Echanges Internationaux, Sablé, Provins, les tarifications, les publications, le conseil technique, l'expertise, etc, sont des activités, des services ou des références utilisé(e)s peu ou prou par toutes les bibliothèques.
- La Bibliothèque Publique d'Information : elle est prestataire de services en matière d'animation culturelle (expositions itinérantes) et de formation continue (stages). Elle est aussi devenue un éditeur très important pour la profession, une vitrine des innovations et un recours en matière d'assistance et de conseils techniques.
- Le Centre National de Coopération des Bibliothèques Publiques : instrument clairement conçu au service de la coopération entre bibliothèques, le CNCBP ne joue pas qu'un rôle de prestataire de services, même si c'est son rôle le plus visible (désinfection, formation continue, animation, vidéothèque de prêt). Il joue de plus un rôle de liaison : circulation de l'information, publications, collecte et mise à disposition de documentation, conseil, promotion des bibliothèques,... Le projet actuel de suppressions de postes au CNCBP nous paraît un danger redoutable pour lui qui, pour tenir toute sa place, a besoin d'un vrai statut, de missions claires et de moyens suffisants.
- les CDI : des réseaux régionaux de catalogage partagé existent en Rhône-Alpes (SIDERAL), en Bourgogne et en Midi-Pyrénées. Mais les logiciels sont différents d'une région à l'autre et l'idée d'un réseau national n'est pas poussée par le Ministère de l'Education Nationale - même si le CNDP propose un langage documentaire commun (MOTBIS). Dans certaines académies (par exemple Créteil), des documentalistes de CDI travaillent par secteurs géographiques sur des projets liés à leur activité professionnelle (voir ci-dessus p. 21)
- les bibliothèques pour tous : le terme de réseau ne doit pas sembler excessif, puisque l'association qui regroupe ces bibliothèques (Culture et Bibliothèques) assure à tout le moins une communauté de vues sur leur rôle, une formation commune et des statistiques globales.
- les bibliothèques d'art : leur spécificité et leur communauté d'intérêts ont incité les bibliothécaires d'art (musées, écoles des Beaux-Arts, etc) à se regrouper au sein d'une sous-section de la section des bibliothèques spécialisées de l'ABF pour réfléchir à des projets communs : catalogue collectif, thésaurus matière, dépouillement des périodiques, microfilmage des périodiques. Mais, d'un point de vue fonctionnel, le réseau n'existe pas encore.
- les bibliothèques musicales : pour les mêmes raisons, les professionnels des bibliothèques musicales sont en train de se regrouper pour étudier des projets communs. Ils se réunissent annuellement en congrès à Niort.
- la coopération régionale : nous reviendrons plus loin sur la coopération institutionnalisée au sein des "structures régionales de coopération".
- la coopération inter-communale : elle est très fréquente quand elle n'est que fonctionnelle : le prêt-inter, la circulation d'expositions, l'achat de catalogues informatisés, l'informatisation commune (par exemple le SIVOM de La Rochelle, qui assure également la desserte par bibliobus)... Mais elle est rare quand il s'agit, à plusieurs communes, de créer ou d'organiser de véritables bibliothèques. Les structures possibles sont au nombre de trois : l'association loi 1901 ( rare, éphémère, fragile) ; les conventions entre communes (cas le plus fréquent, 27 bibliothèques inter-communales sont gérées par convention en Saône-et-Loire) ; les syndicats de communes.
- les associations professionnelles et les organisations syndicales : elles assurent, dans leurs domaines respectifs, défense et promotion de la profession, circulation de l'information, occasions de rencontres et débats, confrontation des pratiques et des expériences, prises de position.
- la formation professionnelle : elle est assurée pour une bonne partie par les professionnels eux-mêmes, de façon plus ou moins institutionnelle : enseignement, accueil de stagiaires, visites de (futurs) professionnels, participation à des séminaires ou des journées d'études, etc.
- le groupe trouve positif le rapport sur le Schéma directeur de l'information bibliographique. L'abandon des pratiques de catalogage partagé pour la mise en place de producteurs et diffuseursnationaux est logique et réaliste ;
- la base bibliographique nationale, selon nous, devrait profiter au maximum des bases existantes, comme on l'a fait pour la mise en place du CCN. Il s'agit là aussi d'être réaliste ;
- selon l'enquête menée par le groupe de travail "Catalogue collectif national" de la Bibliothèque de France, la localisation et l'accès aux documents sont des demandes indissociables de la demande d'information bibliographique. La pertinence et l'urgence de la création de catalogues collectifs sont donc évidentes ;
- l'échelon régional nous semble valable pour les catalogues collectifs. Par contre, pour les bases bibliographiques, nous nous interrogeons sur leur intérêt à cet échelon ;
- le groupe est unanime à souhaiter la même qualité d'information pour tous les publics. Il s'inquiète des projets de fourniture rapide et fourniture lente de l'information, selon deux tarifications ;
- les missions de la Bibliothèque de France en ce domaine et leur articulation avec les missions de la BN et de l'Etablissement public de diffusion de l'information bibliographique gagneraient à être précisées rapidement ;
- les projets de réforme du Dépôt Légal posent deux problèmes : la diminution du nombre d'exemplaires déposés serait très coûteuse en termes économiques (les exemplaires déposés représentaient plus de 109 millions de francs en 1988) et fonctionnels (elle causerait des difficultés probablement mortelles au Centre National de Prêt, voire au Service des Echanges Internationaux) ; l'implication des bibliothèques de province nous semblerait plus judicieuse s'il s'agissait de collecte et de dépôt concernant leur région (documents édités dans leur région, portant sur leur région) et non d'attribution au hasard de l'implantation des imprimeries.
- positivement parce que son impact médiatique a eu et aura des répercussions sur l'image et la "visibilité " de toutes les bibliothèques ;
- positivement parce que la région parisienne souffre de très graves lacunes en matière d'accès à la documentation ;
- positivement encore par l'espoir que les professionnels mettent dans le travail de réflexion et les avancées techniques qu'un projet d'une telle importance ne va pas manquer de susciter ;
- de façon plus nuancée par les questions que la profession (et notre groupe en particulier) se pose sur l'articulation entre la Bibliothèque de France et les bibliothèques, entre la Bibliothèque de France et la Bibliothèque Nationale, entre les pôles associés et le réseau des bibliothèques. La transparence, la cohérence, l'interconnexion entre ces institutions en cours de création et les bibliothèques actuelles nous semblent indispensables pour éviter (ce qui n'est nullement inévitable) la simple juxtaposition de deux réseaux étanches qui auraient leur logique propre.
- les bibliothèques ont besoin d'accéder aux sources bibliographiques, e localiser les documents et de mettre en commun leurs ressources documentaires pour permettre l'accès le plus large possible au patrimoine culturel national ;
- les bibliothèques ont besoin d'échanger informations, savoir-faire et expériences ;
- les bibliothèques ont besoin de travailler en partenariat ou en relais avec d'autres bibliothèques ou avec des services culturels ou éducatifs pour assurer certaines missions de base (accès aux documents, action culturelle) ;
- les bibliothèques ont besoin de se regrouper et de travailler ensemble pour organiser et conduire une politique commune à long terme dans certains domaines (par exemple patrimoine, formation, promotion du livre) ;
- les bibliothèques ont besoin de moyens spécifiques leur permettant de mener à bien des projets d'intérêt collectif.
- l'accès aux ressources bibliographiques et documentaires ;
- les partenariats ;
- la circulation des connaissances ;
- la coopération entre bibliothèques.
- "- des réseaux régionaux disposant de catalogues collectifs et avec une politique de coopération inter-établissements (bibliothèques universitaires plus bibliothèques municipales principalement) ;
- un réseau national plus ciblé sur les collections intéressant la recherche"
- la coopération en matière documentaire relève de l'organisation de la carte documentaire sur l'ensemble du territoire, et sur les responsabilités qui seront assignées, on peut l'imaginer, à des pôles d'excellence, des centres de recours et des centres primaires ; un véritable aménagement du territoire documentaire nous apparaît nécessaire ;
- les structures régionales de coopération sont fragilisées par leur statut associatif et l'insuffisante pluralité de leur financement ; leur avenir devrait être assuré par une obligation de financement pour les Régions ainsi qu'une participation de l'Etat et des autres partenaires de la coopération ;
- des services spécifiques nationaux font cruellement défaut. Un grand service technique financé par plusieurs sources et chargé, outre certaines prestations de service, des missions de conseil, d'assistance, d'information et de recherche est une des hypothèses envisageables ; une autre hypothèse est la création de plusieurs services techniques spécialisés et autonomes ; enfin, une troisième hypothèse, le développement de services intégrés à des bibliothèques et chargés d'une mission de coopération a, dans le passé et à plusieurs reprises, prouvé son inefficacité structurelle ;
- la cohérence de cette organisation et l'évaluation des activités de coopération doivent être placées sous la responsabilité du Conseil Supérieur des Bibliothèques.
- l'Etat : veille, notamment avec le concours de l'Inspection Générale des Bibliothèques, à l'égalité d'accès au service public de la lecture et de la documentation et prend des mesures incitatives ; assure la production et la diffusion de l'information bibliographique nationale ; crée et finance, éventuellement avec d'autres partenaires, un ou des services techniques nationaux de coopération ; en région, il participe au financement des services de coopération et s'appuie sur les conseillers techniques régionaux pour le livre et la lecture.
- le Conseil Supérieur des Bibliothèques : évalue l'activité du réseau documentaire ; encourage la coordination et la cohérence de ce réseau ; émet des avis et des recommandations sur les objectifs et les priorités d'action ; veille à l'application de la loi sur les bibliothèques ; sa compétence s'exerçant sur tout organisme documentaire, il convient qu'il soit rattaché aux services du Premier Ministre.
- les autorités de tutelle : collectivités publiques (Universités et autres établissements publics, collectivités territoriales) ou organismes privés, elles ont la responsabilité du fonctionnement et du développement de leur bibliothèque ou service documentaire ; elles veillent notamment à la cohérence de leurs objectifs avec ceux du réseau national, elles encouragent la création d'un réseau local et régional et assurent à leurs établissements les moyens d'une véritable coopération entre bibliothèques, par leur participation souhaitable au financement des services techniques nationaux et régionaux.
- les Régions : collectivités territoriales n'ayant pas la tutelle de bibliothèques, les Régions participent au service public de la lecture et de la documentation en finançant avec d'autres partenaires des structures de coopération, chargées d'organiser et animer la coopération entre bibliothèques au niveau régional.
- Les associations professionnelles : sont et doivent être plus que jamais lieu de rencontres, de réflexion et de propositions sur l'avenir de la lecture et de la documentation, des établissements et de la profession.
- - d'un maillage dense d'équipements de base ou spécialisés qui aient les moyens d'assurer un service de qualité ;
- d'une cohérence des ressources documentaires ;
- d'une communication entre les établissements, et des moyens techniques de cette communication ;
- d'une définition des responsabilités entre les partenaires de ce réseau, cette définition devant être validée par un texte législatif ;
- d'une évaluation sérieuse permettant d'encourager et d'améliorer la cohérence du réseau ;
- d'un développement des outils de la coopération.
- la loi sur les bibliothèques : elle est le seul texte qui puisse légitimer et organiser le réseau ;
- le Conseil Supérieur des Bibliothèques : développement de son rôle d'évaluation, de recherche, d'encouragement à la cohérence et à la coopération ; rattachement aux services du Premier Ministre ;
- le plan bibliographique : définition urgente des missions de la Bibliothèque de France et de l'articulation entre la Bibliothèque de France, la Bibliothèque Nationale et l'Etablissement Public diffuseur de l'information bibliographique ; moyens dégagés pour la re-saisie (voire le catalogage) des grands catalogues ; actions en faveur de la normalisation bibliographique ;
- la réforme du Dépôt légal : maintien du Dépôt légal éditeur centralisé, du nombre des exemplaires déposés et du Dépôt légal imprimeur ; intérêt pour l'éventualité d'un Dépôt régional ;
- le plan documentaire : élaboration d'un véritable catalogue collectif national ; développement du Centre national de prêt et organisation du prêt entre bibliothèques des ouvrages ; définition des domaines d'intervention quand il y a multi partenariat possible; précision des modes de co-financement pour des prestations de service à d'autres collectivités ; légalisation de la desserte des petites communes par les BCP
- la circulation de l'information : nécessité de développer l'édition et la presse professionnelles, ainsi que les moyens d'information rapide ;
- les structures régionales de coopération : financement par les Régions et les autres partenaires de la coopération ;
- le(s) service(s) technique(s) de coopération : outils indispensables en matière d'études et de recherche, diffusion des normes et prescriptions techniques et bibliographiques, diffusion de l'information, conseil et assistance, prestation de service(s) public(s), financé(s) par les partenaires de la coopération, sous la forme par exemple d'établissement(s) public(s).
- Françoise Belet, Bibliothèque de l'ENSMIC et membre du bureau de la FADBEN Eliane Bourguignat, Centre National de Coopération des Bibliothèques Publiques
- Béatrix de Buffevent, Bibliothèque Administrative de la Ville de Paris
- Pierre-Yves Duchemin, Département des cartes et plans de la BN
- Thierry Giappiconi, BM de Fresnes
- Joëlle Gosselin, BU de Paris I
- Didier Guilbaud, BM de Dunkerque
- Monique Lambert, Bibliothèque du Musée des Arts et Traditions Populaires
- Christian Pierdet, BU de Besançon, puis conseiller technique régional en Bourgogne
- Albert Poirot, BM de Dijon
- Nicole Simon, Département des entrées étrangères de la BN
- Louis Yvert, Inspecteur Général des Bibliothèques
Les travaux de la commission "Etablissements et réseaux"
Par Anne-Marie Bertrand, Présidente du groupe établissements et réseauxIntroduction
Au mois de juillet 1989, le bureau national de l'ABF décida la création de trois commissions thématiques dont une "Commission de réflexion sur les missions et le réseau".
Cette commission, qui se rebaptisa "Groupe de travail Etablissements et réseau", se réunit 13 fois entre septembre 1989 et juin 1990. Elle comptait des membres représentatifs d'un grand nombre de types de bibliothèques ou de services : Bibliothèque Nationale, Bibliothèque de France, Bibliothèques municipales, Bibliothèques centrales de prêt, Bibliothèques universitaires, Bibliothèques spécialisées, Centre de Documentation et d'Information, Inspection Générale des Bibliothèques, CNCBP. Cette pluralité sembla enrichissante à tous les participants et nous permit, je crois, d'appréhender ce problème le plus globalement possible.
Malgré le changement d'appellation, et les voies tortueuses que prirent parfois nos travaux, on peut reconnaître que la mission qui nous était impartie a été pour une grande part remplie : ce document, "Pour un réseau des bibliothèques", comprend en effet un appel à l'organisation du réseau, des propositions en ce sens, une tentative de définition des responsabilités et une réflexion sur le Conseil Supérieur des Bibliothèques.
La première partie du texte, "Etat des lieux : analyse et réflexions", étudie les bibliothèques et les organismes documentaires en tant qu'éléments d'un ou plusieurs réseaux. Notre conclusion, à l'issue de cette première phase, fut que le problème consistait non pas à créer un réseau, puisqu'il existe déjà quoique sous une forme multiple, mais à organiser et rendre cohérents tous ces réseaux ou micro-réseaux que nous avions identifiés.
La deuxième partie de notre travail consista à dresser un "Tableau des activités et des ressources", étape qui était nécessaire pour avancer dans l'étude des responsabilités des établissements et dans la connaissance des partenariats et des activités menées en commun par les bibliothèques.
Enfin, la troisième phase, qui fait donc l'objet de la deuxième partie Travailler en réseau : propositions", fut abordée sous un angle prospectif et constructif. Elle nous permit de mettre en avant trois besoins majeurs : la nécessité d'une loi sur les bibliothèques (ou plus exactement sur le service public de la lecture et de la documentation) qui seule peut valider le partage des responsabilités entre les différents partenaire; la nécessité d'une organisation du réseau, pour laquelle le Conseil Supérieur des Bibliothèques a un rôle éminent à jouer ; la nécessité d'outils et de structures travaillant au bénéfice de ce réseau.
Ce travail, nous l'espérons, pourra être de quelque utilité dans la réflexion de fond que la profession, les pouvoirs publics et les différentes collectivités concernées ont à mener en ce domaine (1) .
L'état des lieux ( Analyse et réflexions)
Le groupe de travail a décidé de commencer ses travaux par une tentative d'établissement d'état des lieux. L'exhaustivité ayant été dès le départ considérée comme inaccessible, cette phase a eu deux axes : un recensement des expériences marquantes ou novatrices en matière de réseau ; un essai d'analyse.
Au cours de cette première période, le groupe a entendu plusieurs interventions extérieures : Jean-François Girardot pour l'INIST ; Catherine Schmitt pour les bibliothèques d'art ; Jacques Bourgain pour le groupe de travail "Catalogue collectif national" de la Bibliothèque de France. Nous avons principalement bénéficié des expériences connues et des informations recueillies par les membres du groupe, en regrettant de n'avoir pu nous appuyer sur des éléments chiffrés ou statistiques récents, dont les administrations centrales ne sont pas prodigues.
La synthèse présentée ici est plus la traduction que la transcription des travaux du groupe. Elle reprend d'abord l'analyse des expériences, puis elle insiste sur trois points qui ont paru importants : l'information bibliographique, les structures régionales de coopération et la Bibliothèque de France.
Elle a été validée par le groupe lors de sa séance du 13 mars 1990.
Sous la pression de l'actualité, le groupe a également élaboré un texte de propositions sur les missions et la composition du Conseil Supérieur des Bibliothèques (texte adopté par le bureau de l'ABF le 24 octobre 1989).
1. Les "Sans-réseau"
Il n'existe probablement qu'un très petit nombre de bibliothèques ou de centres de documentation qui soit complètement isolé, sans aucun lien avec la profession et pour qui la notion de réseau n'ait aucune traduction concrète.
Cependant, il est un nombre probablement assez important d'établissements pour lesquels ces liens ou cette approche du réseau ne passent que par la lecture d'un bulletin de liaison ou d'une revue professionnelle.
C'est le cas des petites bibliothèques municipales isolées ; des BCD qui travaillent seules ; de la plupart des CDI ; d'un certain nombre de bibliothèques spécialisées ; de la plupart des bibliothèques de comités d'entreprise et d'hôpitaux.
2. Les réseaux locaux.
Il s'agit de réseaux homogènes ou hétérogènes sur une circonscription de base (commune ou département).
2.1 Les réseaux homogènes :
2.2 Les réseaux hétérogènes :
Une étude exhaustive de ces relations serait évidemment nécessaire. En son absence, nous avons relevé un certain nombre d'exemples.
Les relations entre les collectivités apparaissent dans des documents contractuels (contrats de plan Etat-Région, par exemple en Pays de Loire, conventions Université-Ville, par exemple entre l'Université d'Aix-Marseille III et la Ville d'Arles), ou bien ne sont pas encore formalisées. La demande est grande de la part des collectivités (Régions, Villes, mais aussi d'au moins deux départements - la Charente et les Alpes-Maritimes) dans un souci de développement économique et intellectuel.
Les relations peuvent prendre la forme d'une informatisation commune (choix commun d'un logiciel, catalogue unique) comme à Saint-Etienne. Elles se manifestent aussi de plus en plus fréquemment par des cofinancements des collectivités territoriales aux constructions de bâtiments universitaires, dont des BU : à Saint-Etienne, les nouveaux locaux de la BU médecine ont été largement financés par la Ville ; à Angers, l'extension de l'Université (dont la nouvelle BU) a été co-financée par l'Etat, la Région, le département de Maine-et-Loire et le district urbain d'Angers. Enfin, dans les Alpes-Maritimes, le Conseil Général, lui-même aidé par le Conseil Régional, subventionne très fortement l'informatisation de la BU de Nice.
La délocalisation des universités peut être l'occasion de mise à disposition de locaux, de personnel et/ou de collections : à Dunkerque, les locaux de la bibliothèque de l'antenne universitaire ont été pris en charge par la Communauté Urbaine, la Ville prenant en charge le personnel (un emploi) et des livres, l'Université complétant les collections documentaires ; à Arras, une partie des fonds de la BM a servi à créer ceux de la BU ; à Arles, la Ville prend en charge l'aménagement d'une salle de lecture, l'acquisition des documents et le paiement du personnel ; à Cambrai, les crédits d'acquisitions de la BM ont été augmentés en vue de l'achat de documents universitaires.
3. Les réseaux verticaux.
Nous regroupons sous ce terme les relations de deux types : celles qui lient, à sens unique, des établissements à un autre, plus important, qui joue le rôle de prestataire de services ; celles qui lient, dans les deux sens, des établissements à celui qui, coordinateur, peut être considéré comme tête de réseau. Certains cas de figure présentent une version hybride de ces deux schémas de relations.
3.1 Le schéma vertical avec prestataire de services
Dans certains cas, la prestation de service étant tarifée et la logique commerciale, on peut difficilement parler de réseau : c'est l'exemple de la fourniture de documents par l'INIST, dont de plus en plus de clients sont d'ailleurs des industriels.
Dans d'autres cas, il s'agit d'une structure qui, parmi ses missions et de façon assez marginale, propose des services à titre gratuit ou onéreux : la DLL (exposition "Sous la main de la Nation", vidéodisque "Bibliothèques publiques de France", brochures...), le CNL (documentation "Les Belles étrangères", expositions), la Villette (exposition "Les Savants et la Révolution").
Enfin, les CADIST sont un exemple de structure dont la mission est de prestation de services, volontairement créée au bénéfice du public des autres bibliothèques.
3.2 Le schéma vertical avec tête de réseau
Les BCP et leurs bibliothèques-relais : travaillant au service du même public, il s'agit d'un réseau dont la tête joue, par certains côtés, le rôle de prestataire de services, voire de coopérative (centrale d'achat de livres, atelier de réparation, animation et expositions itinérantes). La différence de nature entre ce type d'organisation et les CADIST, par exemple, vient du fait que les missions de tous les éléments de ce réseau sont identiques, même si bien entendu les responsabilités de la tête de réseau sont plus grandes.
Ce réseau regroupe couramment trois types d'établissement : BCP (et annexes), BM et bibliothèques associatives. L'organisation peut en être plus ou moins pyramidale (Drôme), et comprendre ou non des structures mixtes (points d'appui). La plupart comportent des bibliobus.
3.3 Le schéma mixte
Trois établissements, à des titres divers, peuvent être considérés à la fois comme des prestataires de services et des têtes de réseau : la BN, la BPI et le CNCBP. Ce qui signifie que, si l'on ne peut dire qu'il y a un réseau BN, un réseau BPI ou un réseau CNCBP, on ne peut pas non plus réduire les relations entre ces trois établissements et les bibliothèques à des relations désincarnées de prestataires à clients : entrent en jeu des relations personnelles et professionnelles où interfèrent l'évaluation des compétences et des besoins, les attentes ou les insatisfactions, le prestige et la déception. Bref, si l'on peut parler de réseau, c'est aussi en termes de réseau d'influence qu'il faudrait s'exprimer.
4. Les réseaux transversaux
Dans cette rubrique, on trouve des structures traditionnelles comme des structures nouvelles :
La structure générique "syndicat de communes " regroupe trois cas de figure : le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique - SIVU (aucun cas connu pour les bibliothèques) ; le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple - SIVOM (plusieurs gèrent des bibliothèques : les SIVOM de la vallée de la Weiss dans le Haut-Rhin, de Charlieu dans la Loire, de Gendrey dans le Jura) ; le district (seul cas connu : Montrevel dans l'Ain). Aucune communauté urbaine ne semble gérer de bibliothèques. Quant aux SAN des villes nouvelles, il s'agit d'un autre cadre juridique.
Le problème posé par ces structures est celui de leur pérennité. L'implication d'un organisme fédérateur (Conseil Général ou charte inter-communale) est indispensable - mais éphémère ? Et comment travailler durablement ensemble sans que la clarté dans les financements soit assurée ?
Au demeurant, l'avenir de ces structures est tributaire des actuels projets de réorganisation administrative et électorale (regroupement de communes, relance des communautés urbaines, modification du mode d'élection des conseillers généraux).
Le cas de l'agglomération est différent : la collaboration entre la ville-centre et les communes suburbaines est très rarement institutionnalisée et, quand elle existe, porte sur des accords fonctionnels (rattachement au réseau informatique, desserte par bibliobus, tarification particulière aux ressortissants) et non sur l'organisation d'un réseau commun de bibliothèques. Il semble, par ailleurs, que dans un certain nombre de cas, la coopération s'envisage entre communes de l'agglomération, sans la ville-centre.
5. Les réseaux "professionnels"
Il ne nous semble pas déplacé ni inutile de mentionner ici ces réseaux invisibles ou souterrains que forment les relations entre les professionnels des bibliothèques :
Nous ne mentionnerons que pour mémoire les pratiques confraternelles courantes (prêt de matériel, participation à des jurys de recrutement, animations communes, etc).
6. L'information bibliographique
Dans ce domaine, notre réflexion a été gravement obérée par le manque d'informations sur les projets et les missions de la Bibliothèque de France.
Synthétiquement, notre position est la suivante sur les dossiers et projets en cours, indépendamment des propositions que le groupe sera amené à faire dans une deuxième phase :
7. Les structures régionales de coopération
Avec l'approche de la décentralisation, la nécessité de créer des outils de coopération entre bibliothèques devint plus criante. Il avait alors été envisagé de doter, en s'inspirant de l'hypothèse évoquée dans le rapport Desgraves, les régions d'établissements publics destinés à répondre à ce besoin. Mais les moyens ont manqué et ce sont des associations qui ont été créées à l'instigation de l'Etat.
Cela explique les fragilités que connaissent les structures régionales de coopération : fragilités en termes de légitimité, en termes de statut, en termes de missions.
Actuellement, les "structures régionales de coopération" assurent des fonctions diverses : gestion d'une base bibliographique régionale (ACORD et AC2L) ; formation (presque toutes) ; action culturelle (presque toutes : expositions itinérantes, participation aux salons et festivals, soutien à l'édition régionale, promotion des bibliothèques) ; création et gestion d'un atelier de microfilmage (ARCOB et Interbibly) ; conservation répartie des périodiques (ABIDOC et ARCOB) ; acquisitions locales partagées (ABIDOC) ; acquisition de droits de diffusion de vidéos régionales (ACORD et COBB) ;circulation de l'information (presque toutes) ; etc.
Au-delà ou en-deçà de l'échelon régional, nous avons noté trois expériences : le projet CIRCE (Centre Inter-Régional de Conservation de l'Ecrit), projet commun à la Bourgogne et la Franche-Comté pour créer un atelier de microfilmage et de restauration mais qui se heurte à des problèmes difficiles de financements interrégionaux ; le centre de documentation et d'information sur la littérature de jeunesse créé par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis et la ville de Bobigny ; l'expérience du département de l'Oise où les bibliothèques ont organisé la conservation répartie des ouvrages.
8. La Bibliothèque de France
Il est évidemment paradoxal d'inclure le projet de Bibliothèque de France dans un "état des lieux", mais les enjeux sont tels que nous prenons le risque de ce paradoxe. En effet, de par sa seule existence, ce projet pèse déjà lourdement sur les bibliothèques françaises :
Notre groupe est très attentif au risque de voir s'instituer un réseau à deux vitesses. Il affirme, après d'autres, que la Bibliothèque de France ne se développera harmonieusement que si l'ensemble du réseau des bibliothèques se développe avec elle.
9. Conclusions
Le réseau des bibliothèques n'existe pas, mais des réseaux existent : microréseaux, mini-réseaux, grands réseaux, réseaux documentaires ou fonctionnels, verticaux ou transversaux, homogènes ou hétérogènes, réflexifs ou à sens unique, etc.
La question, nous semble-t-il, n'est donc pas de créer un réseau, mais de l'organiser en rendant cohérents tous ces réseaux. Ce devrait être la tâche du Conseil Supérieur des Bibliothèques de proposer les grandes lignes de cette organisation.
Pour notre part, nous pensons que cette cohérence doit s'appuyer sur un travail d'analyse des fonctions des bibliothèques et de définition des responsabilités des différentes collectivités publiques ou privées, ainsi que des responsabilités de l'Etat. C'est l'objet de la deuxième phase de nos travaux.
Mais auparavant, en conclusion de cette première phase, nous tenons à réaffirmer que le réseau (ou l'organisation des réseaux) ne pourra voir le jour que s'il peut s'appuyer sur la loi : pas de loi, pas de réseau.
Travailler en réseau : propositions
Pour remplir leurs missions, les bibliothèques bénéficient de leurs moyens et ressources propres mais l'explosion documentaire, le poids du patrimoine, la diversité des publics, le coût des innovations techniques rendent l'autonomie impossible. Donc :
Nous identifions ainsi quatre modes de travail en réseau :
1. L'accès aux ressources bibliographiques et documentaires
1.1. L'information bibliographique
est définie comme "tout ce qui est créé ou utilisé dans une bibliothèque en matière de descriptif normalisé de support documentaire".
Dans ce domaine, les bibliothèques sont d'abord demanderesses de notices bibliographiques et cherchent à éviter autant que possible le catalogage original, les solutions étant les réservoirs de notices et/ou le catalogage partagé, la seconde solution ne devant être qu'un pis-aller. Le paysage est actuellement contrasté selon que l'on considère les ouvrages récents ou anciens, les ouvrages français ou étrangers.
Production française courante.
Pour la production française courante, la Bibliothèque nationale a vocation à élaborer la totalité des notices bibliographiques des ouvrages et documents (audiovisuels, multimédias...) parus en France, pour la communauté des bibliothèques françaises. Ces notices sont maintenant disponibles sur des bases informatisées, BN-OPALE pour les livres et les périodiques, OPALINE pour les autres médias, et un CD-ROM (actuellement pour les livres seulement), qui peuvent servir de sources de notices pour toute bibliothèque informatisée avec un système compatible.
Pour la diffusion de ces bases, le Schéma directeur de l'information bibliographique du Ministère de la Culture a bien souligné que c'était une mission de service public à assurer par l'Etat. La rapidité et la qualité de production incombant à la Bibliothèque nationale, les moyens adéquats doivent lui être donnés.
Un partenariat indispensable, qui existe de manière expérimentale avec la Bibliothèque Municipale de Rennes (gestion croisée informatisée du Dépôt légal éditeur et du Dépôt légal imprimeur), doit se développer avec les bibliothèques recevant le Dépôt légal imprimeur et améliorer l'exhaustivité du Dépôt légal éditeur.
La réforme en cours du Dépôt légal ne doit pas remettre en cause ce partenariat ni le Dépôt légal imprimeur.
Rétrospectif
Pour le rétrospectif, la constitution de grands réservoirs de notices est indispensable, la re-saisie de catalogues importants comme ceux de la BN dans le cadre du projet de Bibliothèque de France, avec six millions de notices (livres et périodiques) prévues dans la première phase, en sera un élément. Mais là aussi, l'apport des catalogues anciens de nombreuses bibliothèques municipales, universitaires, spécialisées est nécessaire. Cela implique des moyens humains et financiers considérables pour le catalogage et la saisie des données : un partenariat doit sur ce point exister entre l'Etat et les collectivités locales, avec l'apport éventuel de ressources privées (mécénat).
Documents étrangers courants
En ce qui concerne les notices informatisées de documents étrangers courants, le travail est fait, pour certaines bibliothèques universitaires, dans un cadre qui conjugue catalogage partagé et récupération de notices (à partir de SIBIL, OCLC, BN-OPALE). Bien que les solutions locales à base de CD-ROM soient certainement appelées à se développer, il est nécessaire qu'il y ait comme pour les notices françaises un réservoir centralisé de notices étrangères, sur serveur, dont l'utilisation sur une grande échelle par les bibliothèques françaises aboutirait à une économie sur les coûts de catalogage. Voir là aussi les conclusions du Schéma directeur de l'information bibliographique du Ministère de la Culture.
Normalisation
Un partage et une récupération de l'information bibliographique ne sont possibles que grâce, entre autres, au respect de la normalisation à tous les échelons (catalogage, format d'échange, indexation) par l'ensemble des partenaires - ceci est valable aussi pour la conversion rétrospective. Il faut souligner en particulier la nécessité d'obtenir la cohérence des points d'accès en utilisant les fichiers d'autorité nationaux.
Des actions spécifiques (formation, information, incitations) doivent continuer à être entreprises et c'est là une responsabilité de l'Etat.
1.2. L'accès au document
Alors que l'accès à l'information bibliographique s'est amélioré en France, l'accès au document primaire livre est toujours aussi catastrophique, en raison de l'absence d'un catalogue collectif national des fonds documentaires, qui entraîne le fonctionnement insatisfaisant du prêt entre bibliothèques. Rappelons que le catalogue collectif est un outil d'identification et de localisation, et la localisation n'a de sens que s'il y a mise à disposition.
Le catalogue collectif national des fonds documentaires
Certes le CCN existe pour les périodiques, et son succès montre à quel point l'absence d'un semblable outil pour les monographies est une situation intolérable. Des pays européens voisins comme les Pays-Bas et la Belgique ont dépassé la France en ce domaine.
Il faut donc que réussisse rapidement la mission confiée à la Bibliothèque de France de mettre en place un catalogue collectif national des fonds documentaires en tenant compte des réalisations et projets en cours, et des besoins des divers publics. Un groupe de travail a été constitué en octobre 1989 et l'étude commandée pour le schéma d'élaboration de ce catalogue collectif a donné lieu à un rapport analysant l'existant, et à une proposition de scénarios de réalisation.
En reprenant les termes des recommandations du rapport de la phase I, il doit y avoir"une réelle volonté politique commune nationale", "le catalogue collectif doit être pensé comme un objectif national commun et non comme la propriété d'une instance ministérielle particulière". Ce doit être "un système d'information qui inclut à la fois le noyau des bibliothèques participant au catalogue collectif proprement dit, un répertoire des bibliothèques, le tout étant accessible à travers une fonction d'accueil qui permet le reroutage vers des catalogues informatisés locaux, des bases de données bibliographiques, voire d'autres services", non seulement répertoire de documents, mais aussi de fonds documentaires.
La carte documentaire nationale et les réseaux régionaux
Le catalogue collectif national des fonds documentaires ne pourra reposer que sur une offre diversifiée des ressources documentaires, à la fois quant à la nature des fonds et quant à leur localisation. L'une des propositions du groupe de travail sur la politique documentaire de la Bibliothèque de France est pertinente et devrait être suivie d'effet; elle préconise un double maillage :
Au niveau national, il faut préconiser une coordination des ressources documentaires des principaux établissements du niveau recherche : BN/BDF, BU-BIU , CNRS (INIST...), bibliothèques spécialisées, grandes bibliothèques municipales...
Au niveau local et régional, des catalogues collectifs régionaux devraient répondre à la première demande et valoriser les ressources locales. L'initiative locale est indispensable, mais en même temps insuffisante . cette réalisation appelle des financements aussi de l'Etat.
Le catalogue collectif national ne peut donc, à notre sens, être compris que comme l'addition de ces deux ensembles : le catalogue national recherche et les catalogues régionaux, ces deux aspects du projet national devant bénéficier du même intérêt et des mêmes moyens, et les coûts d'accès à l'un ou à l'autre ne devant pas être différents. Sinon, le gaspillage et l'incohérence régnant actuellement perdureront.
Le prêt inter-bibliothèque
Tel qu'il fonctionne actuellement, le prêt entre bibliothèques pour les ouvrages a des résultats fort aléatoires. Son organisation véritable doit se faire dans la foulée, et même dans le cadre du catalogue collectif national des fonds documentaires afin d'offrir le service le plus efficient à l'utilisateur final à un coût raisonnable.
Dans ce paysage, le sort de l'actuel "Centre national de prêt" devrait être abordé. Sa situation dans le cadre du projet de Bibliothèque de France semble incertaine. Or le CNP est constitué systématiquement depuis 1980 à partir d'un exemplaire du Dépôt légal éditeur. Il devrait être la source privilégiée pour le prêt d'ouvrages français ; il pourrait recevoir aussi par exemple des dons de particuliers ou de bibliothèques, pour les ouvrages français anciens qui lui manqueraient. De toute façon, il est indispensable que la Bibliothèque de France et les partenaires actuels du CNP participent à la définition de son avenir.
2. Les partenariats
2.1 Les partenariats entre bibliothèques
La Bibliothèque Nationale travaille d'une part avec les 19 bibliothèques qui reçoivent un exemplaire du Dépôt légal imprimeur, d'autre part avec les quelques bibliothèques attributaires d'un exemplaire du Dépôt légal éditeur (Dijon, Mar-seille, Paris-Mouffetard,...). Dans le cadre de la réforme du Dépôt légal, il est évidemment indispensable que ces relations soient redéfinies.
La Bibliothèque Nationale et la BPI assurent, chacune dans son domaine, un rôle d'assistance, d'expertise, de conseil et de publications techniques au bénéfice des autres bibliothèques. Basé sur la compétence et l'expérience des personnels concernés, ce rôle n'a pas forcément à être formalisé - à l'exception peut-être de la publication de documents techniques qui pourrait être de la responsabilité d'un service technique central, nous y reviendrons.
La création des services communs de documentation répond au souci de partenariat à l'intérieur des universités.
Les BCP-BDP travaillent de façon institutionnalisée au bénéfice des petites communes, de leurs bibliothèques municipales ou de leurs bibliothèques-relais, par prêt de collections, de mobilier, de matériel, d'expositions, par leur assistance technique et par la formation qu'elles dispensent. Il nous semble important que ce rôle de desserte des petites communes figure dans un texte de loi, pour être à l'abri de la conjoncture.
2.2. Les partenariats avec des services culturels ou d'enseignement
Une bibliothèque ne peut desservir seule l'ensemble de ses publics potentiels : elle a besoin, pour ce faire, de relais et de partenaires.
Il s'agit là, principalement, de l'accès aux collections : par le prêt inter, bien entendu ; également par dépôt à des bibliothèques-relais (bibliothèques des établissements scolaires, des hôpitaux, des prisons, des comités d'entreprise, ...) ou à des collectivités de toutes sortes ( foyers de personnes âgées, centres aérés, crèches,...). Il peut s'agir aussi d'assistance technique (aide au choix de livres, conseil au fonctionnement), voire de prise en charge de la formation des responsables de ces dépôts.
Ces activités relèvent des missions de base des établissements et leur développement est donc du ressort de leur autorité de tutelle. Il conviendrait peut-être d'éclaircir cependant les cas où plusieurs types de bibliothèque (BM , BCP, BU...) peuvent intervenir : les prisons, les hôpitaux, les collèges, les lycées...
2.3. Les financements
Relevant des missions statutaires des établissements, ces partenariats sont financés par les autorités de tutelle dans la plupart des cas.
Ces financements peuvent toutefois être complétés par des contributions des bénéficiaires (communes desservies par les BCP), par des ressources propres (location d'expositions, vente de brochures) et par des subventions : il est positif que des mesures incitatives puissent aider au démarrage de nouveaux services, comme cela est le cas pour les conventions Culture-Justice ou Culture-Petite Enfance.
Pour la prestation de services à d'autres collectivités, les modes de co-financement restent à définir.
3. La circulation des connaissances
3-1. La connaissance du milieu
Pour combattre l'isolement dont souffrent les bibliothèques, pour bénéficier des expériences réussies des uns et pour éviter de refaire les expériences ratées des autres, pour ne pas entreprendre la même étude qui a déjà été menée, pour savoir ce qui se passe et ce qui se fait ailleurs, pour évaluer notre action, pour évoluer intelligemment, bref pour faire circuler les savoirs, les savoir-faire et les compétences, il est impératif de pouvoir "capitaliser les acquis" de la profession.
Dans ce domaine, la situation est insatisfaisante : en matière d'évaluation et de bilan, nous l'avons dit et nous le redirons, la profession traverse une zone désertique, ponctuée de quelques oasis (par exemple, l'enquête statistique générale sur les BU, ESGBU). En matière de statistiques, notre groupe n'a pu que constater, après d'autres, les lacunes des données disponibles.
Il nous semble que le Conseil Supérieur des Bibliothèques a un rôle moteur à jouer pour susciter une véritable politique d'évaluation et de recherche et tirer un bilan annuel de l'activité des services de lecture et de documentation. Il doit pouvoir s'appuyer sur un service national "Etudes et recherche" et sur les travaux des services "Statistiques" des directions ministérielles.
Le réseau national des bibliothèques a besoin d'un service national dont le rôle serait de regrouper et publier l'information statistique, diffuser les normes, regrouper et diffuser les prescriptions et recommandations techniques et bibliographiques.
3.2. La circulation de l'information
La connaissance et l'évaluation de notre activité, les acquis de nos expériences doivent pouvoir être diffusés sous la forme d'études, de dossiers techniques, bilans périodiques ou brochures pratiques : nous manque là une structure d'édition, productive et souple qui pourrait assurer avec plus de moyens le relais de ce que fait, par exemple, la BPI ou le CNCBP.
Quant à la presse professionnelle des bibliothèques, elle n'est pas, loin s'en faut, ce qu'elle devrait être. Le secteur associatif ne peut combler ces manques faute de moyens, le secteur privé ne s'y intéresse pas car c'est un marché trop étroit et les pouvoirs publics n'en ont pas fait une de leurs priorités. La circulation des informations, la confrontation des expériences, l'échange des savoirs ne sont pas, de ce fait, à un niveau satisfaisant.
La circulation très rapide, voire instantanée, de l'information par messagerie télématique commence à se mettre en place, surtout dans le secteur associatif. Il serait intéressant que ce système puisse s'étendre : ne serait-il pas un bon vecteur pour la publicité des postes vacants qui, si l'on veut atteindre une véritable mobilité, doit être rationalisée, voire centralisée.
3.3. Les échanges d'expériences
Au-delà des supports imprimés ou télématiques, la confrontation des pratiques et l'échange des expériences se fait lors de rencontres entre les professionnels : journées d'études, colloques, débats, congrès d'associations et, bien entendu, stages de formation continue.
Les producteurs de formation continue sont multiples (Etat, CNFPT, établissements, associations, secteur privé) et c'est une bonne chose : la demande est si grande qu'il est bon que l'offre soit nombreuse et diversifiée. Il serait cependant souhaitable de pouvoir centraliser les informations sur l'offre proposée .
4. La coopération entre bibliothèques
C'est là où est le plus évident le besoin de déterminer les responsabilités des différents partenaires et de réfléchir à une organisation fonctionnelle : en effet, la coopération entre bibliothèques se déroule dans des domaines variés, à des niveaux d'intervention différents et avec des partenaires multiples : c'est un puzzle à trois dimensions qui s'apparente assez à un casse-tête chinois.
4.1. Les domaines d'activité
Les différents domaines dans lesquels ont lieu des actions de coopération sont très nombreux. Nous ne citerons ici que les plus courants.
Le patrimoine est, probablement, le domaine où le plus de partenaires travaillent en coopération. Il s'agit principalement d'assurer la préservation des documents (Unité mobile de désinfection du CNCBP, ateliers de microfilmage de l'ARCOB et d'Interbibly), mais aussi la conservation répartie des collections (ouvrages et périodiques), la signalisation des fonds, l'assistance technique et l'expertise, la promotion (journée et mois du patrimoine écrit).
L'information bibliographique en coopération existe sous forme de base bibliographique régionale : il convient de distinguer les bases bibliographiques à vocation généraliste (Ile-de-France, Rhône-Alpes) et les bases à contenu local et régional (Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais) ; en tout état de cause, c'est le choix d'un support informatique et télématique qui prévaut le plus souvent.
La formation continue est un créneau largement couvert par les coopérateurs, que ce soit au niveau du CNCBP ou des associations de coopération. Des échelons proches des demandeurs de formation permettent de répondre souplement à des demandes ponctuelles ou spécifiques.
En matière d'action culturelle, également, l'offre est nombreuse et variée : InterVidéo (CNCBP), locations d'expositions, organisation commune de manifestations, participation à des stands collectifs, opérations promotionnelles...
Enfin, la coopération joue son rôle dans les innovations techniques : édition d'un vidéo-disque en Poitou-Charentes, implantation d'équipements d'assistance à la lecture des non-voyants en Pays-de-Loire, réalisation de vidéocassettes en Rhône-Alpes et Limousin... D'autres domaines sont explorés dans certaines régions : citons la recherche, l'aide à l'édition, les relations internationales...
Il nous paraît bon que chaque structure puisse ainsi librement déterminer ses centres d'intérêt et ses activités.
4.2. Les niveaux et moyens d'intervention
On peut identifier trois niveaux d'intervention : le niveau des établissements, le niveau des structures de regroupement (agences ou associations), le niveau des services spécifiques de coopération. En termes de gestionnaires, ces niveaux concernent ainsi les collectivités territoriales, les autres autorités de tutelle, l'Etat et les associations.
Les établissements interviennent directement soit comme coopérateurs parmi d'autres dans une action commune (par exemple, conservation répartie des périodiques), soit comme clients d'une prestation de services coopérative (par exemple, microfilmage de documents). Leur personnel participe à l'administration, à la réflexion et au travail des associations de coopération. Leur budget est utilisé, certes pour une faible part, à la coopération sous forme de cotisations aux associations et/ou sous forme de paiement de prestation de services. La charge de travail consacrée par le personnel des établissements est , elle, une participation "invisible".
Certains établissements, les BCP et certaines grosses BM notamment, interviennent directement au bénéfice de bibliothèques plus petites. Si ces interventions relèvent du statut des BCP, elles excèdent par contre celui des BM. Il s'agit donc là aussi d'une contribution "invisible". A ces exemples décentralisés, il convient d'ajouter ceux de la BN et de la BPI que nous avons évoqués plus haut.
Les "structures de regroupement", comme leur nom l'indique, regroupent des coopérateurs (collectivités, établissements, individus) au sein d'associations. Elles créent ainsi par la synergie des volontés et la définition des objectifs communs une dynamique porteuse. Les 19 associations régionales sont des structures légères, employant entre un et cinq salariés. Leurs ressources propres ne sont dans aucun des cas supérieures aux subventions qu'elles reçoivent : pour l'association la plus autonome financièrement (ACORD), la part de ressources propres ne représentait que 43% de son budget en 1989. Les quelques associations départementales travaillant en ce domaine ont, évidemment, une existence encore plus légère.
Les services spécifiques de coopération sont rares. Nous pouvons, pour la clarté de la réflexion, les classer en deux catégories : les services bibliographiques et documentaires, et les autres. Dans la première catégorie, nous rangerons la Bibliographie nationale courante, le Centre de coordination bibliographique et technique, le Catalogue collectif national des publications en série,le Catalogue collectif des ouvrages étrangers, les CADIST, le Centre national de prêt, le Service des échanges internationaux, l'INIST. Dans la deuxième catégorie, nous citerons le CNCBP...et rien d'autre - ou peut-être la Joie par les livres ? En tout cas, une liste d'une brièveté impressionnante qui nous confirme dans l'idée que, jusqu'à présent, le concept même de coopération n'a guère dépassé le domaine bibliographique et documentaire. Or, nous l'avons vu tout au long de cette réflexion, ces activités strictement bibliothéconomiques doivent pouvoir s'appuyer sur des activités de conseil, d'assistance, de réflexion, d'évaluation, de recherche, de formation, de publications, d'innovations techniques, d'expertise, de communication...
4.3. L'organisation de la coopération
La coopération vit donc une situation doublement insatisfaisante : le flou des domaines de compétence, et le bricolage organisationnel. Les besoins en la matière ont créé successivement des organismes (établissements, associations, services) dont les missions n'ont pas été définies, dont les domaines de compétence sont aléatoires, dont les moyens sont conjoncturels et dont l'articulation entre eux est plutôt brumeuse : les CADIST ne travaillent pas avec l'INIST (et réciproquement), le CCN est hostile aux extractions régionales, les associations régionales ne sont pas, sauf exception, soutenues par les Régions, les transferts d'informations et les mouvements d'assistance sont le plus souvent souterrains, etc.
Essayons alors d'avancer quelques idées claires :
5. La définition des responsabilités
Les missions du réseau de la lecture et de la documentation - l'apprentissage et la pratique de la liberté de jugement, du pluralisme des opinions et donc de la démocratie, l'accès au patrimoine culturel, le soutien à la création littéraire et artistique, l'accompagnement de la formation initiale et continue - en font un véritable service public. A ce titre, l'égalité d'accès à ce service public doit être garantie par une loi sur les bibliothèques dont les principaux points porteraient sur : la qualité du service, la définition des responsabilités des différents partenaires, l'organisation du réseau documentaire, l'organisation de la coopération entre bibliothèques.
Les responsabilités des différents partenaires pourraient, à notre sens, se définir ainsi :
6. Nos propositions
Tout au long de nos travaux, nous avons tenté de raisonner globalement, notre groupe étant attentif au risque majeur que recèlent les actuels changements du paysage des bibliothèques français : le risque de créer un réseau à deux vitesses, c'est-à-dire deux réseaux, ne bénéficiant pas des mêmes ressources ni des mêmes outils et assurant au public des services de qualité évidement inégale.
Notre conclusion est qu'un réseau national (unique) de la lecture et de la documentation, pour avoir une traduction concrète et ne pas rester un voeu pieux, a besoin :
Pour atteindre ces objectifs, nous formulons donc les propositions suivantes :
Notre groupe souhaite que ce projet d'organisation et les propositions qui en découlent fassent l'objet d'une large discussion. Le réseau des bibliothèques et la coopération sont choses assez sérieuses pour mériter une réflexion d'ensemble de la part de tous les partenaires concernés : pouvoirs publics, collectivités publiques et privées, professionnels, usagers...
Composition du groupe
Le groupe "Etablissements et réseau", placé sous la présidence d'Anne-Marie Bertrand, était composé de :
Le groupe a également bénéficié de la collaboration de Bertrand Calenge, Alban Daumas, Gérald Grunberg, Claudine Irlès, Gilles Lacroix et Caroline Sakoun.