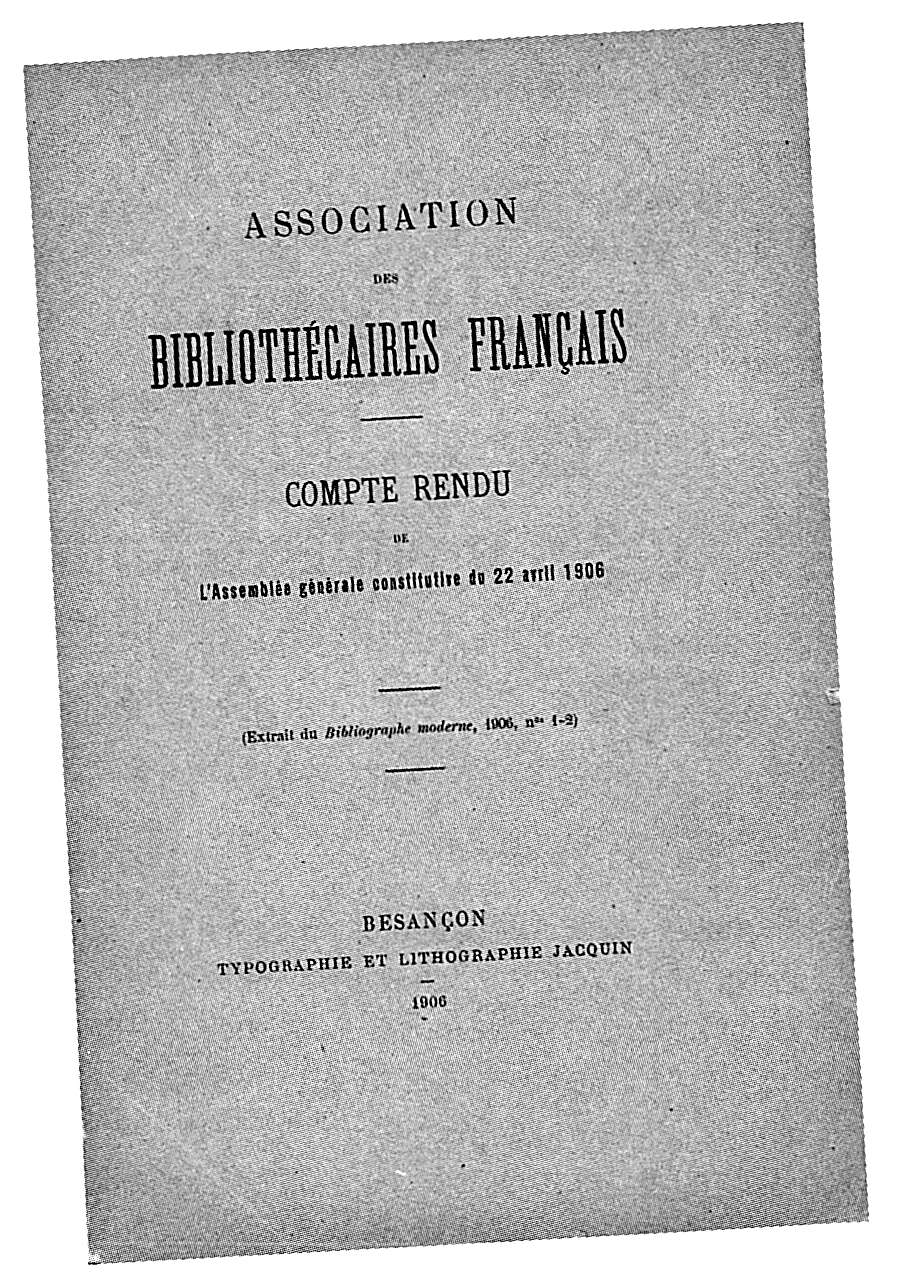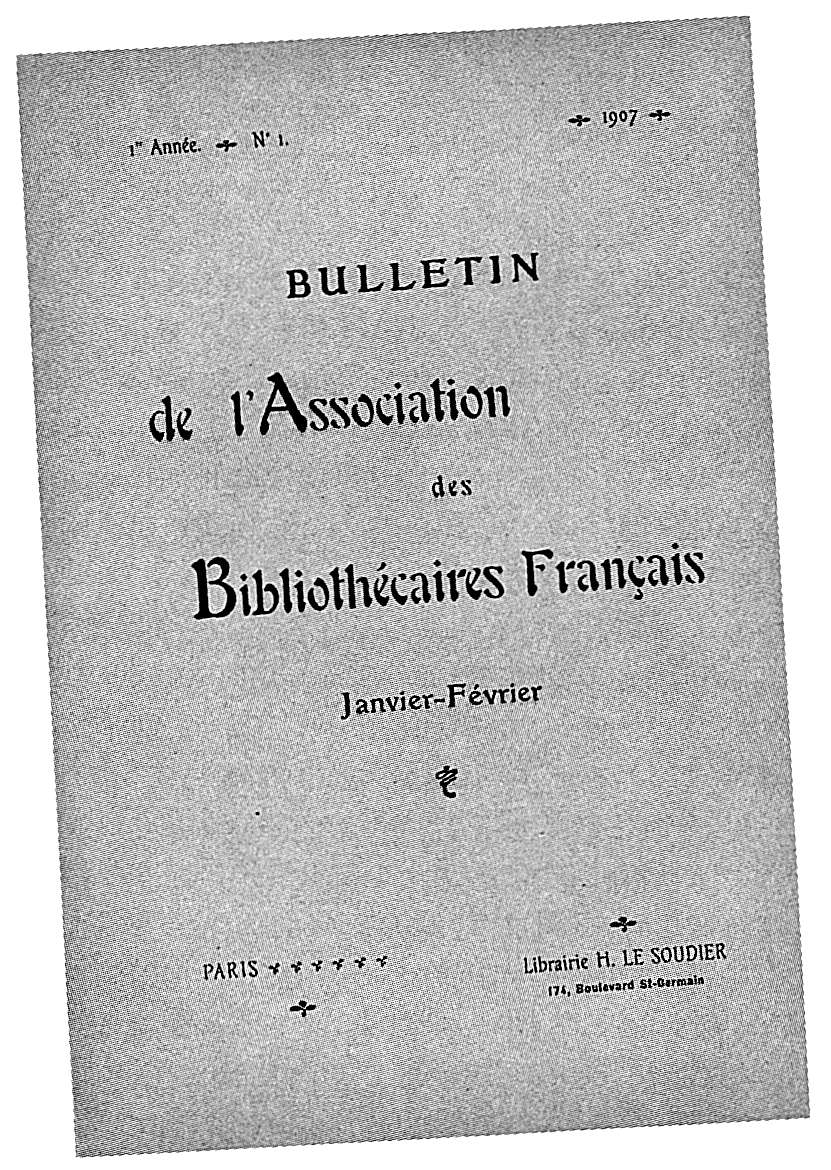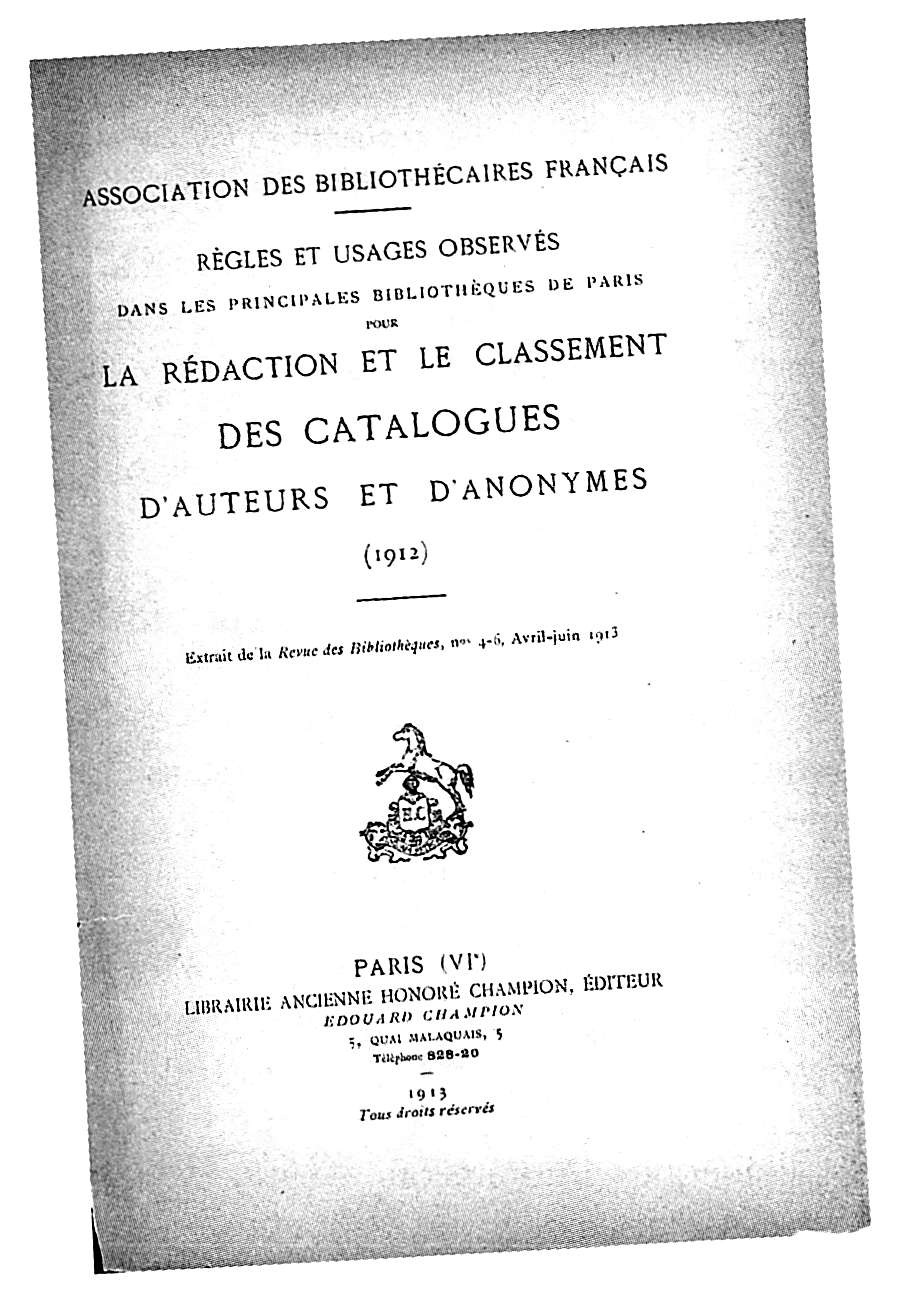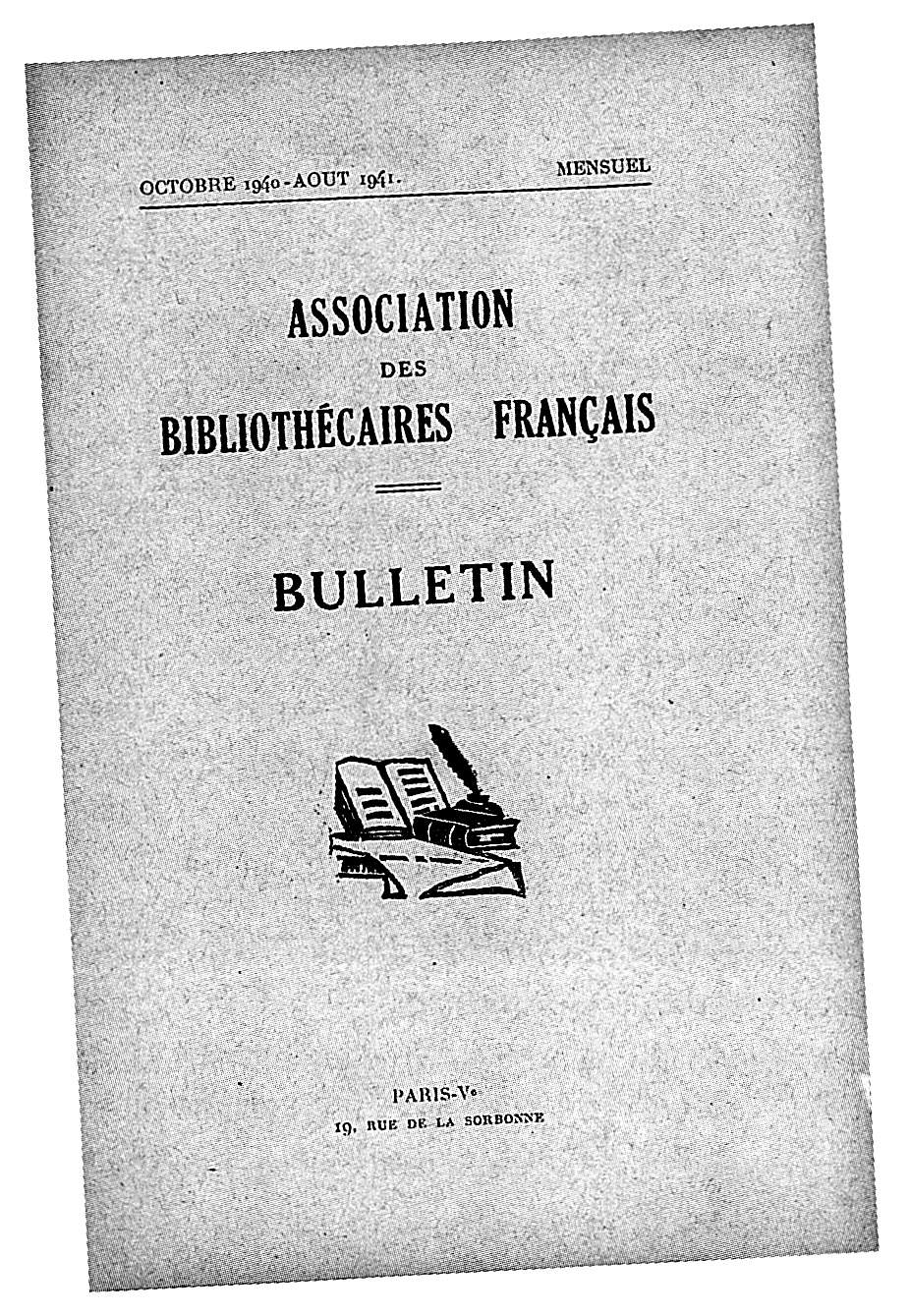Index des revues
- Index des revues
Dimanche 22 avril 1906, fondation de l'ABF
- « Article 2. - L'Association des bibliothécaires français a pour but de s'occuper de toutes les questions concernant les intérêts des bibliothèques et des bibliothécaires.
- Article 3. - Peuvent faire partie de l'Association : 1) les personnes ayant exercé, exerçant ou susceptibles d'exercer, d'après les lois et règlements en vigueur, la profession de bibliothécaire ; 2) les personnes s'intéressant aux bibliothèques. L'admission est prononcée par le comité, à la majorité des voix, sur présentation de deux membres de l'Association.
- Article 5. - L'Association est administrée par un comité composé de vingt membres élus par l'assemblée générale, à la majorité des suffrages. Le vote par correspondance est admis. Le comité est renouvelable annuellement par quart ; les membres sortant sont rééligibles.
- Article 6. - Le comité nomme chaque année, parmi ses membres, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire général, d'un secrétaire adjoint et d'un trésorier. Les pouvoirs du président sortant peuvent être renouvelés pour une seconde année.
- Article 9. - L'assemblée générale se réunit une fois par an ; le lieu et la date en sont fixés par le comité. Elle procède aux élections ; la gestion financière et administrative est soumise à son approbation. Elle peut se réunir extraordinairement sur convocation de son président.
- Article 10.- En dehors des assemblées générales, l'Association est convoquée à des réunions trimestrielles consacrées spécialement à l'étude et à la discussion de questions techniques et professionnelles concernant les bibliothèques et les bibliothécaires (8) . »
- 26 avril 1908 : les bibliothèques municipales classées.
- 3 avril 1910 : les publications nouvelles concernant les bibliothèques françaises ; le dépôt légal.
- 23 avril 1911 : projet de création d'une société mutuelle d'assurances en cas de décès entre les membres de l'ABF ; présentation du « bibliophote ». Cet appareil révolutionnaire, inventé par l'ingénieur Robert Goldschmidt, permettait d'obtenir l'agrandissement d'une image par projection et de la copier (22) .
- 14 avril 1912 : Eugène Morel (BN) fait fonctionner le « bibliophote » devant ses collègues à l'issue de l'AG.
- 30 mars 1913 : la situation des bibliothèques municipales classées et leur personnel ; les publications nouvelles concernant les bibliothèques françaises.
- 20 avril 1914 : les publications nouvelles concernant les bibliothèques françaises (suite).
- « Cet article suit l'article déjà paru dans le Bulletin 188, p.p. 130- 138.
- * Notre collègue André Thill, que je remercie à nouveau d'avoir lu avec tant d'attention mon article sur la création des groupes et sections paru dons le n" 188 du Bulletin, m'a signalé trois petites inexactitudes :
Dimanche 22 avril 1906, fondation de l'ABF
Ses premières années d'activité (1906-1914)
Par Monique Lambert, Conservateur général honoraire des bibliothèquesLa première association de bibliothécaires au monde fut fondée aux États-Unis en 1876. L'année suivante, la Grande-Bretagne créait la sienne. L'Autriche faisait de même vingt ans plus tard, en 1896, la Suisse en 1897 et l'Allemagne en 1900.
Le Danemark fondait à son tour une association au début du XXesiècle, en 1905, puis la France en 1906, la Belgique en 1907, la Finlande en 1910, les Pays-Bas en 1912, la Norvège en 1913, la Suède en 1915, la Pologne en 1917. Il faudra attendre 1930 pour que l'Italie crée son association, 1946 pour le Canada et 1949 pour l'Espagne. C'est en 1973 seulement que l'association des bibliothécaires portugais verra le jour.
La grande misère des bibliothèques et des bibliothécaires en France au début du xxesiècle
Les bibliothèques dépendaient pour les unes de l'État, pour les autres des universités, pour d'autres encore des communes ou des services publics, sans parler des bibliothèques spéciales comme on les appelait alors. Aucun organisme n'existait pour les regrouper et coordonner leurs activités. Elles végétaient pour la plupart, sans moyens réels leur permettant d'accueillir décemment les usagers : locaux presque toujours vétustes et inadaptés, souvent peu ou non chauffés, budgets dérisoires, manque criant de personnel qualifié et même de personnel tout simplement.
Quant aux bibliothécaires, leurs conditions de recrutement, de nomination, de traitement (généralement médiocre) et d'avancement variaient d'un établissement à un autre. Le stage préalable, indispensable dans les grandes bibliothèques parisiennes avant d'entrer dans les cadres réguliers, avait une durée indéterminée qui pouvait se prolonger souvent plusieurs années ; or, le stagiaire n'était la plupart du temps pas rémunéré. Dans les bibliothèques municipales, le titulaire, une fois nommé, devait rester à ce poste jusqu'à la limite d'âge s'il ne voulait pas perdre le bénéfice de la pension de retraite accordée par la municipalité.
Pour assurer la fonction de bibliothécaire, on se contentait d'ailleurs fréquemment d'une notoriété littéraire ou scientifique, voire politique. Des écrivains en quête de revenus supplémentaires ou des personnes sans aucune qualification occupaient des postes de direction au même titre que des professionnels issus de l'École des chartes.
Les inspecteurs généraux, qui visitaient en même temps les dépôts d'archives, les bibliothèques universitaires et les bibliothèques municipales classées, exerçaient leurs fonctions dans des conditions difficiles, sans bureau au ministère et sans aucune aide. Leurs recommandations n'étaient pas toujours suivies d'effets, tout particulièrement dans les bibliothèques municipales ; en effet, le maire préférait souvent s'en remettre à la commission de la bibliothèque plutôt que d'examiner les projets beaucoup plus pertinents du bibliothécaire.
Face à ces conditions déplorables, la rénovation des établissements, la modernisation de la gestion des bibliothèques, le développement de la lecture publique, la nécessité de faire reconnaître la spécificité du métier et d'obtenir des déroulements de carrière décents s'imposaient aux esprits les plus ouverts.
Les premières tentatives de réaction
Dès 1899, le jeune Ernest Coyecque, alors archiviste de la Seine (1) , éprouva avec d'autres collègues « l'urgente nécessité d'un groupement professionnel des travailleurs de bibliothèques et d'archives [...] ; l'arbitraire et le favoritisme sévissaient avec une inconsciente cruauté, abaissant les caractères, décourageant les meilleurs ouvriers de nos services, brisant les carrières les plus honorables et les mieux remplies (2) ».
Aussi demanda-t-il à l'École des chartes de « se transformer en une association professionnelle des archivistes paléographes, tout en restant la brillante société savante qu'elle s'était montrée jusqu'alors (3) ». Mais celle-ci opposa un vote négatif dans sa séance du 30 novembre 1899. Nullement découragé, Ernest Coyecque constatait pourtant : « Pour la première fois, je crois, la question de l'organisation professionnelle d'une partie tout au moins des archivistes et des bibliothécaires venait d'être posée publiquement devant les intéressés et devant l'opinion [...]. La proposition avait abouti à un résultat non négligeable, une adhésion de principe sinon unanime, du moins très généralisée, à une organisation corporative dont il restait à trouver la formule définitive et les modalités d'application (4) -»
Fin 1899, un petit groupe fut chargé d'élaborer les bases de l'ABM, association des archivistes, bibliothécaires et conservateurs de musées. Mais des divergences irréductibles surgirent très rapidement et le projet dut être abandonné dès avril 1900.
Début 1904, un député déposait sur le bureau de l'Assemblée une proposition de loi portant réorganisation générale des archives de France. Beaucoup de bibliothécaires auraient voulu qu'il en fût de même pour les bibliothèques françaises et, à l'instar d'Ernest Coyecque, auraient ardemment désiré « jeter aussi les bases d'une réorganisation générale des bibliothèques, non moins nécessaire que celle des archives, mais plus difficile et plus laborieuse encore en raison de la multiplicité et de la diversité des services (5) ».
En avril 1904, une association professionnelle des archivistes était créée, l'AAF, Association des archivistes français. Deux ans plus tard, l'ABF allait être à son tour fondée.
Avant-projet d'une association de bibliothécaires fin 1905
Parmi les hommes intimement convaincus de la nécessité de sortir les bibliothécaires de leur isolement et de leur donner les moyens de remplir la tâche que commandait l'évolution des bibliothèques, il convient de citer notamment : Ernest Coyecque déjà mentionné, Gabriel Henriot (alors en poste à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, avant de diriger Forney), Jules Laude (BMU de Clermont-Ferrand), Henri Lemaître (BN), Henri Michel (BM d'Amiens), Eugène Morel (BN), Charles Mortet (Sainte-Geneviève), Charles Oursel (BM de Dijon). Ce sont là les pères fondateurs de l'ABF. Plusieurs d'entre eux assumeront ultérieurement la présidence de l'Association ou joueront un rôle éminent dans ses instances dirigeantes.
À l'initiative de deux bibliothécaires de Sainte-Geneviève, Élie Poirée et Charles Sustrac, plusieurs bibliothécaires se réunissent le 14 décembre 1905 pour examiner s'il serait possible de créer une association de bibliothécaires. Un comité d'organisation est constitué sous la présidence de Joseph Deniker (Muséum national d'histoire naturelle) ; il comprend des hommes comme Jean Gautier (faculté de droit de Paris) et Charles Sustrac.
Une circulaire-référendum signée par une trentaine de bibliothécaires, pour la plupart parisiens, est rapidement envoyée à tous les bibliothécaires de France. Elle explique le but de cette future association et propose le texte d'un avant-projet de statuts. Les travaux du comité provisoire sont discutés et adoptés le 18 janvier 1906.
Assemblée générale constitutive du dimanche 22 avril 1906
L'assemblée générale constitutive de l'Association des bibliothécaires français se tient à Paris, au Musée social, le dimanche 22 avril 1906. Présidée par Joseph Deniker, elle a pour objectif « d'arrêter définitivement les termes de nos statuts et d'élire notre comité. [...] Nous poserons ainsi les fondations d'une oeuvre solide. Elle aura pour effet, j'en suis fermement persuadé, de relever la situation des bibliothécaires et de mettre en pleine lumière l'activité féconde de ces "modestes fonctionnaires" qui, jusqu'à présent, un peu volontairement je crois, se tenaient dans l'ombre. Notre oeuvre servira aussi, je l'espère, la cause du développement de nos bibliothèques, appelées à prendre une place de plus en plus importante dans la vie moderne (6) ».
Sur 190 bibliothécaires ayant répondu à la circulaireréférendum, 51 assistent à cette AG constitutive et 40 sont représentés par délégation. Le soir du 22 avril, un banquet réunit un certain nombre de membres de la toute nouvelle association. MM. Deniker et Ruelle (Sainte-Geneviève) portent des toasts à la prospérité de l'Association, tandis que M. Poirée porte lui un toast « au public, notre maître à tous, quelquefois sévère, pas toujours reconnaissant, et dont nous ne sommes que les humbles serviteurs (7) ».
Les statuts de 1906
Seule une sélection des articles les plus significatifs des premiers statuts de l'ABF est citée :
Ces statuts devaient rester inchangés jusqu'à l'AG du dimanche 12 mai 1918 (Paris, Hôtel des sociétés savantes), où il sera décidé de modifier l'article 5. Constatant en effet qu'on avait pris l'habitude de toujours réélire les membres sortants, les adhérents décident que ceux-ci seront désormais inéligibles pendant un an (9) .
Le règlement intérieur ne fera son apparition qu'en 1924 (10) .
Election du premier bureau de l'ABF et définition d'un programme d'action
La première réunion du comité, élu par l'AG du 22 avril, se tient le jeudi 3 mai 1906 à Sainte-Geneviève. Il est procédé à l'élection du bureau de l'Association : président, Joseph Deniker (Muséum national d'histoire naturelle) ; vice-présidents, Henri Michel (BM d'Amiens) et Henri Martin (Arsenal) ; secrétaire général, Charles Sustrac (Sainte-Geneviève) ; secrétaire adjoint, Jean Gautier (faculté de droit de Paris) ; trésorier, Élie Poirée (Sainte-Geneviève).
Au cours de cette première réunion, les membres du comité prennent plusieurs décisions immédiates, définissent le programme de l'Association et les actions prioritaires à engager :
« Le siège social a été fixé 6 place du Panthéon [à Sainte-Geneviève].
Il a été décidé grâce à l'obligeance de M. Stein, directeur du Bibliographe moderne, que le compte rendu de l'assemblée constitutive suivi du texte définitif des statuts serait inséré dans le plus prochain numéro du Bibliographe moderne et tiré à part pour être envoyé, aux frais de l'Association, à tous ses adhérents.
Le comité a jugé qu'il y avait lieu de procéder, avant toute autre étude ou projet, à une enquête sur la situation des bibliothèques. Un questionnaire sera adressé à cet effet et envoyé à tous les membres de l'Association.
Préoccupé de l'ignorance dans laquelle sont laissés les bibliothécaires en ce qui concerne les créations, vacances ou changements d'emploi et, en général, les renseignements divers d'ordre professionnel, le comité a décidé aussi d'examiner la création d'un office de renseignements à l'usage de tous les bibliothécaires.
Plusieurs autres questions également très importantes, comme la formation de comités régionaux et la création d'un bulletin, ont été réservées et seront mises à l'étude ultérieurement (11) . »
Au lendemain d'une deuxième réunion du comité, le 10 mai 1906, les responsables écrivent : « L'Association des bibliothécaires français est maintenant fondée. Elle compte dès à présent plus de 200 membres. À chacun de contribuer à son succès en lui amenant de nouvelles adhésions et en lui adressant les communications, articles, avis, renseignements, qui lui permettront de rendre service à tous. Nous ne doutons pas que nos collègues mettront leur bonne volonté et leur intelligence, comme ils ont déjà commencé à le faire, à réaliser cette bienfaisante coopération au plus grand profit de tous (12) »
Les premiers dirigeants de l'ABF et les conditions matérielles de fonctionnement de l'Association
Trois hommes présideront aux destinées de la jeune ABF pendant les huit années précédant la Première Guerre mondiale : de 1906 à 1908, Joseph Deniker (Muséum national d'histoire naturelle) ; de 1908 à 1910, puis à nouveau de 1912 à 1914, Charles Mortet (Sainte-Geneviève) ; de 1910 à 1912, Henri Martin (Arsenal).
Deux secrétaires généraux se succéderont durant cette période : de 1906 à 1908, Charles Sustrac (Sainte-Geneviève) ; de 1908 à 1914, Jean Gautier (Faculté de droit de Paris).
Un seul trésorier, Élie Poirée (Sainte-Geneviève), gérera les finances de l'Association de 1906 à 1925, soit pendant dix-neuf ans.
Ces six hommes, qui acceptent la lourde charge de présider aux destinées de l'Association dans ses premiers pas, accomplissent un véritable travail de pionniers. Défenseurs acharnés de la cause des bibliothèques et des bibliothécaires, ils ne disposent d'autre aide matérielle que celle fournie par la bibliothèque où ils exercent leurs fonctions (il faudra attendre quarante ans pour qu'en 1946 l'ABF puisse enfin disposer d'une secrétaire à temps partiel et assurer une permanence un jour par semaine, le vendredi, de 17 h 30 à 19 heures).
Il convient de souligner le rôle primordial joué par la bibliothèque Sainte-Geneviève dans les premières années d'existence de l'ABF, tant en ce qui concerne une partie de son équipe dirigeante que son siège social. L'Association devait en effet rester hébergée par Sainte-Geneviève, qui en quelque sorte l'avait tenue sur les fonts baptismaux, pendant vingt-huit ans, jusqu'en 1934. C'est d'ailleurs à cette bibliothèque que l'ABF décida en 1916 de céder tous les documents reçus par l'Association en don ou en échange, « pour y être incorporés à ses collections et communiqués à ses lecteurs (13) ».
Les deux premières années d'activité (1906-1907)
Sous l'impulsion de ses membres fondateurs, la nouvelle association se veut être un centre de ralliement pour ses adhérents, dispersés à travers la France dans des bibliothèques de types différents, en leur permettant de se connaître, de confronter leurs expériences, d'exprimer leurs doléances. L'ABF s'efforce également de s'affirmer auprès des pouvoirs publics comme un interlocuteur valable.
Fidèle à ses engagements, l'Association lance dès 1906 une grande enquête sur la situation des bibliothèques et des bibliothécaires en envoyant un questionnaire à tous ses adhérents. Son secrétaire général, Charles Sustrac, en tire dès 1907 des conclusions sur la situation difficile des bibliothèques de province (14) . Au comité du 8 décembre 1906, Henri Michel (BM d'Amiens, vice-président de l'ABF), exprime une idée très révolutionnaire pour l'époque : « En annexant à la bibliothèque municipale la bibliothèque populaire, en la dirigeant, le bibliothécaire étendra son influence, il deviendra l'homme nécessaire, celui qui renseigne (15) . »
La situation des bibliothèques municipales classées fait, en 1907, l'objet d'un premier rapport de Charles Oursel (BM de Dijon) ; il y joint un projet de cadres et de traitements. Cette question reviendra constamment, pendant des années, tant devant le comité de l'ABF (16) que devant le ministère de l'Instruction publique ou la future Commission supérieure des bibliothèques.
Un mémoire sur la situation des bibliothécaires en France est remis par l'ABF au ministre de l'Instruction publique début 1907 (17) . La même année, M. Steeg, député, rédige un rapport sur la situation des bibliothèques françaises. Il y aborde les principaux problèmes posés par l'Association, notamment le manque de garantie dans le recrutement du personnel, l'avancement arbitraire ou arrêté par des barrières injustifiées, l'insuffisance des budgets, l'absence d'orientation générale du point de vue technique, la demande de création d'un Conseil supérieur des bibliothèques (18) . À l'assemblée trimestrielle du 14 décembre 1907, Charles Mortet présente un projet d'organisation d'un tel conseil.
Par ailleurs, dès la première assemblée trimestrielle de l'Association, réunie le 30 juin 1906, la question des stages dans les bibliothèques est posée. Les interventions répétées de l'ABF entraîneront la suppression des abus et des conditions de traitement de début améliorées. Dans cette même réunion, les adhérents réclament pour les bibliothèques publiques un personnel d'employés, intermédiaires entre les bibliothécaires et les gardiens ; mais cette demande ne sera satisfaite qu'à la fin des années 1920.
La question de savoir si le bibliothécaire doit ou non être un chercheur ne va pas tarder à agiter les premiers débats (19) . Les uns, en réaction contre ceux qui sont uniquement préoccupés par leurs travaux personnels, affirment que ce n'est pas leur rôle et que le bibliothécaire doit se consacrer entièrement à la gestion de sa bibliothèque et à ses lecteurs.
Les autres avancent les avantages procurés par la recherche scientifique à ceux qui s'y consacrent et le bénéfice que peut en retirer la bibliothèque dont ils ont la direction. Le développement des bibliothèques ne tarde pas à apporter une réponse à cette controverse, l'accomplissement des tâches professionnelles supprimant peu à peu toute possibilité de se consacrer à la recherche durant ses heures de présence dans la bibliothèque.
Parallèlement, le bureau et le comité se préoccupent de la création d'un organe de diffusion de l'information. Le premier numéro du Bulletin de l'Association des bibliothécaires français paraîtra dès janvier 1907 (ce lien essentiel entre les adhérents fait l'objet du chapitre suivant).
Ainsi, en moins de deux années, l'ABF a réussi à prouver son utilité et son efficacité en faisant prendre conscience aux élus et au gouvernement, tout comme à l'opinion publique, de l'indigence des bibliothèques et de la nécessité de reconnaître la spécificité du métier de bibliothécaire.
Publication d'un bulletin dès janvier 1907
Moins d'un an après sa fondation, l'ABF met à la disposition des bibliothécaires un organe corporatif au format in-8°, le Bulletin de l'Association des bibliothécaires français, premier numéro, première année, janvier-février 1907.
Sa parution est tout d'abord bimestrielle. Mais le bureau et le comité ne peuvent maintenir ce rythme plus de deux années. Dès 1909, la périodicité devient irrégulière, avec quatre ou cinq numéros chaque année, jus-qu'en 1915. Trois fascicules par an paraîtront de 1916 à 1918 ; deux seulement en 1919.
Le Bulletin se consacre, bien évidemment, à la vie de l'Association (comptes rendus des réunions du comité et des décisions du bureau, ainsi que des assemblées générales et trimestrielles, nouveaux adhérents, listes annuelles des membres). Mais il publie aussi les textes législatifs et réglementaires, les budgets, les discussions au Parlement sur le monde des bibliothèques. Il fait le point sur la situation des bibliothécaires (recrutement, stages, traitement, avancement, retraite) comme sur l'administration des bibliothèques.
Dès ses premiers numéros, il ouvre largement ses colonnes aux études bibliothéconomiques : guides-manuels pour les lecteurs (1907), vente et échange de doubles (1907 et 1912), classifications méthodiques en bibliographie (1908), catalogues sur fiches imprimés (1909), prêt de bibliothèque à bibliothèque en France et à l'étranger (1909), dépôt légal (1910), unification des règles de catalogage (1910 et 1913), récolement dans les bibliothèques (1911), « bibliophote » (1911), indexation (1912), organisation d'un système de demande de renseignements au moyen de cartes transmises de bibliothèque à bibliothèque (1913), etc.
On y trouve également la présentation des grandes bibliothèques françaises et étrangères, des articles sur les sociétés d'amis des bibliothèques, une chronique bibliographique spécialisée, les notices nécrologiques des personnalités éminentes de l'ABF.
À partir du numéro 4-6 de septembre-décembre 1914, une nouvelle rubrique, « Les bibliothèques et la guerre », voit le jour. Elle figurera dans chaque livraison jusqu'au numéro 1-3 de janvier-juillet 1919.
Il suffit, comme on le voit, de parcourir la collection des premières années du Bulletin pour prendre conscience du rôle majeur qu'il a rempli dès ses premières livraisons. Les membres de l'ABF l'ont utilisé tout à la fois comme tribune pour leurs revendications légitimes et comme organe de formation professionnelle.
L'affirmation de l'ABF aux plans national et international (1908-1914)
En 1908, l'ABF obtient et publie la liste des 35 BM qui avaient été classées en application du décret de 1897. Jusqu'alors, le ministère avait refusé de la publier tant elle variait ; au lieu en effet de prendre comme seul critère de classement l'importance et la richesse de leurs fonds, les pouvoirs publics avaient tendance à tenir compte des possibilités budgétaires des municipalités chaque année !
L'Association défend avec ténacité l'extension du droit d'initiative des bibliothécaires dans les comités d'inspection et d'achat des bibliothèques municipales classées. Le décret du 6 juin 1912 viendra récompenser ses efforts en donnant plus d'indépendance et plus d'autorité aux directeurs de BMC.
Après l'examen de la situation des bibliothécaires municipaux et universitaires, l'ABF s'attaque au problème des bibliothécaires des administrations centrales (un sous-chef de cabinet au ministère pouvant se voir nommé à la tête de la bibliothèque du ministère de la Marine ou de l'Instruction publique, par exemple) et réagit vigoureusement contre toutes les nominations arbitraires (ainsi la nomination à la direction de la Mazarine, en 1909, d'un candidat non archiviste-paléographe).
Elle parvient à faire publier en 1909 le décret portant réorganisation de la Bibliothèque nationale et rétablissement du comité consultatif, et à faire promulguer une série de décrets réorganisant les trois bibliothèques publiques de Paris (Arsenal, Mazarine et Sainte-Geneviève). La même année, elle obtient aussi la régularisation de l'avancement des bibliothécaires des universités.
L'Association s'efforce également d'arriver à unifier les situations du personnel des bibliothèques publiques et de l'université de Paris en l'assimilant à celui de la Bibliothèque nationale, dont les statuts sont plus favorables. Parallèlement, elle poursuit avec énergie sa demande de péréquation des traitements, d'une part entre les différentes catégories de bibliothécaires, d'autre part par rapport au personnel de l'enseignement supérieur (combat qui se poursuivra longtemps).
Il faut rappeler à ce propos qu'il n'existait pas alors de syndicat de bibliothécaires, le premier n'ayant été fondé qu'en 1926. L'ABF s'est donc vue contrainte de jouer, pendant vingt ans, le double rôle d'association professionnelle et de groupement défendant les revendications légitimes des bibliothécaires.
Une des grandes victoires de l'Association, pendant ses premières années d'activité, est la création par décret du 12 janvier 1909 de la Commission supérieure des bibliothèques, instituée au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Regroupant des représentants de l'État et de la profession, elle est chargée d'étudier toutes les questions relatives aux bibliothèques (20) .
Toutefois, celle-ci ne se réunit pas très souvent et ne tient que rarement compte des demandes formulées par l'ABF. Mais elle permet aux bibliothécaires de faire entendre leur voix auprès de leur ministre de tutelle ou de son représentant, le directeur de l'Enseignement supérieur, aux services duquel les bibliothèques sont rattachées (21) .
En revanche, la constitution d'un office de renseignements (destiné à faire connaître les vacances et les créations de postes), souhaitée dès la première réunion du comité de l'ABF le 3 mai 1906, sera encore réclamée en 1923...
Chaque année, l'Association tient son assemblée générale statutaire en l'Hôtel des sociétés savantes (28 rue Serpente à Paris), même pendant les années de guerre. À partir de 1908, les AG peuvent être suivies d'une ou deux communications :
À partir de 1910, l'ABF organise à l'instigation d'Eugène Morel (futur président de l'Association de 1918 à 1919), avec le concours de l'institut international de bibliographie et du Cercle de la librairie, cinq séries de conférences qui remportent un immense succès. Présentées dans le cadre de la section des bibliothèques modernes de l'École des hautes études sociales et ouvertes à tous, elles ont pour but de faire connaître les bibliothèques françaises et étrangères, d'apporter aux étudiants une initiation à la recherche bibliographique, d'offrir une formation continue aux bibliothécaires qui les apprécient unanimement.
Inaugurées par Henri Martin (Arsenal), alors président en exercice de l'ABF, elles devaient compter parmi leurs intervenants des bibliothécaires comme Camille Bloch (musée de la Guerre, qui deviendra par la suite la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine), Jules Laude (BMU de Clermont-Ferrand), Henri Lemaître (BN, infatigable pionnier de la lecture publique), Charles Sustrac (Sainte-Geneviève) ou encore Maurice Vitrac (BN).
Des éditeurs comme Michel Bourrelier (futur viceprésident de l'Association pour le développement de la lecture publique, qui sera fondée en juillet 1936, et futur président de la section de la Lecture publique, créée en 1943) ou Paul Otlet (créateur de la Classification décimale universelle avec Henri Lafontaine) apporteront également leur concours. La déclaration de la Première Guerre mondiale devait malheureusement empêcher la poursuite de ces conférences qui constituent un premier exemple d'enseignement de la bibliothéconomie.
À l'initiative d'Eugène Morel, une grande partie des conférences est publiée en trois volumes par l'ABF, qui achète des exemplaires pour les distribuer gratuitement à ses adhérents (23) . Elles apportent au lecteur un ensemble d'idées novatrices, d'expériences et de renseignements techniques venant compléter fort utilement les articles fragmentaires parus au fur et à mesure dans le Bulletin de l'Association des bibliothécaires français.
Outre cette importante contribution, Eugène Morel, décidément infatigable, fait paraître pendant cette période deux autres ouvrages : en 1908 Bibliothèques : essai sur le développement des bibliothèques publiques et de la librairie dans les deux mondes (24) ; et en 1910 La Librairie publique (25) , livre fortement inspiré par les pratiques anglo-saxonnes qui devait susciter de multiples polémiques dès sa parution.
En 1913, l'Association publie et distribue gratuitement à tous ses membres Les Règles et Usages observés pour la rédaction et le classement des catalogues d'auteurs et d'anonymes.
Sur le plan de la coopération internationale, l'ABF devait également s'imposer rapidement en participant activement à la Conférence internationale de bibliographie de Bruxelles en 1908. Henri Martin (Arsenal, président de l'ABF de 1910 à 1912 puis de 1921 à 1923), qui avait été le secrétaire général du premier Congrès international des bibliothécaires tenu à Paris en 1900, fut le président du deuxième Congrès international des archivistes et des bibliothécaires organisé en août 1910 à Bruxelles.
Parallèlement, l'Association développe ses relations avec les bibliothèques étrangères et les associations homologues des autres pays, tout particulièrement avec la puissante American Library Association.
Les premiers adhérents de l'ABF
Au début du siècle, on peut distinguer cinq groupes de bibliothèques : la Bibliothèque nationale ; les trois bibliothèques publiques de Paris (Arsenal, Mazarine et Sainte-Geneviève) ; les bibliothèques universitaires de Paris et de province ; les bibliothèques municipales classées et non classées ; enfin les bibliothèques d'organismes dépendant ou non de l'État. Des cloisonnements pratiquement infranchissables empêchent tout passage des unes aux autres.
Les premiers adhérents de l'ABF représentent essentiellement trois catégories distinctes de bibliothécaires : les bibliothécaires d'État, les bibliothécaires universitaires et les bibliothécaires municipaux (pour la plupart de province). Quoique ouverte dès l'origine à « toutes les personnes s'intéressant aux bibliothèques », l'Association des bibliothécaires français a en effet d'abord été essentiellement un groupement corporatif.
La première liste d'adhérents est publiée dès 1907 dans le premier numéro du Bulletin de lAssociation des bibliothécaires français (janvier-février 1907). Elle recense 195 membres, présentés par catégories avec sous-classement alphabétique : bibliothèques de Paris (89 hommes), bibliothécaires honoraires (9 hommes résidant à Paris), bibliothèques de province (74 hommes), autres membres (22 hommes, essentiellement des inspecteurs généraux et des archivistes, et 1 femme, Mlle Berthet, professeur à Nevers). Chaque nom est donné seul, sans prénom, tant il est évident que chaque adhérent ainsi mentionné ne peut être qu'un homme. Seule dérogation dans cette liste, Mlle Berthet.
La deuxième liste de membres parue en 1908, toujours dans le Bulletin, adopte une présentation alphabétique unique plus commode. Les noms sont toujours donnés sans prénom, sauf pour distinguer les homonymes : par exemple Mortet (Charles) et Mortet (Victor). Mlle Berthet adhérera à l'ABFjusqu'en 1913 ; elle sera la seule adhérente de sexe féminin pendant toutes ces années, et encore n'est-elle pas bibliothécaire mais enseignante (26) .
Le nombre des adhérents tournera autour de 190 à 200 les premières années. Il atteindra le chiffre de 218 à la veille de la Grande Guerre, pour tomber à 125 seulement en 1916. Les adhésions ne reprendront une courbe ascendante qu'après l'armistice, avec 167 membres en 1919, 205 en 1920, 267 en 1923, 335 en 1924, 404 en 1925 (27) .
Bilan largement positif de ces huit premières années d'activité
Fondée par des bibliothécaires qui avaient décidé de sortir de leur pesant isolement, l'ABF s'est fixé dès sa fondation deux buts principaux : d'une part, faire reconnaître la spécificité du métier de bibliothécaire et obtenir des conditions d'exercice décentes ; d'autre part, rénover les bibliothèques et moderniser leur gestion afin de pouvoir mieux organiser la lecture et la documentation publiques.
« Pour surmonter tous les obstacles, maintenir entre ses adhérents le maximum de cohésion, il fallut aux fondateurs de l'Association une ardeur peu commune, une foi dans leur tâche et un sens aigu des réalités [...]. Un mois après la réunion constitutive, l'Association comptait déjà 200 membres appartenant aux bibliothèques les plus diverses de Paris et de province, qui plaçaient leur espoir de réformes dans le mouvement naissant (28) . »
Ces hommes qui se dévouèrent à l'ABF dans ses premières années d'existence, sans ménager leur temps ni leurs efforts, firent en effet preuve de beaucoup d'opiniâtreté et de détermination. Face à l'immensité de la tâche qui les attendait car tout était à faire, animés d'une inébranlable confiance dans l'aboutissement de leurs légitimes revendications, ils s'attaquèrent vaillamment à tous les dossiers. Ils surent d'emblée faire entendre la voix des bibliothécaires, même s'ils ne purent toujours faire aboutir toutes leurs demandes durant ces huit années. Ils surent aussi imposer très rapidement l'Association comme un interlocuteur incontournable auprès des pouvoirs publics (29)
Parallèlement à l'expression sans cesse martelée de ses doléances, l'ABF ne négligea pas pour autant l'étude des multiples problèmes posés par l'adaptation des bibliothèques aux besoins nouveaux de leurs lecteurs. Certes, l'image des bibliothèques françaises restait globalement mauvaise et la comparaison faite avec l'étranger montrait qu'elles présentaient un retard considérable. Mais l'Association avait su innover par les articles bibliothéconomiques publiés dans son Bulletin comme par les conférences données à l'École des hautes études sociales dans le cadre de la section des Bibliothèques modernes.
Jouant un rôle moteur sur le plan professionnel, s'affirmant aux plans national et international, l'Association des bibliothécaires français est une association dont l'utilité et l'efficacité ne sont plus à démontrer à la veille de la Première Guerre mondiale. Son importance et son influence ne feront que croître ultérieurement.
Notes:
p. 135, colonne de droite: le groupe Nord a été fondé par Edmond Guérin (et non par Joël Guérinj.
p. 136, colonne de gauche: Pascal Sonz, qui a créé la sous-section Discothécaires, était alors affecté ô la Bibliothèque publique de Massy (et non à la Direction du livre et de la lecture).
p. 136, colonne de droite: Jean-Robert Grozay, fondateur du groupe Franche-Comté, était en 1983 en poste à la BM de Montbéliard (et non à la BM de Carcassonnej.
2. Bulletin de l'Association des bibliothécaires français, 1920, 141 année, n" 4-5, p. 86. retour au texte
3. Ibid., p. 86. retour au texte
4. Ibid., p. 87. retour au texte
5. Ibid., p. 89-90. retour au texte
6. Le Bibliographe moderne, 1906, n° 1-2, p. 176. Cette revue, dont la fonction était de fournir des informations sur la profession, avait pris la suite en 1897 de la Revue internationale des bibliothèques fondée en 1895 par Charles Mortet. retour au texte
7. Ibid., p. 177. retour au texte
8. Ibid., p. 177-178. retour au texte
9. Bulletin de l'Association des bibliothécaires français, 1918, 121 année, n" 3-4, p. 39. retour au texte
10. /b/ûf., 1924, n" 1-3, p. 24-26. retour au texte
11. Le Bibliographe moderne, 1906, n° 1-2, p. 178-179. retour au texte
12. lbid., p. 179. retour au texte
13. Bulletin de l'Association des bibliothécaires français, 1916, 10e année, n° 5-6, p. 49. Le catalogue des livres, brochures et périodiques reçus par l'ABF de 1907 à 1916 est publié dans ce même numéro. retour au texte
14. Voir Bulletin de l'Association des bibliothécaires français, janvier-février 1907, 1" année, n° 1, p. 9-14. retour au texte
15. Annuaire de l'ABF 1926. Paris, Librairie ancienne Honoré Champion, 1927, p. 13. retour au texte
16. Voir Est-il possible d'améliorer la situation des bibliothèques municipales classées et de leur personnel ? ». ln Bulletin de l'Association des bibliothécaires français, 1913, T année, n" 3. retour au texte
17. Voir Ibid., 1907, 1" année, n° 4. retour au texte
18. Voir « La situation des bibliothèques d'après le rapport de M. Steeg, député ». In Bulletin de l'Association des bibliothécaires français, novembre-décembre 1907, 1année, n° 6. retour au texte
19. Voir Le bibliothécaire doit-il être un savant ? ». In Bulletin de l'Association des bibliothécaires français, janvier-février 1908, 2eannée, n° 1. retour au texte
20. Se reporter au Bulletin de l'Association des bibliothécaires français, 1909, 31 année, n° 2. retour au texte
21. Mais l'ABF voulait davantage ; elle réclamait la création d'un service central. Dès 1922, le ministre de l'Instruction publique avait proposé au Sénat et à la Chambre des députés la création d'une Direction des bibliothèques qui « assurerait une unité indispensable, une simplification budgétaire et technique des plus profitables ». Réitérant sans relâche sa demande, l'ABF obtiendra finalement cette création au lendemain de la Libération. retour au texte
22. Voir Bulletin de l'Association des bibliothécaires français, 1911, 51 année, n° 3. retour au texte
23. Eugène Morel (préf.), Bibliothèques, livres et librairies : conférences faites à l'École des hautes études sociales sous le patronage de l'Association des bibliothécaires français is [ 1 série 1910-3C série 19121 Paris, Marcel Rivière, 1912-1914, 3 vol. retour au texte
24. Tome 1, Paris, 1908. retour au texte
25. Paris, Armand Colin, 1910. retour au texte
26. Aucune liste de membres ne paraîtra pendant les années de guerre ni juste après l'armistice. L'annuaire de 1923, publié également dans le Bulletin, recense 267 adhérents dont 14 femmes, 6 d'entre elles assumant la direction de leur bibliothèque. La première femme à accéder à un poste de responsabilité au sein du bureau national sera Gabrielle Duprat-Odend'hal, élue secrétaire générale de l'ABF en 1927. Myriem Foncin sera la première femme élue à la présidence de l'Association en 1945. Enfin, Geneviève Dollfus, qui assumera la charge de trésorier pendant dix-sept ans de 1949 à 1966, sera la première femme à occuper cette fonction à l'ABF. retour au texte
27. Ces chiffres sont donnés dans le Bulletin de l'Association des bibliothécaires français, 1925, 191 année, n" 4-6, p. 76. La barre des 500 adhérents ne sera franchie que dans les années 1950. retour au texte
28. 1906-1956. Manifestations du cinquantenaire (20 et 21 novembre 1956): compte rendu, textes des communications, suivi de l'Annuaire des membres de l'Association. Paris, ABF, 1957, p. 12 (extrait du discours de Maurice Piquard, chargé de l'administration des BU de Paris, et alors président en exercice de l'ABF). retour au texte
29. Toutefois, l'Association des bibliothécaires français n'a été reconnue d'utilité publique que le 12 avril 1969 (Journal officiel du 22 avril 1969). Cette question avait pourtant été mise à l'ordre du jour dès l'assemblée trimestrielle du 26 juillet 1925, mais reportée à une date ultérieure [Bulletin, 1925, n° 4-6, p. 89). En 1965, à l'occasion de la refonte des statuts, la demande de reconnaissance d'utilité publique est à nouveau examinée (Bulletin, 1965, n° 47, p. 129). Mais le dossier, déposé en 1967, est à refaire car la réglementation a changé entre-temps (Bulletin, 1967, n° 56, p. 187). C'est pourquoi la décision prise en 1965 n'aboutira finalement qu'en 1969. Ajoutons que l'ABF a, enfin, été reconnue comme organisme de formation professionnelle en 1978. retour au texte