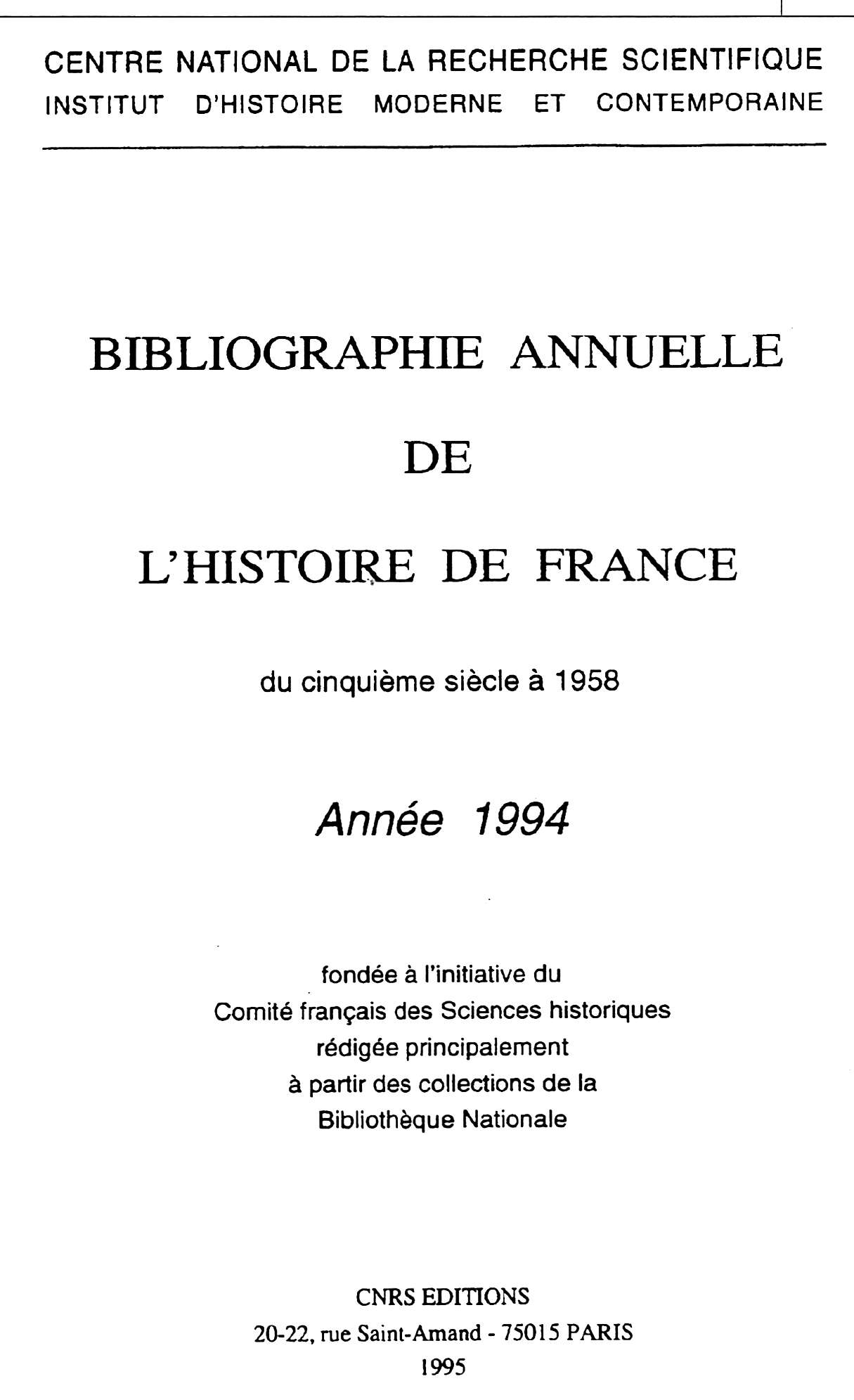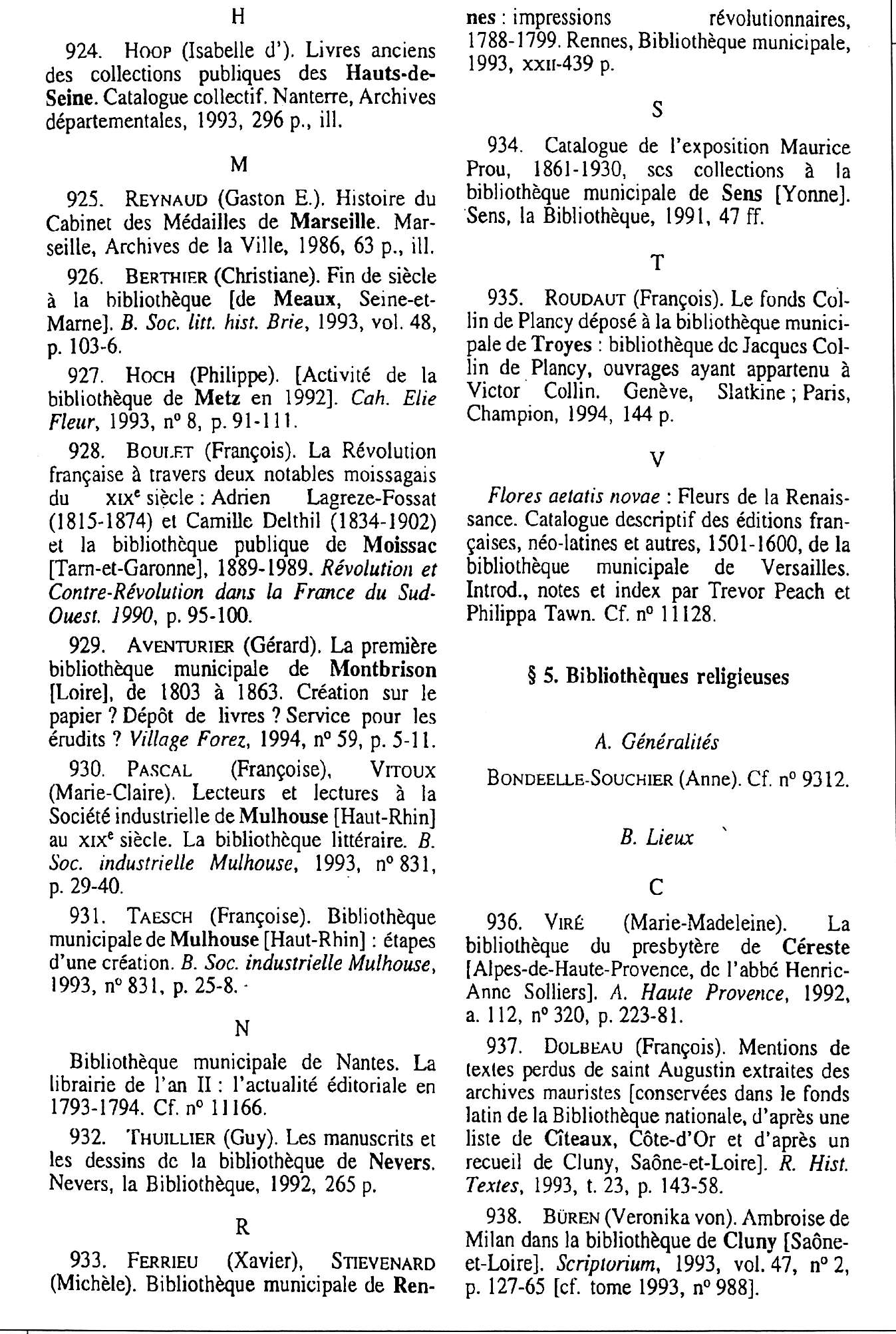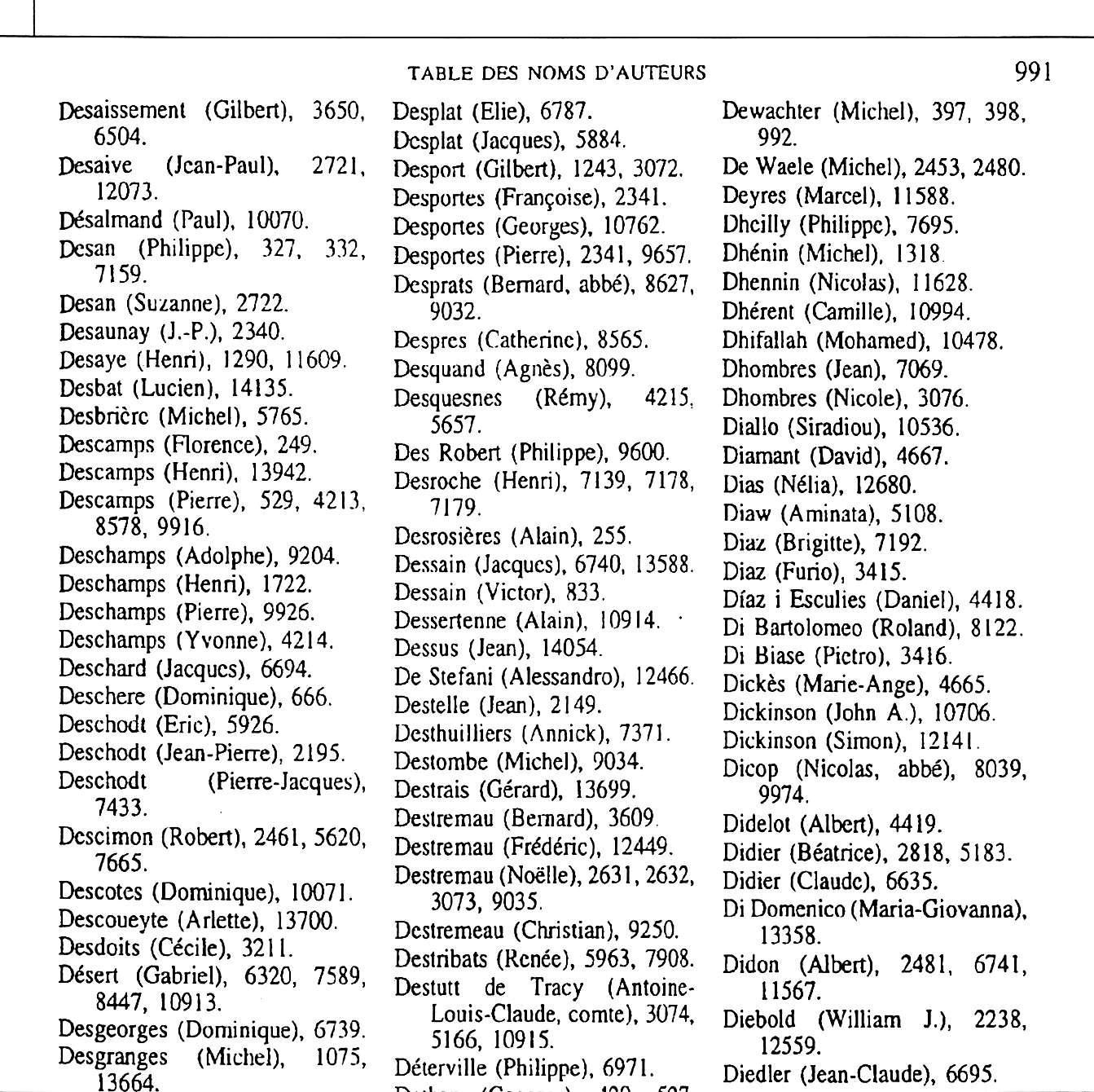Index des revues
- Index des revues
La bNF et la Bibliographie annuelle de l'Histoire de France
-
Albert-samuel, Colette
La bnf et la bibliographie annuelle de l'histoire de france , p.32-34. -
Salomon, Serge
Voyage devant les écrans, p.35-37. -
Gourdier, Annie
Le marché de réinformatisation des bibliothèques , p.38-41.
La BNF et la Bibliographie annuelle de l'Histoire de France
42 ans de collaboration
Par Colette Albert-Samuel, Institut d'histoire moderne et contemporaine, CNRSLa BN prend l'initiative d'une Bibliographie historique française
La Seconde Guerre mondiale a interrompu la publication du Répertoire bibliographique de l'Histoire de France préparé par Pierre Caron, dont le dernier volume, publié en 1938, recensait la production de 1931. En 1954, Julien Cain, administrateur général de la Bibliothèque nationale et historien de formation, sensible à l'absence d'un tel instrument de travail alors que la plupart des pays européens et américains reprenaient l'édition de bibliographies historiques nationales, demande à trois de ses collaboratrices chartistes - Thérèse Kleindienst, Alice Garrigoux et Suzanne Honoré - d'examiner les différentes possibilités de renouer avec cette tradition. Il souhaite y associer la communauté des historiens en faisant appel à Robert Fawtier, professeur à la Sorbonne et président du Comité international des sciences historiques, ainsi qu'à Michel François, secrétaire général de ce Comité et responsable de la Bibliographie internationale des sciences historiques. Ils décident, pour éviter les retards du Répertoire de Caron, de créer une nouvelle série en 1955, d'adapter son plan aux nouveaux thèmes de la recherche historique, et souhaitent, parallèlement à la publication d'un volume annuel, la mise en chantier de tomes rétrospectifs permettant de « remonter au moins jusqu'à 1945.
Appel au CNRS
Ces trois pères fondateurs » proposèrent au CNRS une association pour la réalisation d'une Bibliographie annuelle de l'Histoire de France: le premier accorderait un poste d'ingénieur de recherche pour la réalisation de l'ouvrage qui serait publié aux Éditions du CNRS, la Bibliothèque nationale apporterait une aide essentielle : un bureau, un accès direct à ses collections et surtout l'expérience irremplaçable de ses collaborateurs, Julien Cain assumant la responsabilité scientifique de l'entreprise. C'est donc sur les bases de ce contrat, non écrit mais scrupuleusement respecté par les deux parties depuis près d'un demi-siècle, que j'ai pris mes fonctions le 3 novembre 1954.
La collaboration BN-CNRS en pratique
La Bibliothèque nationale accordait déjà à Nicolas Tolu, rédacteur de la Bibliographie internationale des sciences historiques sous la direction de Michel François, un petit bureau 65, rue de Richelieu. On lui demanda de le partager avec moi. Jean-ne Petit et Alice Garrigoux, du service de l'Histoire de France, m'autorisèrent à examiner avec elles le lundi matin les livres français entrés par dépôt légal et le mardi matin, les acquisitions étrangères, échanges et dons. J'obtins aussi le droit d'indiquer au crayon sur les ouvrages 3 BA, ce qui permettrait de recevoir les fiches de la Bibliographie de la France et m'évitait une copie très fastidieuse. Alice Garrigoux eut la bonté de relire les épreuves des premiers volumes et ce très rapidement, car je m'étais engagée à publier l'année suivante la production de l'année précédente : le tome 1955 a paru en 1956 et il en a été toujours ainsi pour les quarante et un volumes édités sous ma responsabilité. Cette rapidité, et je devrais dire ce record, a été rendu possible grâce à l'accès direct aux collections : dépouillement au département des Périodiques, dès leur bulletinage, des 2 200 revues françaises et étrangères, examen sur place des livres au département des Imprimés.
Le CNRS tint aussi ses engagements : la Bibliographie est depuis 1955 toujours publiée par les Éditions du CNRS et l'équipe a été renforcée. En 1959, devant l'inflation de la production historique (4 900 références en 1955, 7 650 en 1959), Julien Cain obtint un nouveau poste d'ingénieur occupé à mi-temps par Brigitte Moreau et Sylvie Postel-Lecocq, leur autre mi-temps étant consacré à l'édition des travaux de Philippe Renouard sur l'imprimerie parisienne au XVIe siècle. Pour publier ces documents légués à la Bibliothèque nationale, nous trouvons encore une collaboration tripartite : le CNRS, la ville de Paris et la Bibliothèque nationale, collaboration hélas terminée par le non-remplacement des deux ingénieurs de recherche.
La volonté de remonter dans le temps pour assurer la liaison avec le Répertoire de Caron ne fut pas abandonnée : un volume 1953-1954 vit le jour en 1964 mais ce fut malheureusement le seul, l'équipe étant trop réduite face à l'inflation de la production historique qui a atteint 14 200 références en 1994 (290 % de croissance en 40 ans).
Le présent et l'avenir
Après avoir bénéficié d'un local dans différentes annexes de la BN (premier étage 65, rue de Richelieu, troisième et quatrième étages rue de Louvois), l'équipe de la Bibliographie dispose d'un bureau dans le département des Périodiques depuis le transfert de certains de ses services à Vivienne. Sylvie Postel-Lecocq, qui a fait valoir prématurément ses droits à la retraite, a été remplacée en 1990 par Brigitte Keriven, ingénieur d'études, et Brigitte Moreau, décédée en mars 1994, par Martine Sonnet, ingénieur de recherche, en avril 1995. L'Institut d'histoire moderne et contemporaine, laboratoire propre du CNRS auquel la Bibliographie a été confiée depuis 1979, doit maintenant obtenir un nouveau poste pour compenser mon départ à la retraite en juillet 1996. Le transfert de collections imprimés-périodiques de la Bibliothèque nationale de France à Tolbiac pose le problème de l'implantation sur ce nouveau site de l'équipe de la Bibliographie, problème qui est, semble-t-il, résolu par l'installation dans la Tour Tl abritant le Dl : département philosophie, histoire, sciences de l'Homme. Il serait, en effet, fort dommageable qu'une collaboration si longue et si fructueuse ne puisse être poursuivie (439 000 notices, dont 20 % de livres, relevées de 1953 à 1994).