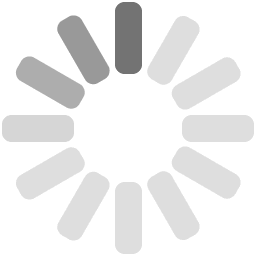Index des revues
- Index des revues
Bibliothèques et modernité
-
Albaric, Michel
Présentation, p.3-4. -
Stiegler, Bernard
Bibliothèques et modernité, p.5-9. -
Chaintreau, Anne-Marie,
Lemaitre, Renée
Images des bibliothèques à travers la littérature et le cinéma, p.12-18. -
Coutts, Margaret M.
Ah ! Mais c'est différent chez vous..., p.19-20. -
-
Bibliothèques, Communication, Publicité
-
Danset, Françoise
Présentation, p.21. -
Bony, Françoise
Presse et bibliothèques, p.23. -
Morchoven, Bernard
La communication des bibliothèques publiques , p.24-27.
-
Danset, Françoise
-
Giuliani, Emmanuelle,
Varlamoff, Marie-Thérèse
Recherche image désespérément, p.28-33. -
Taesch, Danielle
L'image de l'abf , p.35. -
Froissart, Françoise
La formation élémentaire , p.36. -
Gascuel, Jacqueline
Assemblée générale du 6 juin 2008, p.37-39. -
Pansu, Alain
Rapport financier, p.39-41. -
Motions, p.42.
Bibliothèques et modernité
Par Bernard STIEGLER, Collège International de Philosophie et Université de Technologie de Compiègne.Les images de marques sont celles de publics. Il y a plusieurs types de publics pour la bibliothèque, et autant d'images. L'image de la bibliothèque varie donc selon qu'il s'agit du chercheur, du lecteur moyen, de l'illettré, de l'entrepreneur. Et pour chacune de ces catégories, l'image se décline encore en sous-catégories selon que l'on parle de la Bibliothèque Nationale, de telle bibliothèque spécialisée, de la bibliothèque professionnelle, de la bibliothèque universitaire, de la bibliothèque municipale, etc., ou de sa propre bibliothèque personnelle.
S'il faut distinguer plusieurs types dans les images, ce que je ne ferai pas ici, il faut aussi distinguer ces types de l'imagerie sur le fond de quoi elles se détachent et prennent forme. Il y a en effet toute une histoire des bibliothèques et du rôle qu ' elles ont joué dans l'histoire, ce qui a façonné la figure générale de «la bibliothèque». Mais il ne s'agit pas là d'image «de marque»: il s'agit de représentations culturelles, propres à notre civilisation sans aucun doute, variables dans leur réception, mais bâties sur un fond invariant correspondant à une réalité historique. L'image plus profonde de la bibliothèque correspondant à ce fond invariant est ellemême liée à celle du livre, de. l'écriture et de la lecture. Je n'aurai pas le temps d'analyser ici tous les aspects complexes de cette histoire - et en fait, c'est l'histoire toute entière qui y est liée, puisqu'il n'y a pas d' histoire sans livres et sans bibliothèques: c'estpeut-êtrelapremièrechose à retenir.
La bibliothèque, nul ne pourrait le nier, est un lieu de mémoire, et l'on pourrait même dire : le lieu de la mémoire même lorsqu'elle est occidentale et donc historique et politique. Lieu de mémoire, elle est aussi celui du savoir, et celui du pouvoir.
Pouvoir anticiper : la notation des crues passées du Nil permet dans une certaine mesure aux Egyptiens de l'Antiquité de prévoir celles qui sont à venir. Ceci est encore de l'ordre de l'accumulation empirique de faits et donc de l'induction. Le savoir qu'on ne trouve qu'avec les bibliothèques est cependant de 1 ' ordre de la déduction, c'est à dire de la raison. Il n'y a pas de raison sans une certaine modalité d'accès au passé, donc d'enregistrement de ce passé : il n'y a pas de raison sans bibliothèques. C'est ainsi que Bachelard parle de «bibliomènes» de la raison (1) , comme on parle de phénomènes ou de noumènes depuis la philosophie critique. Mais plus encore que d'un savoir déductif, la bibliothèque est le lieu d'enregistrement de l'expérience humaine dans ses dimensions les plus diverses et fantastiques : ce que l'on nomme le patrimoine. Ce patrimoine a «de la valeur». Quelle valeur ? Voilà une question bien difficile ^comment évalue-t-on un patrimoine ? En principe, cette valeur est inestimable.
De tout cela ressort une image : celle d'un lieu où l'on conserve des choses précieuses, anciennes, mystérieuses, savantes et fantasques. Lieu qui valorise le passé. Lieu par où passe nécessairement la constitution d'une certaine forme de communauté, et où sont préservées ses «racines», où s'effectue son passé. Où est gardé le secret de la provenance, de 1 ' origine. Lieu de l'origine: tel est certainement le trait le plus fort de l'image profonde de la bibliothèque (en Occident).
Le rapport à la bibliothèque comme lieu de conservation du passé est pourtant complexe - et il change : la bibliothèque est aussi le lieu de l'avenir, de la liberté de l'honnête homme, de l'émancipation du groupe social. La bibliothèque qui accueille l'Encyclopédie est un haut lieu de la modernité. Conservant le passé en l'ordonnant, elle promet le futur. Des Lumières à l'époque des premières bibliothèques ouvrières, en passant bien sûr par la Révolution, l'histoire de la bibliothèque et de ses images est évidemment inséparable de celle de la socialisation du livre, c'est à dire de l'apprentissage de la lecture et de l'éducation.
Indubitablement, la socialisation du livre est le moteur essentiel de la modernité. Mais qu'est-ce que la modernité aujourd'hui, et quelle y est encore la place du livre ? Aujourd'hui, il semble que nous soyons entrés dans une phase singulièrement accrue de modernisation de notre société alors même que le livre ne semble plus y jouer le même rôle. La question qui me paraît la plus importante, pour véritablement répondre au problème qui est posé dans ce congrès, est alors la suivante : quel rôle entend jouer la bibliothèque dans un tel moment ? Quelles «images de marque» doit-elle développer d'autre part ? Je veux dire que sa politique d'image doit être déterminée par le rôle qu'elle entend jouer - mais non l'inverse. Pour y réfléchir, il faut analyser le contexte dans lequel la bibliothèque agit aujourd'hui.
J'appréhenderai ce contexte sous deux aspects, en le caractérisant massivement comme l'époque où la mémoire est devenue un champ d'activité industrielle. Cette industrialisation de la mémoire se concrétise de deux manières : tout d'abord, il s'agit de l'apparition de nouvelles technologies de la mémoire, et de nouveaux supports: les supports électroniques, analogiques et numériques. On les appelle souvent des technologies d'information. Et en effet, l'apparition de la notion d' information, qui est nouvelle et n'existait pas avec les bibliothèques traditionnelles, est le deuxième aspect de notre époque que je retiendrai.
Ces deux dimensions de la mémoire contemporaine se traduisent directement dans les bibliothèques : celles-ci deviennent des médiathèques; elles accueillent des supports de mémoire qui ne sont plus seulement livresques - et qui sont à présent, tout comme le livre d'ailleurs, des produits industriels ; elles sont devenues des lieux de recueil de 1' «information» : on y trouve des périodiques, des journaux, des banques de données, etc., et divers supports d'information rassemblés dans les «salles d'actualité».
Tout ceci semble correspondre à la fin d'une hégémonie du livre dans la constitution de la mémoire et du temps publics en Occident - au moment même où l'Occident est devenu mondial. Cela exigerait, tout aussi bien, une redéfinition de la place de la bibliothèque elle-même, une transformation de sa mission, de sa matière, de ses compétences et de ses publics.
De ce qui a été dit plus haut quant à l'image historique de la bibliothèque, il ressort que la question de son devenir est au coeur d'une problématique du temps public. A mon sens, cette problématique se rejoue au sein d'un conflit qui se tient dans le contexte d'une industrialisation de la mémoire. C'est de cette industrialisation et de ce conflit que je veux vous parler. L'image que je chercherai à figurer procéderait donc de deux origines : celle du passé, de la bibliothèque avec son histoire prestigieuse et son rôle moteur dans nos sociétés ; celle du présent et de son futur, et qui altèrerait ce rôle en affectant la place du livre en général. C'est entre ces deux données que se tiendrait un conflit à «surmonter». Les diverses «images de marque» possibles en seraient les conséquences incertaines, variables, soumises aux aléas de la modernisation accélérée à laquelle nous assistons.
Le nouveau contexte économique de la mémoire et ses incidences
L'information est une notion récente qui apparaît au XIXe siècle avec la télégraphie. Trace plus ou moins éphémère, sa valeur est essentiellement déterminée par le temps, et c'est ainsi qu'elle se distingue radicalement du savoir et des oeuvres : il serait absurde de dire que les Eléments d'Euclide, un dialogue de Pla-ton, un traité de Newton, un poème de Goethe ou un roman de Flaubert ont perdu ou gagné de la valeur avec le temps.
(En ce sens, la définition de la valeur de l'information selon la théorie dite «de l'information» ne peut ainsi rendre compte de ce qu'est le savoir. Si l'on y définit la valeur informationnelle d'un signe par son «improbabilité», celle-ci y est essentiellement provisoire et saturable : l'«informativité a posteriori» du signe dit «improbable» est un épuisement de cette improbabilité, la consommation du caractère événementiel de l'«événement» informatif. C'est à dire que par principe l'information n'est pas répétable. C'est exactement ce qu'est au contraire le savoir : par principe il doit être répété et ne s'épuise jamais dans ses répétitions - mais s'y différencie).
Corrélant temps et valeur, étant par là essentiellement une marchandise, l'information ouvre une nouvelle forme de temporalité, où le passé se dévalorise parce qu'il devient consommable et épuisable. Sa valeur est calculable, estimable (à la différence de celle du patrimoine, «inestimable» et en ce sens, «intemporelle»). Produit industriel diffusé par des réseaux de communication, l'information appartient au vaste secteur des industries de la mémoire. Par mémoire, je ne désigne pas seulement les traces conservées: tout ce qui, industriellement produit, vient s'inscrire de façon plus ou moins durable dans une mémoire quelconque, machinique ou vivante, relève des industries de la mémoire : une information diffusée massivement sur un réseau public est un produit des industries de la mémoire dans la mesure où elle vient impressionner (les mémoires de) ses destinataires et en constitue un «réfèrent» commun.
Les industries de la mémoire, dans la mesure où l'on y inclut aussi bien le matériel analogique et numérique de collecte, de stockage, de traitement et de diffusion que les traces analogiques et numériques recueillies, conservées, traitées et diffusées, constituent aujourd'hui le secteur de pointe de l'activité économique mondiale, autant par la vente de matériels, de programmes audiovisuels et de produits logiciels et éditoriaux, que par le trafic des données brutes. (Le secteur des traces littérales pour une très grande part s'y intègre, s'y redistribue et y redéfinit ses finalités). Elles prennent la place que l'industrie lourde occupait au XIXe siècle.
Les réseaux, de l'actualité sont des éléments essentiels du vaste dispositif par lequel la production de la mémoire est devenue marchande, quotidienne et mondiale. Utilisant massivement les technologies électroniques de communication, ils travaillent à la vitesse de la lumière parce que l'actualité et l'information sont des marchandises dont la valeur est fonction du temps. L'accès à ces réseaux est rendu possible par des interfaces de toutes sortes. Les produits qu'ils transportent doivent être diffusés massivement : en 1985, en France, 99 % des ménages étaient équipés d'une radio, 93 % d'un téléphone, 92 % d'une télévision. Avec le Minitel, qui remplacera bientôt le téléphone, et atteindra donc rapidement le taux d'équipement maximum, ce sont les données numériques qui pénètrent le marché de masse.
Une telle diffusion massive implique la concentration industrielle des moyens de production : le coût d'une image de télévision est tel qu'il faut pour l'amortir en assurer la diffusion vers des millions de destinataires. Ainsi, quelques agences d'images d'actualités télévisées fournissent l'ensemble des chaînes mondiales, raison pour laquelle il est courant de voir les mêmes séquences diffusées par exemple sur les chaînes CBS, américaine, et Gorizon, soviétique (seuls les commentaires diffèrent : les images peuvent être achetées à une agence ni américaine, ni soviétique, mais par exemple anglaise, telle Visnews). La multiplication des chaînes donne l'illusion d'une diversification de l'information, mais c'est au stade du très petit nombre des producteurs de matière première de la mémoire collective (les agences) que se fait la sélection de V événementialisable. Le temps (et d'abord comme présent) est ici le fruit d'une véritable fabrication résultant de ce que l'on appelle la «couverture» des événements.
Cette mémoire, en tant que flot perma-ment, s'efface nécessairement à mesure qu'elle se produit : «une information chasse l'autre». Elle a pour principe son propre oubli massif et immédiat. Cela tient à la périssabilité essentielle de l'information.
Dès 1830, avec la création du réseau télégraphique, et la possibilité de contrôle des temps et des espaces de transmission de l'information, celle-ci apparaît constituer une valeur marchande qui sera exploitée par l'agence Havas. On comprend très bien que l'information est ce qui n'a de la valeur que parce qu'elle la perd quand on connaît l'origine du monopole des télécommunications en France (1837) : des boursiers ayant constaté que la variation des valeurs de titres sur la place de Bordeaux suivait celle de Paris avec retard, ils investissent dans une ligne télégraphique privée entre Paris et Bordeaux. Ils gagnent ainsi beaucoup d'argent et tout en déséquilibrant le marché bordelais inventent la notion d'information.
Une information est donc ce dont la valeur est liée au temps de diffusion. Moins elles est connue plus elle est une information. Cela se traduit directement par ce constat que je puis faire chaque jour : mon journal qui ce matin vaut cinq francs ne vaudra plus rien demain. C'est pourquoi les agences de presse, qui sélectionnent ce qui mérite le statut d'information, et qui fabriquent ainsi notre présent, qui se sont créées en même temps que les réseaux de diffusion rapide, consacrent actuellement tous leurs efforts à diminuer les temps de transmission et de traitement- lequel doit donc être automatisé.
Parce que les critères de la sélection par élimination des événements que pratiquent les agences de presse sont essentiellement marchands, ces organismes sont des machines à produire des idées toutes faites, ou «clichés». Le procédé du cliché, inventé par Havas vers 1877, permet à la fin du siècle dernier d'expédier aux journaux de province, en plus des dépêches transmises par télégraphes, des articles tout rédigés dans lesquels les journalistes peuvent insérer leurs propres phrases afin de donner au lecteur le sentiment qu'il reçoit une information «de première main».
L'information doit être «fraîche» et c'est pourquoi l'idéal de la presse est la suppression de tout retard dans les transmissions. De la même manière, l'actualité boursière récente demeure incompréhensible si l'on ne tient pas compte de la transmission mondiale et immédiate non seulement des informations financières, mais des discours qui les accompagnent et des effets profondément irrationnels qu'ils déclenchent du fait même qu'ils ne peuvent être lus et interprétés que dans l'immédiateté - et ils sont entièrement construits en fonction d'un tel horizon : ce sont des énoncés anticipateurs complètement soumis à cette «chrono-logique» qui est aussi bien une techno-logique de l'économie.
Dans un tel contexte informationnel, ce sont les notions de traitement en «temps réel» et de transmission «en direct» qui dominent.
Le nouveau contexte culturel et ses incidences
L'information, notion et réalité nouvelles, pénètre aujourd'hui la bibliothèque. Il est dès lors essentiel de remarquer que sa valeur, ou plus exactement son évaluation, ne correspond pas du tout à ce qui caractérise les traces de mémoire conservées dans les fonds patrimoniaux des bibliothèques, lesquels ne sont pas «consommables», leur valeur n'étant pas «épuisable». Comment articuler les fonds patrimoniaux de la bibliothèque à ces fonds de commerce que sont en fin de compte les sources d'information ? Et faut-il souligner la différence, et affirmer par là une spécificité de la bibliothèque, ou bien au contraire se soumettre à un nouveau mode d'être - industriel et marchand - de la mémoire et du temps. Telle serait la première question. Il y en a une seconde : l'information est apparue, je l'ai dit, avec de nouveaux supports de la mémoire, lesquels ne sont pas seulement informationnels, bien qu'ils appartiennent aux industries de la mémoire qui sont aussi les industries de l'information. On ne peut pas penser 1 ' intégration de ces nouveaux supports de mémoire, non-livresques, dans les fonds de la bibliothèque, sans développer une réflexion sur les conditions dans lesquelles on peut accéder à leurs contenus.
L'accès à la mémoire technologique analogique ou numérique se fait par des interfaces disposées en entrée et en sortie des réseaux d'information, ou utilisées pour décoder des supports de toutes sortes (microsillons, bandes magnétiques audio et vidéo, disquettes, disques laser, disques compacts, par exemple). Ces interfaces suscitent, par rapport à l'écriture en tant que condition du savoir rationnel selon Husserl (2) , une véritable «décommunautisation». C'est ce que je voudrais expliciter à présent en quelques mots.
La «communautisation» par l'écriture est essentielle au savoir rationnel en tant qu'il suppose l'existence d'objets idéaux. Cela concerne d'abord, chez Husserl, le savoir scientifique, et en premier lieu géométrique, mais à lire un récent ouvrage de Marcel Detienne, Les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne, on pourrait montrer que ce l'est tout autant du savoir politique, du savoir éthique, bref du savoir-vivre selon les idéalités occidentales en général. Une telle communautisation repose d'ailleurs, depuis le XIXème siècle, sur une socialisation techno-logique obligatoire qui est le passage par l'école : l'écriture est une technologie de la mémoire.
Plus précisément, l'écriture alphabétique est la technologie littérale de la mémoire. Nous sommes enclins à l'oublier: nous avons fait de cette technique, en tant qu'occidentaux, notre seconde nature, tandis que nous avons par ailleurs tendance à ne voir de la technologie que là où sont visibles des appareils matériels - ce qui signifie que nous sommes dominés par une compréhension étroite de ce qu'est la technique en général.
La technologie littérale a toutefois des caractéristiques bien différentes des technologies analogiques et numériques électroniques. En particulier, elle suppose que le destinataire d'un énoncé littéral dispose d'une compétence de lecture et d'écriture. De ce point de vue, il est luimême un appareil, il est «appareillé» : il accède de lui-même au contenu d'un enregistrement littéral à condition d'avoir passé de nombreuses années à instrumentaliser et en quelque sorte à machiniser le fonctionnement de sa mémoire, s ' étant lui-même et pour lui-même transformé en une sorte d'instrument de lecture. Au contraire, avec les technologies analogiques et numériques, les fonctions d'encodage et de décodage sont déléguées à des machines. Autrement dit, dans la technologie littérale, le destinateur d'un énoncé est aussi l'encodeur de cet énoncé, et le destinataire en est le décodeur. Avec les technologies analogiques et numériques, destinateur et destinataire ne coïncident pas avec encodeur et décodeur.
Qu'est-ce que cela implique quant à la lecture (et à l'écriture) de la mémoire analogique et numérique ? Dans quelle mesure est-elle comparable et incomparable avec la lecture (et avec l'écriture) de la mémoire littérale ? De fait, lorsque la mémoire collective devient analogique ou numérique, les relations entre les énoncés, les destinateurs, et les destinataires de cette mémoire se transforment sensiblement. En premier lieu, le public de la mémoire analogico-numérique peut se dispenser de toute formation spécifique à ces formes de mémoire (et peutêtre, au delà, de ce l'on appelait une Bildung), à l'inverse de ce qui caractérise la bibliothèque qui accueille les énoncés de la technologie littérale de la mémoire. Avec les premiers instruments analogiques, tel le premier phonographe d'Edi-son, les fonctions enregistrement (saisie, encodage) et «lecture» (réception, décodage) sont encore intégrées. Puis elles tendent à se séparer avec le déploiement des réseaux : d'un côté les appareils de la saisie, de l'autre ceux de la réception. Ces deux pôles correspondent à ce qui se tient aux deux extrémités d'un réseau : d'un côté les producteurs industriels, de l'autre les consommateurs. Si, comme je l'ai suggéré plus haut, le flot continu de l'information, éternel présent, fabrication industrielle du temps, développe un véritable consumérisme de la mémoire, celui-ci est renforcé par ce que une sorte de délégation du «savoir-lire» et du «savoir-écrire» dans les machines. Parce qu'on n'accède à un réseau ou à un enregistrement quelconque, en tant que consommateur, que par l'intermédiaire d'un organe de sortie ou de décodage, la lecture des traces analogiques et numériques de la mémoire suppose que le destinataire possède un appareil de lecture. Lorsqu'il s'agissait des traces écrites, l'appareil lecteur était le destinataire luimême : alphabétisé, il intériorisait la technique du déchiffrage, et du même coup du chiffrage, sous la forme d'une compétence acquise à l'école, d'un savoir au sens propre. Avec les technologies, la «compétence» est devenue le pouvoir d'achat. Elle n'est plus politique (ce qu'est toujours le savoir dans le monde occidental) : elle est économique. La relation de réciprocité minimum qu'entretenaient le lecteur d'un texte avec l'auteur de ce texte, à savoir la nécessité pour les deux de partager une compétence techno-logique (celle de la technologie littérale), est rompue. C'est en ce sens que les technologies analogiques et numériques favorisent un processus de «décommunautisation» - c'est à dire de désocialisation et de consumérisation. Pourtant, cette situation ne me paraît pas pleinement rendre compte de ce que peut signifier une lecture de la mémoire analogique et numérique. Autrement dit, décodage et encodage ne recouvrent pas ce que signifient lecture et écriture, non seulement dans le domaine de la technologie littérale, mais aussi dans ceux des technologies analogiques et numérique - même sices dernières en donnent l'illusion, ce qui rend possible un accès à la mémoire analogico-numérique sans savoir: de fait et pour prendre un exemple, le public actuel d'une médiathèque peut accéder à de tels fonds pourvu que soient mis à sa disposition des appareils de «lecture» (de décodage) sans qu'il dispose nécessairement et du même coup d'une capacité d'écriture analogique et numérique - ce qui n'est pas possible avec la technologie littérale où savoir lire, c'est aussi savoir écrire.
On peut alors se demander : une véritable lecture de la mémoire analogique et numérique ne serait-elle pas fondée dans la possibilité ouverte de son écriture, ouverture qui en constituerait le seul horizon authentique ?
Quoi qu'il en soit, le public des fonds analogiques et numériques de la bibliothèque peut de fait rester un simple consommateur d'énoncés de mémoire collective.
Imaginons un lecteur qui se rend à la Bibliothèque Publique d'Information : il parcourt les fonds livresques, y sélectionne divers textes ; il s'installe sur une table de travail, sort de son sac un cahier et un stylo, copie et commente les phrases qui l'intéressent, annote, bref : il lit en écrivant. Le seul fait qu'existe lapossibi-lité de l'écriture à partir de la lecture détermine la forme même de la lecture, quoi qu'il en soit de l'actualisation effective de cette possibilité.
Imaginons maintenant le même lecteur allant consulter le fonds de vidéothèque de la BPI. Il emprunte une bande, ainsi qu'un appareil de lecture ; il regarde le film. Et il en reste là. Il n'a en aucun cas la possibilité de dupliquer une séquence, d'y insérer ses propres annotations vidéographiques, bref, d'écrire (vidéo-graphiquement) sa lecture. Il ne lit donc pas pleinement, du moins au sens suggéré plus haut.
C'est encore la question du savoir qui est sous-jacente à celle de la lecture et des technologies d'enregistrement de la mémoire, parallèlement à ce que j'ai tenté de montrer plus haut quant à la relation savoir/information.
Devant la nécessité d'améliorer la gestion des établissements, les critères d'élaboration des fonds tendent aujourd'hui à se plier aux lois de la mémoire informationnelle : ainsi, il devient courant et normal d'éliminer des fonds les ouvrages qui sortent moins d'une fois par an. L'inflation des supports l'exige. Mais c'est peut-être entrer en contradiction avec le sens même de ce que représente la bibliothèque : un lieu où sont préservées des traces dont la valeur n'est pas actuellement calculable, estimable, qui est d'autant plus grande qu'elle peut ne se révéler qu'après-coup, qu'avec un retard essentiel, que dans un temps différé de la mémoire qui est aussi sa chance et l'avenir du passé (différemment et différenciation du temps différé à quoi s'opposent aujourd'hui le «temps réel» et le «direct», mentionnés plus haut comme spécifiques de la mémoire informationnelle). Le problème que je ne fais ici qu'évoquer touche autant le milieu éditorial, totalement soumis, aujourd'hui, aux impératifs de la rotation des stocks, ce qui tend à éliminer a priori les chances d'édition des ouvrages ne garantissant pas un minimum de diffusion annuelle. Cependant, à l'évidence, il est nécessaire que les bibliothèques s'adaptent à leur temps : elles doivent intégrer l'information et ses critères de valorisation et de dévalorisation, son caractère essentiellement éphémère ; elles doivent accueillir les nouveaux supports. Mais à quel prix? Peut-être faudrait-il inventer de nouveaux rapports à ces supports comme à l'information (c'est ce que tentait modestement d'illustrer, de la façon la plus libre, l'exposition Mémoires du futur). Non seulement subir la modernisation, mais l'agir : les développements technologiques de la mémoire recèlent des possibilités inouïes, auxquelles il n'a pas encore suffisamment été porté attention du point de vue des bibliothèques, c'est à dire : dans une certaine indépendance par rapport aux seuls impératifs informationnels (3) . Défendre une certaine idée de la mémoire - y compris lorsqu'elle n'est pas livresque : peut-être cette idée que la mémoire véritable est celle qui préserve l'incalculable. Et dans ce cas il ne s'agit pas seulement de répondre aux injonctions présentes énoncées par notre époque industrielle, même s'il faut absolument les entendre et les prendre en considération.
La bibliothèque est peut-être à un moment critique de son histoire où elle doit produire son image, une nouvelle image, une image de marque se démarquant des images toutes faites et intégrant la complexité d'une situation où, avec l'industrialisation du temps lui-même, ce n'est pas moins que l'avenir en tant que tel qui est en jeu - à travers le rapport au passé, y compris ce passé immédiat que constituent «les informations». Une telle image devrait aussi savoir rappeler que la bibliothèque est le plus ancien lieu technologique de la mémoire : qu'elle a dans ce domaine un grand savoir. De nouvelles données technologiques de la mémoire, qui sont aussi économiques et politiques, apparaissent, en fonction desquelles il faut agir. Nous sommes dans une époque charnière de la modernisation technologique : des prises de conscience s'opèrent de ce qu'elle ne peut être seulement guidée par les impératifs économiques, de ce qu'un véritable saut culturel est à accomplir, qui est aussi bien l'invention d'une nouvelle économie politique de la mémoire - une forme de communauté (ou de «communautisation») àconstruire.
Je crois profondément que c'est dans un tel horizon, selon une telle perspective que la question de l'image de marque des bibliothèques doit être posée et résolue. Dans ce contexte essentiellement complexe, l'«image de marque» que devrait promouvoir la bibliothèque serait offensive, grosse de la conscience d'être au coeur même des enjeux de ce temps et «moderniste», tout en se différenciant fortement d'une appréhension simpliste de cette modernité-là - tout en affirmant la nécessité et donc l'avenir de la tradition irremplaçable qu'elle représente aussi.
On ne peut échapper, aujourd'hui, à la nécessité de développer des images de marques : nous sommes dans le monde du marché. Toutefois, les images de marques sont censées répondre à des demandes sociales. Or, je suis dubitatif quant à cette notion. Je ne crois pas que les gens demandent quoi que ce soit. Lorsque le XIXème siècle imposa l'instruction publique à tout futur citoyen, il n'y avait pas à cet égard de «demande sociale» à proprement parler - même s'il existait une attente qui ne prenait pas la forme d'une demande, qui, le plus souvent, s'ignorait même profondément, à l'exception de ceux qui, militants et révolutionnaires, «prenaient conscience». Le rôle d'un établissement public culturel n'est pas seulement, n'est même peutêtre surtout pas, de répondre à des demandes, mais de libérer et même de susciter de nouvelles attentes. Le rôle d'un tel établissement inventif et créateur doit se définir dans une relative autonomie à l'égard des seules lois du marché - sans ignorer les dépendances qu'elles imposent aussi : mais on sait aujourd'hui que dépendance et autonomie ne sont pas contradictoires.
2. Husserl, L'origine de la géométrie, PUF. retour au texte
3. Sur ce sujet, on peut lire un article de Maria Perniola, "Viril/alité et perfection publié dans la revue Traverses na 44-45 après que fut prononcée cette conférence. retour au texte