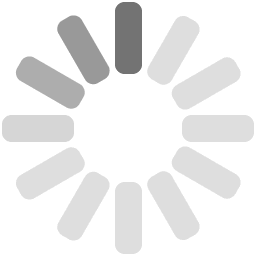Index des revues
- Index des revues
Le public libraires act de 1850
-
Rosenthal, Joseph A.
Les murailles s'écroulent , p.6-11. -
Cooper, Kenneth
Gérer le changement dans les bibliothèques nationales, p.12-13. -
Sturges, Paul
Le public libraires act de 1850 , p.14-19. -
Nwafor, Bart U.
Le financement des bibliothèques universitaires du tiers monde , p.20-23. -
Geh, Hans Peter
La 55e conférence de l'ifla , p.24-26. -
Boisard, Geneviève,
Bourdon, Françoise,
Jacquet, Françoise,
Rouit, Huguette
Programme professionnel, p.27-31. -
Une stagiaire
En revenant de l'expo..., p.33. -
Thill, André
A la manière d'Emile Zola..., p.34-37. -
Saby, Frédéric
Les français et l'ifla , p.38-39.
Le Public libraires act de 1850
Fruit d'une étude comparée des bibliothèques en France er en Angleterre
Par Paul Sturges, Department of Library and Information Studies, Loughborough University (Grande Bretagne| j e 24 août 1848, Edward Edwards, catalogueur à la Bibliothèque du British Museum, reçut une lettre de William Ewart, parlementaire radical connu pour ses campagnes contre la peine capitale. Ewart lui offrait de collaborer avec lui sur un projet de loi visant à créer un système de bibliothèques publi- ques, en Angleterre et au Pays de Galles. Bien qu'elle fût le premier jalon d'une importante coopération, cette lettre n'était pas le premier contact entre les deux hommes. Ewart était connu pour son habileté à faire passer ses projets de loi dans les domaines culturels et sociaux ; ainsi, il avait présidé la Commission d'en- quête des Arts et Métiers. Edwards s'était intéressé au travail de cette commission car il était l'un des fon- dateurs de l'Art Union de Londres, organisation créée dans le but de promouvoir les métiers d'art. Ewart participa au travail accompli par l'Art Union et les deux hommes prirent conscience du fait qu'ils partageaient le même intérêt pour le financement par l'Etat d'établissements culturels et éducatifs.
Edwards, ancien maçon et autodi- dacte, était intimement persuadé de la valeur et de l'importance des bi- bliothèques et il devait exprimer quelques-unes de ses idées dans une brochure publiée en 1836, A Letter to Benjamin Hawes (1) . Ewart croyait lui aussi au potentiel éducatif des bibliothèques en accès libre. Il avait donc présenté des motions au Parle- ment sur cette question, en 1840 et en 1844. A l'époque où Ewart écrivit sa lettre, Edwards venait de publier ses Remarks on the paucity of libraries freely open to the public, ainsi qu'un article dans le Journal of the Statisti- cal Society ofLondon. Dans ces deux publications, il présentait un nombre considérable d'arguments en faveur de son projet sur les bibliothèques publiques (2) . Pour faire avancer leur projet au point de vue législatif, Ewart proposa de favoriser la création d'une commission d'enquête chargée d'étu- dier la question des bibliothèques publiques. Il déclara : «On pourrait présenter à la Commission des té- moignages sur le nombre de biblio- thèques existant à l'étranger et en Grande-Bretagne, les possibilités à l'étranger et les difficultés chez nous, la meilleure façon d'établir, de sou- tenir et de mener à bien l'établisse- ment de bibliothèques et, s'il était favorable, le rapport de la Commis- sion pourrait entraîner une action du gouvernement lors d'une session ultérieure.» (3) Edwards accepta avec joie l'offre d'Ewart et les deux hommes commencèrent avec beau- coup d'enthousiasme à échanger idées et informations.
Toute idée que la Commission d'en- quête proposée devienne un lieu de débat neutre destiné à examiner une proposition entraînant une action du Parlement devait être rapidement écartée. Ewart savait d'expérience qu'une manipulation habile des membres d'une commission et les témoignages présentés pouvaient donner à la cause une apparence particulièrement importante et im- pressionnante, entraînant ainsi les mesures législatives attendues. Le travail d'organisateur accompli par Edwards à l'Art Union (malgré des difficultés financières embarrassan- tes) et la publication de sa brochure sur la situation des bibliothèques publiques faisaient de lui un mélange idéal de chercheur, de témoin éclairé et de partisan. Ewart agissant au sein du Parlement et Edwards au dehors, les deux hommes avaient toutes les qualités requises pour se servir au mieux de la Commission d'enquête qui fut finalement constituée. Sa première séance eut lieu le 30 mars 1849.
La Commission était présidée par Ewart lui-même ; elle se composait de quinze membres dont les plus éminents étaient les radicaux Joseph Brotherton, James Kershaw et R. A. Thicknesse. Bien qu'il ne participât aux travaux que par intermittence, le futur Premier ministre, Benjamin Disraeli, en faisait également partie. On convoquait des témoins qui four- nirent des informations sur d'autres bibliothèques existantes, ainsi que sur les besoins des auteurs et des autres catégories de lecteurs.
Les conclusions de la Commission furent publiées en 1849 et en 1850 sous le titre : Report from the Select Committee on Public Libraries. Ce document servit alors de base à la loi sur les bibliothèques publiques. Edwards fut le témoin le plus émi- nent et, naturellement, il déclara que les bibliothèques publiques contri- buaient au développement des popu- lations qui étaient ainsi plus instrui- tes et mieux informées.
Ce constat fut considéré comme plus ou moins évident. Sa déclaration portait essentiellement sur le fait que la Grande-Bretagne était très en re- tard dans le financement de ses bi- bliothèques, surtout si on comparait sa situation à celle d'autres pays européens que l'on pouvait considé- rer comme ses rivaux. Comme Edwards l'avait dit dans d'autres circonstances : «Non pas que je considère qu'il soit vraiment néces- saire d'utiliser cette comparaison pour montrer qu'on a besoin d'augmenter le nombre des bibliothèques publi- ques dans notre pays - inutile de démontrer le bien- fondé d'une telle proposition - mais l'utilité des bi- bliothèques publiques étant incon- testable, une telle comparaison pour- ra nous aider à faire ressortir le pro- blème et à le considérer d'un point de vue pratique.» (4)
Dans sa déclaration, Edwards défi- nissait les bibliothèques publiques comme «comprenant avant tout les bibliothèques financées entièrement ou en partie par les deniers publics ; et j'étendrai cette définition aux bi- bliothèques ouvertes au public, à quelque degré que ce soit». (5) Cette définition particulièrement vague ne fait pas ressortir que c'est l'accès de tous aux collections générales de lit- térature à des fins éducatives et cul- turelles, vues dans leur sens le plus large, qui caractérise une bibliothè- que publique, plutôt que la source de son financement. Dix ans plus tard, dans son ouvrage monumental, Memoirs of Libraries, Edwards défi- nissait ce qu'Ewart et lui-même avaient tenté d'obtenir en 1849 : «Les bibliothèques publiques doivent contenir une bonne proportion de livres susceptibles de plaire à des personnes ayant peu ou pas d'ins- truction, des livres destinés à l'homme d'Eglise, au marchand, à l'homme politique et à l'érudit qui les utilise- ront autant pour leurs études que pour satisfaire d'autres intérêts. Elles doi- vent être ouvertes à tous. Elles doi- vent offrir à tous les hommes non seulement un accès aux sciences pratiques, aux divertissements et aux idées du moment, mais aussi un ac- cès à la sagesse des générations pré- cédentes, aux trésors de l'Antiquité ainsi qu'aux espoirs et aux signes visibles du monde futur.» (6)
Pourtant, il est possible que cette vague définition ait été choisie avec une intention très précise. En utili- sant une définition fondée sur le fi- nancement public et une autre subsi- diaire fondée sur l'accès libre, Ed- wards pouvait montrer que Londres ne possédait pratiquement pas de bibliothèques publiques, sauf celle du British Museum, et que le reste du pays était encore plus mal loti. Cette définition servait à démontrer que les établissements d'Europe étaient nombreux et la quantité de livres accessibles au public plus abondante que partout en Grande-Bretagne. On peut voir d'après un exemple la manière détaillée dont les témoigna- ges furent utilisés à cette fin. Le cas de la France et, en particulier, celui des provinces françaises constitue un choix intéressant et approprié.
Parlant des provinces françaises, Edwards montra qu'il y avait, par- tout dans le pays, un grand nombre de bibliothèques municipales, riches en manuscrits médiévaux, incuna- bles et éditions rares. Il affirmait que non seulement ces bibliothèques étaient richement dotées mais qu'el- les étaient aisément accessibles à tous, pour la consultation et le prêt. Pour appuyer cet argument, le témoignage de François Guizot fut particulière- ment précieux. Sous le règne de Louis-Philippe, cet homme d'Etat distingué occupa plusieurs postes dont un long passage au ministère de l'Instruction Publique où il fut res- ponsable des bibliothèques. Guizot témoigna que les bibliothèques fran- çaises étaient «largement accessibles tant pour la lecture que pour le prêt. Je ne puis garantir qu'une telle situa- tion existe dans chaque bibliothèque publique française, mais je suis sûr que dans la plupart des cas, les bi- bliothèques sont ouvertes à tous ceux qui viennent lire, et les livres sont prêtés à tous les citoyens connus dans la ville, qui ont une recommanda- tion, ou dont le nom et le style de vie sont connus du bibliothécaire.» (7) Toujours selon lui, un travailleur ayant une recommandation appro- priée pouvait emprunter la plupart des ouvrages du fonds, et les person- nes connues et instruites pouvaient emprunter les livres rares et précieux; mais un mendiant en guenilles pou- vait rencontrer quelques difficultés.
L'exemple de la France et des autres pays fut présenté de manière à don- ner l'impression générale que la Grande-Bretagne manquait d'instal- lations de valeur, lesquelles au con- traire existaient en abondance sur le continent européen. Cette impression correspondait-elle à la réalité ? Res- tons dans l'exemple donné : les bi- bliothèques françaises ainsi décrites étaient-elles bien une source d'ensei- gnement et de culture pour toute la communauté, ainsi que cette démons- tration souhaitait le faire accroire ? Il semble que la réponse soit non. L'ori- gine et la nature même des collec- tions étaient à la racine du problème car, pour l'essentiel, elles étaient le fruit des confiscations opérées par la Révolution dans les bibliothèques de la noblesse et de l'Eglise, et elles restaient propriété de l'Etat.
Noë Richter l'exprime ainsi : "Les bibliothécaires des Municipales, se considérant avant tout comme les gardiens d'un trésor national, se sentent au service de l'Etat avant d'être à celui des communautés loca- les. Ils s'intéressent assez peu aux besoins des habitants et se consa- crent avant tout à la conservation de leurs collections et à la recherche. Pendant toute la durée du XIXe siè- cle, les bibliothèques municipales se sont fort peu souciées de la lecture publique." (8) Non seulement la na- ture même de leurs abondantes col- lections historiques et les salles im- posantes dans lesquelles elles étaient abritées tendent à décourager le lec- teur ordinaire non cultivé, mais «en interdisant strictement le prêt des ouvrages et en instituant des heures d'ouverture malcommodes, ces bi- bliothécaires déniaient aux classes ouvrières l'accès à leurs établisse- ments". (9)
Il ne semble pas qu'il existe de nombreux documents à l'appui des sommes que les villes dépensaient pour enrichir et entretenir les collec- tions de leurs bibliothèques, mais les quelques éléments dont on dispose donnent à que ces sommes étaient minimes. En 1837, dans son rapport, Alexandre Buchon, inspecteur des Archives et des Bibliothèques dit des plus petites villes qu"'elles négligè- rent et oublièrent de faire les dépen- ses nécessaires au paiement du bi- bliothécaire et à l'entretien régulier de l'ancien fonds". (10) En 1853, le ministre de l'Instruction Publique di- ligenta une enquête dont les résultats furent publiés en 1857 sous le titre : Tableau statistique des bibliothèques et des départements. La publication montra que les douze bibliothèques les mieux dotées disposaient d'un budget de 58000 francs pour le "ma- tériel" et que les 328 autres se parta- geaient un total de 132000 francs (c'est-à-dire une moyenne de 400 francs par établissement). Ce chiffre comprenait en fait 21 bibliothèques qui n'avaient aucun budget pour le "matériel". En étudiant en quoi con- sistait le poste réservé à ces achats, nous découvrons qu'il n'était pas seulement destiné aux livres, mais aussi à l'éclairage, aux catalogues, à l'entretien et à la reliure.
Presque partout, le budget d'acquisi- tion des livres était pratiquement inexistant. Dans les années 1830, sous l'impulsion de Guizot, le gouverne- ment subventionna la publication d'une certaine quantité de livres considérés comme d'importance scientifique. On en distribuait des exemplaires aux bibliothèques et, fréquemment, ces dons officiels dépassaient le nombre des ouvrages achetés par la bibliothèque. Ils ne convenaient sans doute pas toujours très bien, mais c'était au moins une façon d'augmenter des collections qui, sans cela, seraient restées au point mort. Une ordonnance de 1839 avait confié la responsabilité du choix des acquisitions à un Comité d'ins- pection de la bibliothèque et d'achat des livres : présidé par le maire, il comprenait des membres nommés par le ministre de l'Instruction Publi- que. Le bibliothécaire n'avait offi- ciellement pas le droit d'y participer et, par conséquent, n'avait que peu d'influence sur le choix. Les biblio- thécaires employés par les villes étaient, dans le meilleur des cas, des érudits locaux dont l'enthousiasme pour la littérature et l'histoire était utile au lecteur. Dans le pire des cas, il y eut des nominations carrément inadéquates.
Bien sûr il existait en France des bibliothèques municipales qui fonc- tionnaient selon la manière décrite devant la Commission d'enquête. A Troyes, par exemple, l'abbé Henri- Rémi Hubert, bibliothécaire de 1826 jusqu'à sa mort en 1842, était un érudit qui légua à la bibliothèque les 9 000 volumes de sa collection per- sonnelle. Il était très en avance sur son temps. "Dans la bibliothèque même, il se préoccupa de l'accueil des jeunes, du prêt libéral, des heures d'ouverture larges, autant de bons principes de bibliothéconomie cou- rants, mais alors vraimentneufs." (11) Dès 1841, il affirmait que "la jeu- nesse studieuse y trouverait des res- sources, des conseils pour la diriger dans ses études et la préserver de mille et un travers". (12) Pourtant, sous la direction de son successeur, Auguste Harmand, la bibliothèque s'écarta quelque peu de cette politi- que et, en 1846, un arrêté municipal supprima le prêt des livres, sauf pour les professeurs et les chercheurs connus. Il semble qu' Harmand était plus intéressé par la recherche, pu- bliant en 1855 le Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Troyes. En dépit des efforts consen- tis dans les années suivantes pour favoriser la lecture publique dans la bibliothèque, elle était devenue à la fin du siècle "une sorte de "musée" de livres anciens ". (13) Il est proba- ble en effet que la Bibliothèque bleue de Troyes (livres de colportage pu- bliés dans la région) contribua beau- coup plus, au cours des années, à faire avancer la lecture publique que la Bibliothèque municipale de Troyes.
Il suffit de lire attentivement les documents de la Commission pour se rendre compte que le cas de Troyes est atypique. Guizot admet que "Dans certaines villes, les bibliothèques sont pratiquement fermées, personne n'y va pour lire et elles n'ont pas de crédits" et "les services offerts par les bibliothèques sont très supérieurs à la demande". (14) Le rapport con- tient aussi une lettre d'un chercheur, le comte Libri, qui se fonde sur ses nombreuses visites aux bibliothèques françaises où il cite le rapport de 1840, rédigé par Ravaisson, inspec- teur des archives et bibliothèques. Libri affirmait que "Les bibliothè- ques de province, généralement à la charge des municipalités, ont dans beaucoup d'endroits atteint un état de décrépitude totale et la plupart d'entre elles ont souffert du pillage" (15) . (Conclusions pleines d'ironie, puisqu'on apprit plus tard que Libri était un grand pilleur de bibliothèques.) Sa communication faisait aussi ressortir un point impor- tant : "Mon expérience m'a montré qu'onne devrait jamais essayer d'ou- vrir au grand public les bibliothèques destinées à l'élite." (16)
Les statistiques d'Edwards et les arguments qui en dérivaient ne pas- sèrent pas sans discussion. Une série d'articles parus dans l'Atheneum, et signés Verificator, les attaquait avec un enthousiasme perfide. Bien qu'Ed- wards ait eu la bonne grâce de recon- naître les carences de ses statistiques concernant les bibliothèques françai- ses, il essaya encore de tourner la situation à son avantage en préten- dant que la totale liberté d'accès de certaines bibliothèques rendait inuti- les les formalités permettant de gar- der des traces des transactions (17) . En 1850, la Commission d'enquête fut à nouveau convoquée afin d'en- tendre d'autres arguments et, du nouvel interrogatoire d'Edwards, il ressortit plus clairement qu'aupara- vant qu'il tenait presque toutes ses informations de sources imprimées et de sa correspondance personnelle. En dehors de Paris, la seule biblio- thèque européenne qu'il eut visitée était celle du Havre. Malgré cela, Edwards et Ewart s'arrangèrent pour que l'impression dominante laissée par les exemples donnés dans le rapport (Report of the Select Com- mittee) soutienne la cause des biblio- thèques publiques en Grande - Bre- tagne.
Profitant de cette forte impression, Ewart put ainsi présenter, devant un Parlement plutôt indifférent, un pro- jet de loi qui, le 14 août 1850, reçut l'aval royal et devint le Public Libra- ries Act (loi sur les bibliothèques publiques). La campagne lancée par les deux hommes le 24 août 1848 avait donc réussi et l'examen minu- tieux de l'exemple français que nous venons de faire pourrait donc sem- bler inutile.
Le premier biographe d'Edwards, Thomas Greenwood, disait à peu près ceci : «Il faut noter que la comparai- son du grand nombre des bibliothè- ques publiques et de leur plus grande ouverture concluant au désavantage de la Grande-Bretagne, arguments qu'Edwards ne cessait de mettre en avant, a été utilisée plus comme un levier que comme une description exacte des faits. Il est extraordinaire qu'Edwards ait trouvé toutes ces bibliothèques ouvertes à tous en 1849 sur le continent européen alors qu'au- jourd'hui encore (1902) on n'en compte pratiquement aucune, mises à part la Bibliothèque royale et quel- ques bibliothèques universitaires qui sont loin de s'ouvrir au grand pu- blic.» (18) Greenwood ajoute que les critiques contre les statistiques, cel- les de Verificator notamment, n'ont pas affaibli ses arguments. Il avait raison, l'idée que les bibliothèques publiques contribuent à la culture et à l'éducation du peuple restait in- tacte. Pourtant, Edwards et Ewart avaient évité - probablement avec sagesse - de trop attirer l'attention sur ce point fondamental mais indé- montrable du credo du bibliothécaire. Ils avaient surtout insisté sur la comparaison avec d'autres pays parce qu'ils pensaient qu'une émulation internationale pourrait persuader les membres du Parlement, par ailleurs sceptiques, de voter la loi. Il aurait été sans doute plus difficile de les convaincre en s'appuyant sur les principes fondamentaux des biblio- thèques publiques.
Est-il vraiment important qu'Ed- wards et Ewart aient évité de parler directement du problème des biblio- thèques publiques et se soient em- ployés à créer une atmosphère favo- rable au passage de la loi en faisant des comparaisons quelque peu dou- teuses ? Il y a tout lieu de croire que oui. D'abord, les bibliothèques pu- bliques mises en place grâce à la loi de 1850 ressemblaient malheureuse- ment par certains côtés aux modèles des exemples cités dans le rapport de la Commission. La loi permit aux villes de plus de 10 000 habitants - sans les y obliger - de créer une bibliothèque publique avec l'accord des contribuables. Le conseil muni- cipal fut alors autorisé à percevoir une faible taxe (un demi-penny par livre) afin de payer les traitements des employés ainsi que le bâtiment et l'entretien de la bibliothèque. Il est important de savoir que cette recette fiscale ne pouvait pas servir à acheter des livres : ceux-ci devaient provenir de dons faits par les citoyens. Cette conception profondément statique d'une bibliothèque publique, limitée au financement, fut peu à peu modi- fiée et améliorée par des lois ulté- rieures. Néanmoins, on peut dire que par le choix de leurs modèles, les promoteurs de la loi avaient eux- mêmes fixé les limites du système qui fut approuvé par le Parlement. Par exemple, il ressemblait par trop à celui des bibliothèques municipales françaises avec leurs difficultés d'en- richissement des collections.
Comme Edwards avait travaillé au départ sur une définition des biblio- thèques publiques fondée presque entièrement sur le financement pu- blic, il a peut-être été forcé de choisir des exemples qui reposaient sur le même principe, que ces exemples conviennent ou non par ailleurs. S'il avait davantage insisté sur le rôle joué par les bibliothèques dans la lecture publique, il aurait pu recourir à des exemples britanniques comme les bibliothèques d'abonnement, les bibliothèques circulantes, ou celles des "instituts de mécanique" qui, en général, n'étaient ni gratuites ni subventionnées, mais qui existaient grâce à leur capacité à renouveler leurs collections pour satisfaire leurs lecteurs. S'il avait eu besoin d'exem- ples pris en Europe, il aurait pu parler des cabinets de lecture, fort nom- breux en France, et qui ne sont pas cités parmi les témoignages recueillis par la Commission d'enquête (19) .
Tous ces autres exemples offraient des modèles dynamiques pour la lecture publique et, si on les avait associés à l'idée de financement public, ils auraient été beaucoup plus appropriés que ceux qu'avait choisis Edwards. Cela donne à penser que les lenteurs et les difficultés qu'a connues la lecture publique en Grande-Bretagne pendant la seconde moitié du XIXe siècle provenaient en grande partie de la manière dont Edwards avait dépeint la situation des bibliothèques publiques dans son témoignage devant la Commission d'enquête, en 1849 et en 1850.
En conclusion, on peut dire tout d'abord que cette étude montre les risques qu'il y a à comparer la situa- tion existant dans d'autres pays. Antonio Panizzi, bibliothécaire au British Museum, qui s'opposa sou- vent à Edwards, aborda le problème différemment. Il déclara devant la Commission d'enquête : «Je suis sûr que, lorsque la Grande-Bretagne tout entière voudra des bibliothèques et qu'elle en sentira le manque, la popu- lation saura bien en obtenir et dans de meilleures conditions que si on les lui avait octroyées avant même qu'elle en ait ressenti le besoin. C'est cet instinct de l'indépendance, pro- pre à notre pays, qui le fera progres- ser.» (20) Selon Panizzi, la création de bibliothèques devait correspon- dre à l'expression d'un besoin. En se fondant sur des comparaisons avec l'étranger pour planifier des systè- mes de bibliothèques, on court le risque de mettre au point des ensem- bles qui ne correspondent absolu- ment pas au contexte national. En dépit de ce risque, on trouve dans l'Histoire maints exemples d'utilisa- tion de cette méthode. Ainsi, par un juste retour des choses, Eugène Morel, pionnier des bibliothèques françaises modernes, se tourna vers les exemples anglais et américains pour défendre sa cause. Il serait inté- ressant de savoir s'il a utilisé cette technique de façon plus judicieuse et s'il a obtenu de meilleurs résultats.
2. Remarks on the paucity of libraries freely open to the public in the British Empire ; together with a succinct statistical view ofthe existing provision of public libraries in the several states of Europe. In a letter to the Rt. Hon. the Earl of Ellesmere. 2e éd. augmentée. Londres, «for private circulation», 1849. - Voir aussi : «A statistical view of the principal public libraries in Europe and the United States», Journal ofthe Statistical Society ofLondon, 11, 1848, p. 250-281. retour au texte
3. Cité par W. A. Munford, Edward Edwards, 1812-1886: portrait ofa librarian. Londres. Library Association, 1963, p. 57. retour au texte
4. Remarks on the paucity ... p. 4. retour au texte
5. Report from the Select Committee on Public Libraries, minute 10. retour au texte
6. Memoirs of libraries. Londres, Trubner, 1859. Vol. 1, p. 776. retour au texte
7. Report from the Select Committee ...p. 36-37. retour au texte
8. N. Richter,»Public libraries». Journal ofLibrary History. 19. 1984, 47-72, p. 50. retour au texte
9. op. cit., p. 51 retour au texte
10. H. Comte.Les bibliothèques publiques en France. Lyon. Presses de l'Ecole nationale supé- rieure des Bibliothèques. 1977. p. 109. retour au texte
11. F. Bibolet «La bibliothèque municipale de Troyes». Revue française d'Histoire du Livre nouvelle série. 12, 1976, 275-339, p. 296.Sur Troyes, voir aussi G. K. Barnett, Histoire des bibliothèques publiques en France de la Révolution à 1939. Paris, Promodis, 1987, p. 44-47 et 74-75. retour au texte
12. Bibolet, op. cit., p. 296. retour au texte
13. Ibid., p. 311 retour au texte
14. Report from the Select Committee ... p. 39. retour au texte
15. Ibid., p. 120. retour au texte
16. Ibid., p. 121. retour au texte
17. Ibid., p. 3. retour au texte
18. T. Greenwood, Edward Edwards : the chief pioneer of municipal public libraries. Londres, Scott, Greenwood & Co., 1902; p. 99. retour au texte
19. F. Parent-Lardeur, Les cabinets de lecture : la lecture publique à Paris sous la Restauration. Paris, Payot, 1982. retour au texte
20. Cité par W. A. Munford, op. cit., p. 76. retour au texte