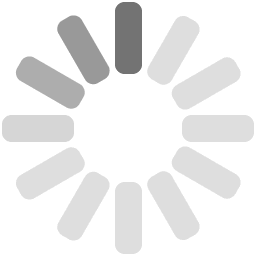Index des revues
- Index des revues
Pour un service public de la mémoire ?
-
Leniaud, Jean-Michel
Pour un service public de la mémoire ?, p.7-12. -
Stiegler, Bernard
Mémoire, technique et économie, p.13-21. -
Bunch, Antonia J.,
Schmitt, Catherine
Mémoire et information, p.22-25. -
Surget, Eric
Mémoire régionale, p.27-31. -
Arnoult, Jean-Marie
Conservation et valorisation, p.32-34. -
Oddos, Jean-Paul
Mémoire et élimination, p.35-39. -
Gèze, François
Des livres fantômes ?, p.40-41. -
Varry, Dominique
Réflexions autour de la parution de l'Histoire des Bibliothèques françaises, p.43-46. -
Richter, Noë
La mémoire de la profession , p.47-48. -
Gascuel, Jacqueline
La mémoire de l'abf , p.49-52. -
Bodin, Bruno
Synthèse des conférences du congrès de l'ABF Bibliothèques et mémoire, p.53-56.
Pour un service public de la mémoire ?
Par Jean-Michel Leniaud, Directeur d'études Ecole pratique des hautes études (IVe section).François Chaslin rapporte dans ses Paris de François Mitterrand (1985) F que l'architecte Peï souhaitait vivement que sa pyramide fût accompagnée dans la cour Napoléon d'un grand mât portant le drapeau tricolore : symbole et touche de couleur pour égayer cet univers minéral. La proposition fut unanimement rejetée par les conservateurs du Louvre... L'anecdote me paraît significative : le drapeau tricolore symbolise la mémoire nationale depuis la monarchie de Juillet jusqu'à la République actuelle. Il exprime la démarche unitariste et volontariste de l'Etat contre d'autres mémoires, celle du drapeau blanc et. plus tard, du drapeau rouge, voire du drapeau noir. Les conservateurs n'ont pas souhaité qu'il flottât sur le temple des arts. Pourquoi ? Peut-être n'ont-ils vu dans cet objet qu'une sorte de gadget, et difficile d'entretien de surcroît. Peut-être se sont-ils représentés le drapeau comme l'expression d'un nationalisme désuet et inapproprié pour un bâtiment qui s'est fixé une vocation universelle.
Mais peut-être aussi ce refus s'inscrit-il, plus ou moins consciemment, dans ce contexte de la société française d'aujourd'hui qui adresse à l'Etat un double reproche contradictoire : celui d'abandonner, soit par lassitude ou épuisement, le jacobinisme fondateur, porteur de l'universalisme des Lumières, thèse dont, par exemple, Alain Finkielkraut s'est fait le brillant avocat dans La Défaite de la pensée (1989) ; reproche, à l'inverse, d'uniformiser la société, voire d'étouffer les initiatives. L'anecdote du drapeau me paraît, en somme, significative, car elle met en évidence les deux interventions de l'Etat en matière de mémoire collective : il la protège, mais en même temps il en assure la police. Double intervention, nécessaire, mais dangereuse ; stimulante, mais oppressive. Celle de l'Etat-providence. En fait de rapports entre mémoire et Etat, trois hypothèses, pour faire schématique, sont possibles. La solution "théocratique", qui lie indissolublement l'une à l'autre, c'est celle que la Révolution française a adoptée. La solution "concordataire", qui se caractérise par le couple, aux relations multiples, police-protection : dans ce cas, l'Etat ne prétend pas imposer une mémoire officielle, mais peut opérer d'autorité une censure au nom de la vérité historique - citons pêle-mêle son attitude à la fin du XIXe siècle à propos de la Révolution en Vendée, le silence fait dans les manuels à propos des mutineries de 1917 et, plus significatif encore, la répression par la Loi des inepties révisionnistes. La troisième solution consiste à séparer la mémoire de l'Etat, mais gageons qu'à terme, il n'est plus ni Etat ni nation, car ni l'un ni l'autre ne vont sans mémoire collective.
M La Révolution et la politique du Livre
Avec la Révolution, disions-nous, Etat et mémoire sont indissolublement liés. Arrêtons-nous quelques instants sur la politique du Livre, telle qu'elle a été définie plus particulièrement à l'époque de la Convention par deux textes, l'un de l'abbé Grégoire, son Rapport sur la Bibliographie, du 22 germinal an II, l'autre de Boissy d'Anglas, Quelques idées sur les arts, du 22 pluviose an II.
En nationalisant les bibliothèques ecclésiastiques, notamment celles des ordres religieux, la Révolution s'est trouvée dans la situation de placer exclusivement entre les mains de l'Etat la majeure partie de la politique culturelle, comme elle le faisait en même temps de l'état-civil, de l'assistance et de l'instruction. L'Etat s'arroge en la matière un monopole, une mission de service de public qui était alors le fait d'une institution totalement distincte : l'Eglise. Par rapport à ce fait fondamental, la confiscation des bibliothèques des émigrés constitue un événement secondaire : c'est une mesure de représailles à l'encontre des traîtres à la patrie, mais elle confirme le caractère éminent de la nation.
Devant cette masse énorme de livres, les révolutionnaires éprouvent un sentiment de vertige, mais aussi un vif sentiment d'appropriation collective. Cet héritage est désormais, comme l'écrit Grégoire, "la propriété indivise de la grande famille", c'est à dire de la nation composée de citoyens libres et égaux. Mais les droits de la "grande famille" ne s'arrêtent pas aux bornes de la propriété publique. Ils peuvent intervenir dans la sphère de la propriété privée : Vicq d'Azyr déclare dans son Instruction du 25 ventose an II que la "grande famille" a aussi le droit de demander des comptes sur la manière d'utiliser des livres à tous ceux qui en possèdent, soit au titre de leur vie familiale, soit à celui de leurs fonctions.
Que faire de cette masse d'ouvrages ? En priorité, en assurer la conservation matérielle, en opérer le catalogage selon des méthodes définies par Grégoire et surtout Vicq d'Azyr. Bref, mettre au travail des administrateurs négligents, qui, pour autant, "ne négligeaient pas de percevoir leur traitement" (Grégoire). Et surtout, s'entourer de spécialistes "probes" et versés dans "la paléographie et la bibliographie".
Faut-il trier ? Question cruciale : la Révolution doit-elle conserver des ouvrages inutiles, voire nuisibles par leur contenu contre-révolutionnaire ? Dans le domaine des archives, on détruit ou on ne conserve que des échantillons, on met à part ce qui peut être utile à l'administration ou à l'histoire. En fait de livres, Grégoire propose d'échanger les doubles, de les répartir entre les différentes bibliothèques. Mais quid des mauvais livres ? Grégoire, encore, recommande de ne se pas se fier aux seuls critères matériels : le contenant ne fait pas le contenu. Le maroquin n'absout pas des "extravagances" du "despotisme", mais la fleur de lys de la reliure ne condamne pas l'ouvrage. A l'inverse, "les ouvrages qui révélaient les crimes des tyrans et les droits des peuples, étaient les sans-culottes des bibliothèques". Il ajoute un conseil de prudence : le temps n'est pas venu "d'élaguer". Il sera possible d'échanger avec les nations étrangères les livres "qui ont été mis à l'index de la raison" et qui ne sont pas dignes de demeurer dans "les bibliothèques d'un peuple libre". Boissy d'Anglas va plus loin : il s'oppose à toute mesure coercitive. Le temps fera son oeuvre : un ouvrage périt de luimême, faute de lecteur. Mais aussi le progrès de l'esprit humain : "On ne peut... tuer un livre qu'en en faisant un meilleur".
Pourquoi donc ne pas trier ? Pour Grégoire, parce qu'ainsi, le philosophe pourra établir une histoire des erreurs et des progrès de la raison, dont la connaissance permettra de prémunir l'homme contre de nouvelles chutes. Pour Boissy d'Anglas, nul n'a droit de propriété sur l'esprit humain : seuls "le temps et la postérité peuvent... effectuer sans danger" un "scrutin opératoire".
Concrètement, que faire ? Dans son Rapport, Grégoire, en bon conventionnel, est un chaud partisan de la méga-bibliothèque à Paris. Il stigmatise les "fédéralistes" qui veulent conserver dans les départements leurs richesses. Plus tard, dans ses Mémoires écrites sous l'Empire, il reviendra sur cette idée au risque de se contredire, qualifiant de délire" la fureur centralisatrice. Mais il est en même temps favorable à un réseau de bibliothèques disposé sur tout le territoire . comme il l'écrit dans ses Mémoires, elles "doivent être réparties sur la surface de la France comme les réverbères dans une cité".
L'objectif de ces bibliothèques est de faciliter l'instruction publique. Boissy d'Anglas insiste sur le caractère basique de celle-ci : l'objectif est de fournir au public des "livres élémentaires", c'est à dire des ouvrages qui s'en tiennent aux généralités, dont le but soit "d'épurer les principes en simplifiant les procédés". Et cet objectif est considéré par Boissy d'Anglas comme suffisant, car sa réalisation permettra de "préparer la maturité de la réflexion". Grégoire est, de son côté, très explicite sur le fait que le contenu du savoir dispensé par les manuels d'enseignement doit être l'objet d'une surveillance officielle, d'une censure : il appartient à la Convention, dit-il dans son Rapport de faire "filtrer" l'instruction "dans tous les rameaux de l'arbre social". Mais Grégoire va encore plus loin dans l'interventionisme étatique : il appelle le comité d'instruction publique à fournir les règles et les principes d'exploitation du savoir accumulé dans les livres, bref à susciter une culture d'Etat.
En somme, maîtrise du savoir par le catalogage et la science bibliographique, discussions sur la question de savoir s'il est opportun et légitime de trier et détruire, considérations sur la nécessité de la censure en prévision notamment de l'instruction publique, tels sont les grands soucis révolutionnaires. On peut regretter que rien n'ait été dit sur les modes d'enrichissement des collections, des achats, ni, a fortiori, sur le rôle des bibliothécaires. La Révolution a trop à faire avec l'héritage pour penser sérieusement aux nouveautés : les nécessités administratives et scientifiques engendrées par la confiscation des biens ecclésiastiques sont à l'origine de ce fossé si difficile à combler entre patrimoine et création.
On peut aussi regretter une absence de réflexion sur les rapports entre instruction élémentaire et culture savante. On peut peut-être voir dans ce vide les germes d'une césure, voire d'une idéologie dialectique entre bibliothèques spécialisées et lecture publique. Certes, Grégoire définit la bibliothèque comme un "réservoir de la pensée", "l'atelier de l'esprit humain". Mais les seuls intellectuels auxquels pense notre abbé sont ceux qui sont dépourvus de moyens financiers, qu'il appelle "le génie mal-heureux".
En somme, nous ne trouvons pas dans ces textes fondateurs une réponse adaptée à tous les problèmes de notre temps, mais un principe fondamental est exprimé, celui de "propriété commune", de "propriété indivise de la grande famille", la nation et, au delà, "l'espèce humaine".
M Le bibliothécaire médiateur.
Placé à la tête de "l'atelier de l'esprit humain", le bibliothécaire est donc chargé d'intervenir au nom de "la grande famille". Mission considérable : dans L'Utopie française, j'ai mis l'accent sur ce que j'ai appelé les "médiateurs" dans la définition du patrimoine. Si, comme dit P. Bourdieu, le patrimoine se définit comme "l'héritage hérité", le médiateur est celui qui décide au nom de la société sur ce qui, dans l'héritage, doit être hérité. De son côté, Yves Michaud a montré dans un ouvrage récent, L'artiste et les commissaires : quatre essais non pas sur l'art contemporain mais sur ceux qui s'en occupent (1989), le rôle aujourd'hui du "commissaire". Qu'est-ce qu'un commissaire ? Celui qui a pour mission de montrer l'art : le conservateur de musée, les fonctionnaires des Arts plastiques, les gale-ristes, les communicateurs et autres critiques, les responsables d'exposition, les collectionneurs. Aujourd'hui, dit-il, l'art n'est plus fait par l'artiste, mais par celui qui le montre. C'est le monde de l'art qui fait l'art.
Que ce soit dans le domaine du patrimoine ou celui de la création artistique, l'Etat joue un rôle essentiel, soit par l'instrumentation des lois patrimoniales, soit par le maniement des crédits de la commande publique. Mais, pour ce qui concerne le patrimoine, les choses sont en train de changer : non seulement, l'Etat répugne de plus en plus à utiliser ses pouvoirs de police, mais de nouvelles forces de décision et de pression apparaissent sur la scène patrimoniale, collectivités, entreprises, associations, minorités culturelles, etc. A côté du médiateur d'Etat, viennent se placer d'autres médiateurs qui tendent à modifier la perception sociale du patrimoine, de telle sorte qu'au patrimoine unitaire forgé par l'Etat jacobin, se substitue progressivement un patrimoine pluriel.
Le bibliothécaire est, lui aussi, un médiateur. Certes, et heureusement, le rêve de Grégoire a tourné court : la bibliothèque n'est pas "l'atelier de la pensée" et on ne peut pas transposer au domaine du livre l'analyse qu'Yves Michaud a produite pour les arts plastiques. Le bibliothécaire ne s'est pas substitué à l'auteur dans la fabrication de la production littéraire et intellectuelle.
Néanmoins, la frontière entre le créateur et le commentateur-critique étant infiniment plus floue dans le domaine du livre que dans celui des arts plastiques, on pourrait concevoir une intervention encore plus pressante du médiateur-bibliothécaire que du galeriste-commissaire. La vogue même des termes "médiathèques", "artothèques", déclinés à partir du mot bibliothèque pourrait y inciter : puisque le médiathécaire et l'artothécaire sont des médiateurs, pourquoi le bibliothécaire n'interviendrait-il pas comme tel ?
A quoi l'on peut répondre qu'une intervention volontariste du bibliothécaire comme médiateur est entravée par des circonstances particulières. Autant ce qui relève de l'art contemporain relève d'une sorte d'initiation qui consiste à apprendre à voir et à produire, autant il est admis que chacun peut s'occuper de livre, puisque tout le monde sait lire et penser : éditeurs, libraires, critiques, émissions de télévision généralisent une approche démocratique. Autant les arts plastiques produisent généralement des unica, autant l'imprimerie, elle a été créée pour cela, multiplie les exemplaires. De nombreux facteurs permettent donc une production pluraliste, qui n'est pas le fait des arts plastiques.
Il n'en reste pas moins que le bibliothécaire se place comme un intermédiaire entre un ensemble de livres et un public. Il est chargé d'une double mission de service public : la conservation des fonds anciens et la lecture publique, qui le place au coeur de cette dialectique héritée de la Révolution entre Patrimoine et création et peut s'analyser comme la séquence suivante : conservation, achats, catalogage et mise à disposition du public.
Ces diverses tâches impliquent de la part du bibliothécaire-médiateur des choix : que choisir, au nom de quels critères ? Certains de ces choix sont susceptibles, il est vrai, d'être dictés par les circonstances, ou les moyens matériels : des contraintes techniques peuvent limiter les capacités de stockage et conduire à des éliminations, les enveloppes financières peuvent ne pas être à la hauteur des ambitions d'achats. D'autres choix peuvent être conditionnés par les caractéristiques du marché : le nombre de titres parus dans l'année, la mauvaise diffusion des petits éditeurs, le comportement commercial des libraires qui s'approvisionnent en fonction des retombées médiatiques des parutions et optent pour une rotation rapide des stocks en raison de la péremption des titres, les modes auxquelles obéit un public à la fois sur et sous-informé.
Mais, à côté de ces contraintes, citées parmi d'autres, auxquelles est confronté le bibliothécaire dans l'exercice quotidien de sa profession, il faut ajouter tout ce qui découle de la politique culturelle de l'Etat et, en arrière-plan, des idéologies ambiantes. Sans pour autant entrer dans les polémiques suscitées par Marc Fumaroli (L'Etat culturel, 1991) ou Michel Schneider (La Comédie de la culture, 1993), pour ne citer que ces deux titres, il me paraît plus que salubre de se livrer à un exercice de dissection, ou d'autopsie, du service public en matière culturelle.
Le service public de la culture.
Le grand changement qu'a connu l'intervention administrative de l'Etat au cours du XXe siècle et spécialement au cours des dernières décennies, c'est qu'on est passé progressivement d'une administration de "police" à une administration de "prestations". En matière de culture, pour s'en tenir au secteur qui nous intéresse ici, l'Etat ne met plus aujourd'hui la priorité sur la conservation patrimoniale, l'enrichissement des collections, l'enseignement des arts et des lettres, mais sur l'accès de tous aux biens culturels, c'est à dire sur la consommation culturelle. Sous cet angle, la coïncidence entre la dénonciation du tout Etat culturel et la quasi-obtention du 1% du budget n'a rien de fortuit : elle s'explique par l'inquiétude que l'Etat devienne progressivement, par le biais des subventions, le principal prestataire culturel.
Ce qui aggrave le phénomène, c'est la tendance "paternaliste" de l'administration, qui est persuadée de connaître les besoins des administrés et entreprend, au nom du service public, de définir et de fournir les prestations dont elle estime qu'ils ont besoin. Elle le fait au nom de trois principes : technocratisation, centralisation et uniformisation, hérités tous les trois de la conception géométrique et jacobine de l'Etat issu du siècle des Lumières et de la Révolution.
Technocratisation ?
La manifestation la plus évidente résulte d'un économisme primaire : le "rende-ment social", le nombre de lecteurs. "Dis-moi combien d'entrées tu fais et je te dirai le montant des crédits que tu mérites", explique le fonctionnaire budgétaire au conservateur. Comme si la consommation de masse impliquait le développement culturel... Tel est aujourd'hui le procès qui est fait au musée des monuments français au palais de Chaillot : cet ensemble de copies et de moulages, moment significatif de l'histoire de la muséographie et documentation irremplaçable sur des peintures et sculptures médiévales, est-il jugé recevoir un nombre insuffisant de visiteurs ? Il est en conséquence progressivement détruit... Malheur aux bibliothèques spécialisées qui refusent de s'ouvrir : elles sont taxées d'élitisme. Quant aux fonds anciens, les voici impliqués dans le procès fait au patrimoine tout entier : à quoi peuvent-ils servir ?
A ce stade, ce qui était le simple raisonnement d'un budgétaire zélé - puisque l'augmentation des crédits découle de l'importance de la consommation, ouvrons les fonds anciens à une plus grande consommation -, se double d'une problématique sur fond idéologique. Je rêve ? Ouvrons le rapport de conjoncture 1992 du CNRS, p.408, sous la rubrique : "Patrimoines, cultures et sociétés". J'y lis : "Il ne s'agit pas seulement de faire fructifier les objets et lieux conservés, mais de savoir si le patrimoine devient le grand luxe de la conservation des sociétés. En épousant exclusivement une fonction culturelle dominante, comment peut-il participer du devenir même de l'économie". Bref, le patrimoine doit être utile, sous peine d'être mis en question dans son existence même. Utile, mais à quoi ? Le rapport de conjoncture répond il "permet de construire une projection de l'avenir des sociétés", tandis que "les conceptions de l'organisation de l'avenir déterminent en partie les actes et les choix de la conservation présente". Voici donc le patrimoine réduit au rôle de marc de café dans lequel on lirait l'avenir, comme les astrologues le prédisaient aux princes de la Renaissance ; mais aussi condamné aux impératifs d'une planification déterminée par on ne sait qui.
Mais pourquoi vouloir rendre le patrimoine utile ? La réponse fournie par le rapport explicite les sous-entendus idéologiques du problème : "la sauvegarde trop systématique" présente un "aspect réactionnaire" ; "l'obsession de la conservation", "la défense patrimoniale", risque "de trahir trop souvent l'idéologie d'une conservation des origines".
Allons plus loin : puisqu'il ne faut conserver que ce qui est utile, des choix sont nécessaires. Renan, en observant que la nation n'est pas seulement fondée sur le "consentement actuel", mais dans "la possession en commun d'un legs de souvenirs", ajoutait aussitôt qu'il était indispensable que "tous aient oublié bien des choses". Sage conseil de police social ! Mais voici notre rapport qui affirme : "l'abandon ou la destruction peuvent être aussi la part maudite et nécessaire des patrimoines" (p. 408). Bref, l'appel à la censure : nous voici bien loin des conseils, pourtant mesurés, de Boissy d'Anglas à ses collègues de la Convention.
On dit plaisamment qu'à chaque changement de dynastie, les anciens Chinois récrivaient l'histoire du régime précédent après en avoir détruit les annales, de façon à maîtriser le passé. Voici à quoi l'on ne peut être que conduit si l'on refuse de prendre le patrimoine comme un tout, sans souci de rentabilité immédiatement, simplement comme "ces vastes réservoirs des pensées, des projets de tous les siècles, de tous les pays", dont parlait Grégoire, qui "sont en même temps la honte et la gloire de l'espèce humaine".
Centralisation ?
"Il serait un malveillant, écrit Grégoire dans son Rapport sur la bibliographie, celui qui tenterait de faire croire qu'on peut concentrer ici (à Paris) tous les objets scientifiques ; Paris lui-même réclamerait contre cette injuste préférence ; ils doivent seulement y être en plus grande abondance ; mais la patrie n'a point de prédilection. Les monuments des arts étant un héritage commun, tous les départements y ont droit". Et il ajoutait imprudemment : "Je ne crains pas d'être démenti, en assurant que tous y auront part". Certes, l'enjeu départemental des BCP aura été tenu au cours de la décennie Quatre-Vingt. Mais que dire du projet de Tolbiac qui vient s'ajouter à la Bibliothèque Nationale, aux grandes bibliothèques parisiennes et à la BPI, sinon qu'il renforcera la prédominance intellectuelle de Paris sur l'ensemble du territoire, qu'il contribuera à l'exode des étudiants provinciaux vers la capitale, qu'il dissuadera un peu plus les chercheurs de travailler ailleurs qu'à Paris ? Qui prouve que les Français n'avaient pas besoin davantage de bibliothèques universitaires que de la Grande bibliothèque ? Pourquoi pénaliser un peu plus quatre-vingt pour cent de la population ? Que devient le démocratique principe de l'égalité des chances ?
Mais la centralisation n'implique pas seulement une France culturelle à deux vitesses. Elle peut conduire à des projets susceptibles de passer pour des supercheries. Prenons l'exemple du projet de bibliothèque des arts : en quoi la juxtaposition en un même lieu de la bibliothèque Doucet, de la bibliothèque du Louvre et de la bibliothèque de l'ENSBA va-t-elle provoquer l'enrichissement des collections ? Il y a deux mois encore, nul ne savait quels seraient les moyens en fonctionnement mis à la disposition du futur établissement ; à combien s'élèveraient les crédits d'acquisition, sinon qu'ils devaient être inférieurs à ceux d'une BU allemande ? La concentration en fait de bibliothèques n'est pas, à mon avis, un bien ; c'est plutôt un mal. Un mal qui, en l'espèce, faillit se concrétiser par ce qui aurait été une grave perte patrimoniale : la destruction du magnifique décor de la bibliothèque de l'ENSBA, décidée par la direction de l'Ecole et heureusement évitée par la direction du patrimoine.
La centralisation ne met pas seulement en cause les équipements, elle détermine une politique culturelle. Pendant près de deux siècles, l'Etat a mis en oeuvre des mécanismes d'uniformisation des citoyens, notamment dans le domaine de la langue, de l'histoire, des moeurs, des arts et des lettres. Le partisan d'une démarche régionaliste ne pouvait qu'être progressivement marginalisé au nom de l'Egalité, exclu, voire traité d'anti-républicain. Les mémoires et les langues locales, l'architecture vernaculaire, de multiples paysages ont irrémédiablement pâti d'une démarche culturelle imposée par le centre.
Aujourd'hui, et depuis une dizaine d'années, le processus s'est quelque peu modifié. L'Année du patrimoine, la régionalisation, l'évolution de l'Europe ont facilité des réactions à l'uniformisation jacobine, au point de susciter dans la société un certain réveil des identités culturelles et historiques locales. Ici et là, de petits éditeurs locaux ont vu leur action soutenue par les régions, des ouvrages en langues locales ont été publiés. Certains idéologues ont beau dénoncer ce mouvement, fragile au demeurant, comme l'expression d'un conservatisme farouche, ne relève-t-il pas de la qualité du service public en fait de bibliothèques d'en tenir compte, de le favoriser, fût-il le fait de minorités ?
Cependant, l'importance de l'immigration en provenance des pays de l'ancien empire colonial a modifié passablement les données du problème. Que faire des cultures véhiculées par les "ethnies" allogènes ? Les assimiler, c'est à dire les condamner à la disparition, comme l'aurait fait le jacobinisme du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, comme le préconise aujourd'hui Jean-Claude Barreau ? Les intégrer, c'est à dire faire en sorte que leur originalité soit conservée ? Est-ce possible ? L'intégration est-elle autre chose qu'une étape vers l'assimilation ? D'autres pays que le notre vivent ce type de problème : prenons le cas du Québec, sensible, puisque s'agissant d'une minorité francophone vivant en milieu anglophone. On recense dans la région de Montréal plus de quatre-vingt ethnies : la situation y crée tant de problèmes sociaux que l'université de Montréal vient de créer un diplôme d'intervention en milieu interculturel, auquel se préparent déjà près de 225 étudiants. A l'inverse, l'historien américain Arthur Schlesinger, dans un entretien récent avec Le Monde (27 avril 1993), affirme qu'après avoir été un fait positif aux Etats-Unis dans les années Soixante, le multiculturalisme est devenu dangereux : certains idéologues utiliseraient ce concept pour s'opposer au principe d'identité nationale et favoriser un développement séparé des races.
Que faire donc en France face au problème des cultures ethniques ? Quel rôle doit tenir le bibliothécaire en la matière ? Sa fonction de médiateur ne le place-t-il pas au coeur d'un débat très important pour l'avenir de la société française ?
Uniformisation ?
Le problème, on le voit, ne se pose plus en termes jacobins : il ne s'agit plus de fabriquer des citoyens culturellement identiques, mais de savoir si le maintien des identités nationales se justifie. A l'identité s'opposerait le concept d'universalité. Mais ici les avis sont partagés : pour les uns, l'internationalisme souhaitable, l'Europe, impliquent la disparition de l'idée nationale ; à quoi s'oppose diamétralement Max Gallo dans un article récent du Monde ("Cher et vieux pays", 23 avril 1993). D'autres ajoutent que le développement des cultures régionales contribuera à la montée de l'internationalisme en affaiblissant l'Etat-nation : multiculturalisme et polyethnisme d'un côté, universalisme internationaliste de l'autre, même combat.
A supposer qu'un tel dessein soit possible, c'est à dire que les autres pays d'Europe acceptent eux-aussi de gommer leur propre identité nationale, sur quoi déboucherait-on ? Une sorte d'espéranto culturel qui supposerait à tout le moins une uniformisation des paysages et des langues ? Or, en matière de paysage, ce n'est qu'une partie infime du sol qui se trouve actuellement soumise à un processus d'indifférenciation : à l'exception des espaces urbains, les nécessités qui découlent du relief et du climat impliqueront encore longtemps la diversification. A fortiori, il est utopique d'admettre qu'il suffise d'invoquer une ambition universaliste pour que les singularités linguistiques soient conduites à disparaître.
Ce n'est donc qu'une rêverie que l'espéranto culturel. Mais d'autres hypothèses sont envisageables : telle culture dominante peut se prétendre une vocation universelle et rassembler en un lieu ce qui lui paraît être la synthèse des arts et des lettres de l'humanité. Telle a été l'ambition de la Révolution française : elle l'a réalisée par les armes. Aujourd'hui, c'est par la puissance économique, que d'autres pays poursuivent sous couleur d'internationalisme une démarche d'impérialisme culturel.
Le suréquipement culturel de Paris s'inscrit dans cette course à Ylmperium à laquelle la France ou du moins ses dirigeants croient devoir se livrer : elle n'y aura pourtant pour place que celle que lui donnera sa capacité économique. Imagine-t-on, ce faisant, faire de la capitale de la France la capitale de l'Europe ? Voilà un dessein improbable s'il prétend se réaliser au prix des cultures nationales ou locales. Comme Edgar Morin l'exposait il y a quelque temps dans Le Monde ("La pensée socialiste en ruine", 21 avril 1993), "il nous faut comprendre à quels besoins formidables et irréductibles correspond l'idée de nation". L'universel n'exprime pas le contraire de patrie : il est constitué des cercles concentriques que forment familles, régions, nation, Europe, continent, etc.
L'universalisme des Lumières péchait par un vice fondamental : il confondait l'Homme et le citoyen français, comme si ce qui convenait au Français était susceptible d'être conforme aux besoins politiques des autres peuples d'Europe et. plus tard, d'Afrique et d'Asie. L'internationalisme marxiste et ses dérivés ont voulu privilégier les forces de production matérielles et faire du prolétaire un homme sans patrie. L'internationalisme libéral fait des échanges économiques l'alpha et l'oméga de l'humanité. Le solidarisme socialiste prône le travail comme le grand facteur de religion sociale. Chacune de ces démarches oublie plus ou moins sciemment la véritable dimension de l'homme qui passe par une nécessité identitaire profonde. Etre soi-même et, tout à la fois, être d'un groupe.
Alors, plutôt que de parler d'universalisme ou d'internationalisme, serait-il plus raisonnable d'enrichir le vieux concept d'humanisme. L'humanisme ne prétend pas à l'homogénéisation des civilisations, il apprécie dans leur diversité et chacune à sa place les différentes cultures avec leurs mérites et leurs carences. Et c'est d'une telle éthique qu'on espère voir le service public s'inspirer plutôt que de telle ou telle idéologie généralement néfaste et toujours dépassée.
Doit-on en définitive parler d'un service public de la mémoire ? Puisque la nation me paraît une nécessité de vie en société et que l'Etat ne doit être autre que l'expression de la nation, il est clair que la constitution et l'exploitation d'une mémoire nationale constituent une mission de service public. Si l'on admet que l'oubli de certains événements historiques contribue de façon indispensable à la paix sociale, on est également conduit à justifier une certaine forme de censure si elle s'avère nécessaire. Mais à deux conditions : qu'elle repose elle-même sur un consensus social le plus large possible et que, matériellement, elle s'exprime par le silence et non par la destruction, de façon à garantir les droits des générations ultérieures.
Cependant, ce service public de la mémoire nationale n'est pas en droit de prétendre à l'uniformisation, qui est elle-même source d'exclusion. Il n'est pas en droit de dire la mémoire, mais de consigner les aspirations de la société, tout en veillant à ce que celleci ne soit pas, elle non plus, exclusive. Il n'est pas en droit de créer, ou de laisser créer, des processus destinés à provoquer la destruction des mémoires particulières. Il n'est pas en droit non plus de provoquer la fusion de la mémoire nationale dans une mémoire internationalisée, car sa vocation première est de servir les intérêts de la nation.
En somme, qu'il exerce une certaine police ou qu'il fournisse des prestations, le service public mémoriel, comme toute forme de service public, n'est qu'un instrument au service du public. Il exerce l'autorité publique légitime, mais n'a pas pour mission de créer un unanimisme factice en empêchant les initiatives locales ou en prétendant délivrer un message. Le théocratisme mémoriel peut se justifier dans le cas d'une jeune nation qui a besoin d'un enthousiasme volontariste pour se former ; il n'est pas adapté au cas d'un vieux pays comme le notre. La laïcité mémorielle, la séparation complète de l'Etat d'avec la mémoire, n'est pas conforme à la tradition de notre Etatnation. Reste une difficile voie concordataire, qui repose sur une éthique respectueuse des individus et des groupes. Cette éthique, il appartient au bibliothécaire-médiateur de la mettre en oeuvre dans sa vie professionnelle.