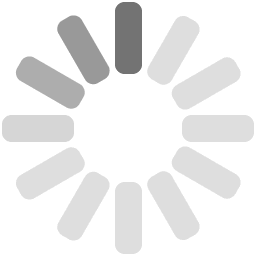Index des revues
- Index des revues
Dans les bibliothèques universitaires
-
Garreta, Jean-Claude
Introduction, p.5. -
Dupuy, Hubert
A la bibliothèque publique d'information, p.5-6. -
Pierdet, Christian
Dans les bibliothèques universitaires, p.9-11. -
Faure, Patrick
Une bibliothèque de lecture publique automatisée, p.12-13. -
Depallens, J.
Télédocumentation (partiellement) payante et consultation de nos fichiers (quasi) gratuite, p.15-17. -
Iung, Jean
Un service I.S.T. payant, p.18-19. -
MeyriÂt, Jean
Le point de vue d'un documentaliste , p.20-21. -
Albaric, Michel
Le point de vue d'une bibliothèque privée , p.22-23. -
de Valence, François
Le point de vue d'un producteur , p.24. -
Lemennicier, Bertrand
L'accès à l'information moderne doit-il rester un service public gratuit ? , p.25-29. - l'ouverture de la B.U. au public non universitaire;
- le souci d'une gestion plus rigoureuse;
- l'utilisation de nouvelles techniques.
Dans les bibliothèques universitaires
L'abandon de la gratuité, rançon des progrès techniques
Par Christian PIERDETA l'exception du droit d'inscription demandé aux étudiants, la tradition est que les services rendus par une bibliothèque universitaire à ses usagers sont gratuits.
Cette tradition s'inscrit dans la volonté manifestée dès ses débuts par la Ille République de rendre gratuit l'enseignement public français.
Depuis une quinzaine d'années, cependant, différents phénomènes sont apparus, qui ont amené les bibliothécaires à remettre en cause cette tradition de gratuité et d'envisager de rendre payant, au moins partiellement, l'accès à l'information et à la documentation scientifique et technique.
Ces phénomènes sont de trois ordres :
1. - L'OUVERTURE AU PUBLIC NON UNIVERSITAIRE
Les usagers « de droit des B.U., les enseignants, les chercheurs et les étudiants ont été pendant longtemps leurs usagers quasiment exclusifs.
A partir des années 1960, l'ouverture s'est faite, petit à petit, plus ou moins suivant les villes, au public non universitaire. Même après la décision officielle du ministre de tutelle d'alors, Jean-Pierre Soisson, elle était relativement timide.
Mais depuis quelques années, les universités s'insèrent plus étroitement dans leur région. La tenue en 1981 des Assises régionales de la recherche et de la technologie, puis les mesures de décentralisation décidées par le gouvernement Mauroy renforcent ce mouvement d'insertion. Les B.U., parties intégrantes des universités, n'y sont pas restées étrangères.
Le cas, toujours assez limité en nombre, des personnes ayant besoin pour leur propre compte d'information et de documentation a été réglé par assimilation avec celui des étudiants, c'est-à-dire en faisant payer à ces personnes un droit d'inscription.
Le cas des agents des administrations et des services publics a presque toujours été résolu dans le sens de la gratuité. On peut d'ailleurs se demander si cette pratique n'est pas à revoir : une B.U. paie une vignette pour sa voiture de service, verse une cotisation patronale à la Sécurité sociale pour le personnel payé sur budget propre, acquitte éventuellement la taxe municipale sur les ordures ménagères. Pourquoi serait-elle le seul service public à exempter de tout droit ses homologues?
Reste un troisième cas : celui de la personne qui pour son métier, à son propre profit s'il est artisan ou membre d'une profession libérale, au profit de son entreprise s'il est salarié, vient chercher information et documentation à la B.U. Médecin, avocat, ingénieur, technicien s'adressent ainsi de plus en plus souvent aux B:U. ; et la documentation que celles-ci leur procurent, ils la monnaient finalement auprès de leurs clients. Pourquoi la B.U. ne monnaierait-elle pas, elle aussi, le produit qu'elle fournit : l'information et la documentation ? C'est, en fait, ce qui s'est passé puisque nombre de B.U. se font payer des abonnements de périodiques, ou régler une facture d'ouvrages, ou tout simplement verser une « cotisation de 2.000 à 3.000 F par des entreprises qui utilisent couramment leurs services.
II. - LE SOUCI D'UNE GESTION PLUS RIGOUREUSE
C'est une habitude fréquente, dans la Fonction publique, de ne pas tenir compte des coûts, dans la mesure où il n'y a pas recherche d'un bénéfice.
Ainsi, dans les B.U., le temps mis par un membre du personnel à faire une recherche, les produits utilisés dans telle ou telle opération (papier, timbres, etc.) ne donnaient pas lieu àfacturation aux dépens. du lecteur intéressé. A la limite, on pourrait dire que le montant de la subvention ministérielle de fonctionnement était le seul butoir qui aurait arrêté les dépenses de ce genre.
La stagnation, voire la diminution, de cette subvention, alors que le coût des acquisitions et aussi celui du fonctionnement augmentaient fortement, ont conduit les responsables des B.U. à s'intéresser de plus près, de façon plus méthodique, à la gestion de leur établissement. Il faut dire, à leur décharge, que la formation reçue en ce domaine était insuffisante !
La notion de rentabilité a fait ainsi son apparition. Certes, il n'est toujours pas question de faire des bénéfices. Mais le but est de faire toutes les économies possibles dans le fonctionnement, sans en faire baisser la qualité, afin de pouvoir consacrer le maximum de ressources aux dépenses documentaires.
Comme on l'a vu lors d'un tout récent colloque de l'A.U.P.E.LF. consacré à « l'évaluation des services rendus par les B.U. », la France en est encore aux balbutiements dans ce domaine. C'est un autre problème, mais l'idée apparaît de l'utilité de la connaissance exacte des coûts de tel ou tel service : on pourrait ainsi déterminer de façon réfléchie si une partie, ou la totalité, peut être mise à la charge de l'utilisateur.
On rejoint par là le point de vue auquel nous avait conduit l'ouverture de la B.U. au public non universitaire : l'information et la documentation scientifiques et techniques ne seraient-elles pas des produits comme bien d'autres, des biens de consommation courante comme les qualifiait un responsable de la D.B.M.I.S.T., et de ce fait monnayables?
III. - L'UTILISATION DES NOUVELLES TECHNIQUES
Mais ce qui paraît être déterminant dans le processus d'abandon de la gratuité, c'est l'utilisation de nouvelles techniques, car celles-ci augmentent de façon très importante le coût des services rendus par la B.U.
Un premier exemple en a été donné lors de l'apparition de la photocopie. Alors que la B.U. mettait gratuitement n'importe quel livre à la disposition du lecteur qui souhaitait le recopier, ou plus généralement le lire en prenant des notes, elle a fait payer la copie réalisée au moyen d'un appareil.
Ce qui nous occupe essentiellement aujourd'hui, c'est l'interrogation documentaire automatisée. Son coût dépend d'un certain nombre d'éléments, comme cela a été exposé précédemment. Le problème pour la B.U. est de décider dans quelle mesure ce coût doit être supporté par le lecteur.
Comme cela s'est passé pour la photocopie où les prix diffèrent assez fortement d'une B.U. à l'autre, la tarification actuellement en vigueur pour l'interrogation par terminal d'ordinateur n'est pas unifiée.
D'après une enquête du Service des bibliothèques, portant sur l'année 1980, la majorité des B.U. font payer en temps réel, par minute d'interrogation, certaines ajoutant un pourcentage représentant les dépenses annexes (téléphone, papier, maintenance, etc.). Quelques-unes en revanche utilisent un système forfaitaire sur la base d'une durée moyenne de 15 minutes. Par ailleurs, on peut remarquer que les prix demandés aux utilisateurs non universitaires sont majorés par rapport à ceux demandés au public universitaire.
Depuis que la D.I.S.T. puis la D.B.M.I.S.T. ont entrepris de doter chaque section de B.U. d'un terminal d'interrogation, celle-ci reçoit également un crédit pour un certain nombre d'interrogations gratuites. Deux possibilités s'offrent alors à la B.U. : soit utiliser l'ensemble du crédit pour des interrogations entièrement gratuites et passer ensuite à des interrogations facturées au prix réel; soit de faire payer dès le départ un prix, même minime, avant d'arriver au prix réel. Dans le premier cas, la gratuité attire généralement de nombreux amateurs, dont beaucoup disparaissent ensuite ; le second a sans doute des résultats moins spectaculaires dans l'immédiat, mais probablement plus sûrs à long terme.
En tout état de cause, il n'est pas possible à une B.U. de fournir ce genre de service gratuitement : son budget ne le permettrait pas, d'autant que la gratuité augmenterait le nombre des demandes. Et même si le budget le permettait, faudrait-il adopter la gratuité ? Il ne semble pas. L'utilisateur doit se rendre compte de deux choses : tout d'abord qu'une recherche documentaire automatisée, parce qu'elle met en jeu un ensemble de techniques sophistiquées, coûte un certain prix et revient nettement plus cher, sur le plan strictement financier, qu'une recherche manuelle ; mais aussi que cette recherche, compte tenu des résultats obtenus et du délai très bref pour les obtenir, est globalement d'un coût peu supérieur. Etant entendu que la recherche bibliographique traditionnelle reste possible, gratuitement, c'est au lecteur de choisir. En médecine et en sciences, où cette pratique existe depuis plusieurs années, les chercheurs n'hésitent pas et optent pour l'interrogation automatisée. En lettres, en sciences humaines, le choix est moins tranché : la recherche automatisée y est plus récente, les possibilités moins grandes ; il faut noter aussi que la rapidité est peut-être moins cruciale et que le prix est plus souvent supporté par une personne que par un laboratoire en raison du caractère plus individuel de la recherche.
Dans un sens opposé, il est intéressant de signaler un projet de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne : supprimer l'abonnement à l'édition papier du Bulletin signalétique du C.N.R.S. et rendre gratuites les interrogations automatisées des banques de données correspondantes. C'est un parti que l'on peut en effet adopter, mais le coût des interrogations ne va-t-il pas l'emporter rapidement sur le prix de l'abonnement ? Par ailleurs un certain type de recherche courante n'est guère possible (ou du moins pas rentable) par interrogation. Surtout, ce principe ne peut être généralisé car bon nombre des organismes créateurs de bases de données n'éditaient pas, auparavant, de périodique bibliographique.
L'interrogation documentaire automatisée permet d'améliorer la constitution d'une bibliographie, par la connaissance, dans un délai très court, des références existant sur le sujet. Il faut ensuite, si la B.U. ne possède pas les documents contenant ces références, les localiser et les demander à d'autres bibliothèques. Pour cette opération également, des améliorations importantes ont été, ou vont être, apportées : il s'agit d'une part de la constitution du Catalogue Collectif National informatisé des publications en série (C.C.N.) entré maintenant dans sa phase opérationnelle, d'autre part de la transmission des demandes de prêt interbibliothèques par télex ou par la messagerie électronique. Dans tous ces cas également, le progrès se paie et la même question se pose : faut-il conserver le principe, jusque-là existant, de la gratuité ou mettre l'utilisateur final à contribution ?Sauf dans le cas du télex, il semble que la plus grande partie des B.U. qui l'utilisent en supportent le coût.
Enfin, dernier maillon de cette chaîne, reste le problème de l'envoi du document lui-même. Nous sommes actuellement tributaires du service postal, qui réserve parfois des surprises désagréables, annulant presque complètement le gain de temps réalisé dans les opérations de recherche bibliographique et de localisation. Il existe évidemment un moyen rapide de transmettre le document, c'est la télécopie. Il existe, théoriquement du moins, car aucune B.U. ne doit être actuellement équipée pour la télécopie. Le coût en est fort élevé et son utilisation augmenterait d'une façon très importante le prix à payer par le lecteur. De plus, si cette technique peut apporter une solution à la transmission d'articles de périodiques, son emploi semble inconcevable dès qu'il s'agit d'un ouvrage, du moins dans l'état actuel des choses.
Ainsi, si tous ces éléments améliorent de façon incontestable les services qu'une B.U. peut rendre à ses lecteurs en leur fournissant références bibliographiques et documentation, ils entraînent en revanche des frais non moins incontestables. Ces frais ne peuvent être que très partiellement pris en charge par la B.U. et retombent principalement sur le lecteur.
Comme il a été dit plus haut, c'est finalement à lui de choisir. Quelle que soit la technique utilisée, la B.U. reste toujours l'intermédiaire entre le document et l'utilisateur. Elle doit proposer à ce dernier les diverses possibilités et c'est à lui de décider si la plus grande quantité du service rendu justifie la dépense.
Ajoutons simplement, pour que cette proposition ne suscite pas aussitôt des accusations d'élitisme, qu'un système d'aide à la recherche est tout à fait envisageable. Il a d'ailleurs reçu un commencement d'application par la création des Bourses d'Information Scientifique et Technique (B.I.S.T.) distribuées pour la première fois en 1982 par la M.I.D.I.S.T.
DISCUSSION
M. lung note qu'une sérieuse analyse de coût doit tenir compte de la main-d'oeuvre. L'intervention de celle-ci tendra donc à diminuer tandis que sur le marché apparaissent des terminaux à bon marché. Les intermédiaires manipulateurs ne pourront-ils donc être évités?
Non, répond M. Dupuy, l'expérience de Vélizy fait apparaître 50% de non-utilisation, même pour la consultation de l'annuaire. C'est un problème d'imprimante, mais le vidéotexte peut faire évoluer cette situation. Seul le chercheur, par une pratique soutenue, se passera d'intermédiaire, encore que, ajoute M. Pierdet, il est limité à une ou deux bases, à moins de suivre de multiples stages. D'autre part, cette main-d'oeuvre de manipulation dans les bibliothèques universitaires est de moindre coût que dans le secteur privé. Le passage par intermédiaire peut durer une dizaine d'années, estime M. Depallens.
Les fonctions sont analogues, mais les commandes changent d'un logiciel à l'autre. Des logiciels seront créés pour être des interfaces.
Comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis, on voudra utiliser la permanence de fonctionnement des bases, dont la tendance à la formation du public des chercheurs ira en se développant.
Pour M. Thirion, l'ère de la gratuité touche à sa fin. La communication au lecteur d'un document qu'il évaluait en 1976 à 30 F doit atteindre aujourd'hui 50 ou 60 F. (Le prêt interbibliothèques n'est gratuit qu'en apparence : les P.T.T. en subissent le coût.) La transmission d'un document coûte une heure de main-d'oeuvre.
Le paiement des photocopies ne porte que sur de petites sommes, mais l'informatique fait intervenir un matériel coûteux, une liaison téléphonique, le passage par les serveurs, etc. C'est le changement d'échelle des coûts qui impose le remboursement des frais : l'entorse à la gratuité du service public est spécieuse. Au Québec, les lecteurs «extérieurs» doivent payer le prix coûtant des consultations, en tenant compte des frais de personnel; ceux appartenant à l'université ont une certaine franchise. Il y a interconnexion entre les budgets de l'université et de la bibliothèque. (Il s'agit d'universités autonomes recevant des subventions publiques.)
Toutefois, observe M. Chauveinc, même l'achat de la documentation traditionnelle pose le problème lorsque l'on sait que l'abonnement aux Chemical Abstracts coûte maintenant 52.000 F. Il faut garder le principe de la gratuité du service documentaire puisqu'il est payé par la collectivité, à tous les niveaux (bâtiments, personnel, fonctionnement), et même si l'augmentation des coûts et la diminution des crédits nous obligent à faire payer le lecteur.
M. Garreta note que dans le système traditionnel, l'acquisition et l'équipement d'un ouvrage sont payés une fois pour toutes, et le personnel payé au temps et non à la tâche : le nombre des communications (= consultations) n'y change rien. Dans le cas de l'informatique documentaire, au contraire, une fois le matériel acquis, c'est la consultation seule qui coûte chaque fois. D'autre part, comme pour la photocopie, le lecteur acquiert et emporte un document qu'il n'a pas eu la peine de recopier. M. Pierdet observe que le fait même de conserver, le stockage, est une charge, comme les éditeurs ne manquent pas de le proclamer. M. Thirion estime que le coût d'acquisition ne représente même pas 15% du prix de revient embrassant l'entretien et la communication des collections.
Fr. Albaric estime que dans le calcul du prix de la communication il ne faut pas faire entrer en compte le prix d'acquisition et du traitement d'un document, car cela constitue le patrimoine destiné à être conservé. Il faut distinguer au point de vue comptable ce qui entre dans la constitution du capital et ce qui a trait aux frais de la communication proprement dite.
Certes, tout coûte, reprend M. Chauveinc. Il y a des services que la collectivité doit rendre ; qui va payer, la société ou l'individu ? Il faut ou bien aider les bibliothèques en adaptant leurs subventions aux nouveaux besoins, ou aider les lecteurs par les formules de bourses (les B.I.S.T., citées par M. Pierdet).
Fr. Albaric note qu'on a pesé les arguments économiques, peut-on mesurer l'évolution des éléments psychologiques ? La B.P.I. n'a pas encore fait l'expérience.