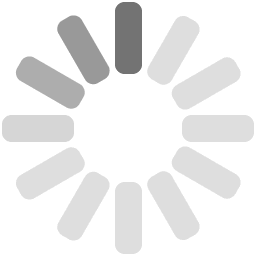Index des revues
- Index des revues
Le point de vue d'un documentaliste
-
Garreta, Jean-Claude
Introduction, p.5. -
Dupuy, Hubert
A la bibliothèque publique d'information, p.5-6. -
Pierdet, Christian
Dans les bibliothèques universitaires, p.9-11. -
Faure, Patrick
Une bibliothèque de lecture publique automatisée, p.12-13. -
Depallens, J.
Télédocumentation (partiellement) payante et consultation de nos fichiers (quasi) gratuite, p.15-17. -
Iung, Jean
Un service I.S.T. payant, p.18-19. -
MeyriÂt, Jean
Le point de vue d'un documentaliste , p.20-21. -
Albaric, Michel
Le point de vue d'une bibliothèque privée , p.22-23. -
de Valence, François
Le point de vue d'un producteur , p.24. -
Lemennicier, Bertrand
L'accès à l'information moderne doit-il rester un service public gratuit ? , p.25-29.
Le point de vue d'un documentaliste
Par Jean MEYRIÂTL'ESPÈCE des documentalistes ne se distingue guère de celle des bibliothécaires par les activités qu'elle exerce ou les techniques qu'elle met en oeuvre. Elle peut néanmoins avoir sur ces activités et sur leur matière un point de vue un peut différent dans la mesure où elle ne remplit pas la même fonction sociale. C'est bien en effet pour remplir une fonction nouvelle que les deux espèces se sont différenciées il y a une cinquantaine d'années (donc tout récemment dans l'histoire des bibliothèques) et que l'on a mis en usage le terme de «documentation» pour désigner une sphère semi-autonome d'activités professionnelles.
Il s'agissait alors de répondre à la situation nouvelle qui s'était instaurée dans les sociétés industrielles, où l'information se révélait comme une ressource essentielle. Il devenait donc nécessaire de tirer le meilleur parti possible de cette ressource pour développer les activités productives, et en premier lieu la recherche, clé de toutes les autres grâce au progrès scientifique et technologique qu'elle entraîne. L'ensemble de techniques que l'on élabore dès lors sous le nom global de documentation, et les organismes qui les mettent en oeuvre, centres ou services de documentation, ont des finalités plus pratiques et définies que les bibliothèques traditionnelles, et sont soumis à une forte exigence d'efficacité vérifiable.
Cette première particularité en entraine une autre : que les services et centres de documentation sont destinés à servir une clientèle déterminée, et non pas un public indifférencié. Ils appartiennent normalement aune entreprise ou à un établissement, privé ou public, dont les ressortissants sont leurs utilisateurs uniques ou privilégiés. C'est envers ces derniers que s'établissent leurs obligations ; ils n'ont pas la charge d'assurer directement un service public, bien qu'ils y participent lorsqu'ils sont insérés par exemple dans le service public de l'enseignement ou dans celui de la recherche. Leurs utilisateurs sont en même temps leurs bailleurs de fonds, sous l'espèce de l'organisme (ou du moins de la communauté particulière) auquel ils appartiennent. D'où une exigence de rentabilité dont ne peuvent évidemment s'affranchir ceux qui y sont assujettis et par laquelle leur mentalité se trouve marquée.
Différence de mentalité qui s'appuie souvent sur une différence de statut. La majorité des services de documentation relèvent du secteur privé ou semi-public de l'économie ; rares sont encore en France les documentalistes qui sont fonctionnaires. Quelques départements ministériels ont créé des corps de documentalistes, mais ceux-ci sont isolés les uns des autres et ne comptent chacun que quelques dizaines de ressortissants. Il n'y a pas de statut national de documentaliste. En revanche, la majorité des bibliothécaires relèvent de la Fonction publique (celle de l'Etat ou celle des collectivités locales) ; ceux qui les rémunèrent et gèrent leur carrière ne sont que des représentants de la puissance publique, et non pas directement de leurs utilisateurs (même s'ils en défendent les intérêts). Cette double différence est entretenue et aggravée (regrettablement, dans l'opinion du signataire de ces lignes) par l'hétérogénéité des systèmes de formation. Pour l'espèce des documentalistes, aucune institution ne remplit une fonction comparable à celle de l'E.N.S.B., qui assure l'autoreproduction de la corporation des conservateurs de bibliothèques. Les établissements déformation ne manquent pas pour les futurs documentalistes, mais ils constituent un système séparé dont les produits ne peuvent pas pénétrer dans la corporation des conservateurs, la réciproque étant presque également vraie.
Constituant ainsi des cellules spécialisées, affectées à la production de l'information nécessaire, dans des organisations vouées à la production (industrielle, technologique, scientifique, financière, pédagogique ou autre), les services de documentation, c'est-à-dire ceux qui les gèrent et ceux qui y travaillent, sont amenés à faire deux constatations. La première est que leur activité est profitable, au moins pour l'organisation qui les entretient, sans quoi ils ne seraient pas entretenus. Mais aussi elle est coûteuse : ils consomment de la matière, de l'énergie, de la main-d'oeuvre, du savoir-faire, des techniques ; ils ont besoin que l'on fasse pour eux des investissements ; ils passent une partie de leur temps à demander les moyens qui leur sont nécessaires.
Certes, cette situation a toujours existé, et elle est très générale, également vraie pour toute bibliothèque. Ce qui est nouveau, c'est la conscience du profit engendré par l'activité documentaire, qui induit une mise en regard du profit et du coût, et par là même oblige à considérer tous les éléments du coût, même ceux qui sont invisibles parce que liés à des investissements consentis par la collectivité et dont il est confortable de lui laisser la responsabilité.
Ce qui est également nouveau, c'est que le progrès technologique met à la disposition des activités documentaires des moyens de plus en plus performants, permettant de rendre des services nouveaux et rapidement perçus comme indispensables, mais exigeant des investissements d'un montant élevé et d'une visibilité spectaculaire (les ordinateurs avec leurs terminaux et aussi leurs logiciels, les lecteurs-reproducteurs de microformes...). Les coûts visibles sont considérablement accrus ; même si les calculs montrent que cet accroissement reste relativement modéré en regard de la masse que constituent les coûts invisibles, il faut bien leur trouver une contre-partie.
Celle-ci ne semble pas pouvoir être attendue de la collectivité, par l'entremise des pouvoirs publics, dans la mesure où lés services rendus le sont non pas à la collectivité dans son ensemble (il ne s'agit pas d'élever le niveau culturel des citoyens, mais de rendre plus grande entre eux l'égalité des chances par un meilleur accès de tous à la même information), mais à des groupes particuliers. Ces derniers apprécieraient certes de bénéficier de l'effort collectif (via l'impôt) de leurs concitoyens, comme le font les banlieusards utilisant les transports en commun à des tarifs préférentiels ou les touristes véhiculés sur le réseau routier national. Mais on peut penser qu'alors ils bénéficieraient d'un privilège plutôt que d'un droit.
Selon ce raisonnement, le droit commun devrait être de faire supporter aux utilisateurs le coût des services qui leur sont fournis. L'information par elle-même n'a pas de prix : elle doit rester un bien
commun de tous, et être rendue accessible à tous aussi facilement et économiquement que possible. Ce qui a un prix, ce sont les moyens humains et matériels mis en oeuvre pour qu'elle parvienne à ses utilisateurs. Dans une économie de marché comme la nôtre, ces derniers doivent payer ce prix. La même logique mercantile permet aux utilisateurs, dans les meilleurs des cas, de profiter de la diminution de prix que peut engendrer la concurrence entre plusieurs fournisseurs, ou encore de tirer avantage d'un choix possible entre plusieurs moyens, de prix différents, pour accéder à l'information nécessaire. C'est bien ce qu'expérimentent maintenant les demandeurs de références bibliographiques : ils peuvent les trouver gratuitement, mais en y passant plusieurs heures de leur temps, dans les fichiers d'une bonne bibliothèque ; ils peuvent les extraire en une demi-heure, mais en payant quelques centaines de francs, d'une banque de données informatisée.
Si l'on accepte cette logique, il faut s'interroger sur les façons de la mettre en oeuvre, et dans doute distinguer plusieurs cas. Le plus simple est sans doute celui des organisations économiquement productives et à finalités lucratives. Elles entretiennent un service de documentation pour que celui-ci leur fournisse, à elle et à leurs collaborateurs, la ressource informative qui améliore leur activité productive ; c'est un des moyens de travail qu'elles mettent à la disposition de ces collaborateurs pour les aider à être le plus efficaces possibles ; l'information est donc gratuite pour ces derniers, les frais de la fourniture étant supportés par l'organisation. Notons que dans ce schéma, comme d'ailleurs dans les deux suivants, le documentaliste est économiquement neutre ; il n'intervient (économiquement) que comme un élément (non négligeable) du coût de la fourniture,
Si la même organisation accepte d'élargir sa « clientèle et de rendre des services informatifs à d'autres que ses propres collaborateurs, il semble normal que les bénéficiaires supportent le coût des services reçus, au moins leur coût marginal. Il n'est même sans doute pas anormal qu'on répercute sur eux une fraction des investissements qu'il a fallu faire pour rendre possible le service.
On peut traiter de la même façon le cas des organismes à but non lucratif qui rémunèrent des collaborateurs pour exécuter des tâches pour lesquelles l'information est une matière première essentielle, comme le sont par exemple l'enseignement, la recherche, le journalisme ou l'édition scientifique. Même lorsque ces activités ne sont pas économiquement productives, ceux qui s'y adonnent sont des producteurs et leur employeur se doit de leur donner les moyens d'être productifs.
Un troisième cas est celui des organismes de toute sorte, à but lucratif ou non, petites entreprises, associations, administrations, écoles, etc., qui ont besoin d'information pour remplir la fonction qui est la leur, mais n'ont pas eu la possibilité ou la volonté de se doterdu mécanisme nécessaire pour la contrôler eux-mêmes. Il est alors inévitable qu'ils la paient à qui peut la leur fournir. Il ne serait pas justifié que cette charge retombe sur la collectivité, ni davantage sur les organisations qui ont consenti les investissements permettant de contrôler et rendre accessible l'information.
Ce troisième cas est suffisamment fréquent pour avoir provoqué l'apparition d'un nouveau type d'organismes, à but évidemment lucratif, spécialement créés pour faire commerce de l'information. Deux types se distinguent dès maintenant : les «centres serveurs» (commerce de gros) et les «courtiers en information» (commerce de détail). Leur rôle d'intermédiaire est très souvent indispensable. Il va de soi que leur intervention augmente le coût pour l'utilisateur final: il n'est pas question qu'ils ne fassent pas payer le service qu'ils rendent, surtout quand on ne peut pas se passer d'eux. Ce n'est pas une raison pour les soupçonner de bénéficier d'une abusive rente de situation. En revanche, on peut espérer que la concurrence qui s'est d'ores et déjà instaurée entre eux bénéficiera au consommateur, et que celui-ci n'aura à payer que le surcoût correspondant à un service réel.
En dehors des circuits commerciaux, les «clientèles captives» constituent un cinquième cas, dont l'exemple le plus apparent est fourni par les étudiants. Ceux-ci ne sont pas directement producteurs d'un bien économique ; ils ne sont pas davantage rémunérés pour l'activité qu'ils exercent, mais celle-ci leur impose de se procurer de l'information, et ils sont bien obligés de se la procurer auprès des organismes qui la détiennent. Il n'y a pas de raison pour que ceux-ci la leur donnent gratuitement. Qui doit alors la payer? Les étudiants eux-mêmes ? Cela serait bien contraire à toutes les habitudes, à moins qu'il ne s'agisse que d'un ticket modérateur destiné à prévenir des usages abusifs et à signaler la valeur du bien accordé. Ou alors l'institution d'enseignement ? Encore faudrait-il qu'elle en reçoive les moyens, lesquels ne peuvent venir que de la collectivité... ou des étudiants eux-mêmes. Autant vaudrait que ce soit directement la puissance publique ; mais au nom de quel principe redistribuer aux étudiants une partie de l'argent des contribuables? On voit que la réponse à ces questions ne peut être que politique.
Il en est de même pour celles que pose une autre catégorie (la dernière dont nous parlerons) : celle des citoyens « désintéressés », qui cherchent de l'information sans autre nécessité que celle de se nourrir l'esprit ou de satisfaire une curiosité, mais qui n'ont pas la possibilité ou le temps d'aller à la B.P.I. ou dans un autre temple du « savoir gratuit ». Ils n'ont guère alors d'autre choix que celui des modalités de la dépense qu'ils doivent faire: ou bien pour une consommation ponctuelle, comme la consultation d'une base de données en mode vidéotex, ou bien pour un investissement comme l'achat de l'Encyclopaedia universalis. L'une et l'autre dépenses dépassant les moyens de certains, et pourtant nous croyons que le droit à l'information doit être reconnu à tout homme.
Il faut donc assurer en terminant que la position de documentaliste n'est pas tout à fait confortable. Travaillant, dans la majorité des cas, comme agent d'un organisme dont la finalité est une certaine production, bien qu'il ne tire lui-même aucun avantage personnel de cette production, il doit reconnaître à l'information qu'il traite la qualité d'un bien utile et coûteux, ayant donc un prix. Il est certain que ce prix doit être payé, et il ne voit pas de difficulté à ce que ce soit par celui qui en bénéficie, chaque fois qu'il y a un bénéfice escompté. Mais que se passe-t-il lorsque ce bénéfice est purement moral ou culturel ? Il y a là des valeurs qui, comme on dit, n'ont pas de prix. Reste à assurer à tout citoyen un accès réel à ces valeurs. Faut-il penser à instaurer un service public gratuit de l'information comme l'est celui de l'éducation ? Mais ne serait-ce pas favoriser indûment ceux qui utilisent l'information comme un bien économique? Le documentaliste peut poser la question, il ne saurait y répondre seul.