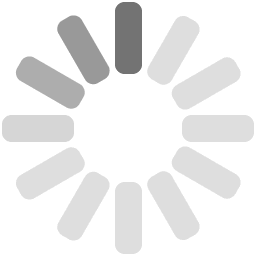Index des revues
- Index des revues
L'évolution des politiques culturelles et les métiers de la bibliothèque
-
Poujade, Robert
Séance inaugurale, p.18-20. -
Miquel, André
Discours d'André Miquel, p.20-22. -
Pisier, Evelyne
Intervention d'Evelyne Pisier (extraits), p.22-24. -
Gasol, Jean
Intervention de Jean Gasol, p.25-28. -
Renoult, Daniel
Intervention de Daniel Renoult, p.28-31. -
Piquemal, Marcel
Fonction publique et formation professionnelle, p.32-33. -
Guyot, Brigitte
L'interprofessionnalisme , p.34-35. -
Gintrand, Philippe
Les métiers de la librairie , p.37-38. -
Pavlidès, Christophe
La formation au patrimoine des bibliothèques , p.39. -
Alexandre, Jean-Louis
Profession restaurateur, p.40-41. -
Le bitouzé, Corinne
Conservation et formation à la Bibliothèque nationale, p.42-43. -
Lerin, Varda
Audiovisuel, p.44-45. -
Rioux, Jean-Pierre
L'évolution des politiques culturelles et les métiers de la bibliothèque , p.46-51. -
-
Assemblée générale
-
Rapport d'activité 1990, p.52-56. -
Rapport d'orientation 1991, p.56-58. -
Motions, p.58. -
Formation professionnelle, p.59-60.
-
-
Dazy, Jean-Jacques
Une recette bien de chez nous, p.63-64.
L'évolution des politiques culturelles et les métiers de la bibliothèque
Par Jean-Pierre Rioux, Directeur de recherche CNRSC'est avec grand plaisir que je tente d'argumenter un peu avec vous sur l'évolution des politiques culturelles dans notre pays et sur quelques-uns de leurs effets d'entraînement pour les métiers de la culture, et particulièrement les vôtres. Qui dit évolution, dit histoire et mon plaisir se double donc d'une vive reconnaissance envers les organisateurs de ce congrès, qui ont pensé que la voix d'un historien ne serait ni déplacée ni cacophonique dans votre discussion.
Je vous épargnerai, rassurez-vous, les certitudes trop commodes du discours étroitement chronologique, qui ferait défiler des étapes et des inflexions. Il me semble que pour la bonne économie de notre réflexion, il suffit de tirer, à propos des politiques culturelles, le fil, si solide, d'un constat fondateur et original. Le voici : dans le concert des grandes nations développées, la France s'est distinguée, et se singularise toujours, par l'effort séculaire que l'Etat, les collectivités locales et tous leurs fonctionnaires ou agents ont consacré à la transmission, au partage et à l'enrichissement d'une «culture» de plus en plus largement entendue, dont ils ont estimé qu'elle relevait sans conteste d'un domaine public et qu'elle était donc passible d'une administration au nom de l'intérêt général. Ce fut le débat des hommes de la Révolution, quand ils reçurent des biens culturels du Roi, du clergé, des nobles, des émigrés et des suspects. C'est encore le nôtre. Ni les principaux pays européens, ni les Etats-Unis, ni le Japon n'ont jamais porté une attention publique aussi soutenue et aussi constante à la création et au patrimoine, à la démocratisation et à l'orchestration d'une vie culturelle tenue pour héritée et conquérante à la fois (1) '.
On se gardera sans doute de chiffrer trop précisément cet intérêt exceptionnel. Car le bilan financier n'est pas si flatteur. Les premières remarques des historiens laissent en effet nettement entendre que cette sollicitude publique, visible dès la Monarchie censitaire et le Second Empire, puis affichée sous la forme républicaine, n'atteignit jamais, même aux plus hautes eaux lâchées par les grands argentiers, 1% de l'addition des divers chapitres du budget générale (2) L'Eldorado de ce «1%» qui hante depuis trois décennies les hôtes de la rue de Valois fut et demeure ainsi, tout au long de notre âge démocratique, un rêve inaccessible.
Et c'est donc, à tout le moins, une sorte de mystère historique que la persévérance avec laquelle furent associées une générosité si chiche et une ambition si haute. Voilà bien, conclueront les esprits chagrins et les chantres de la société civile, un idéal sans moyens suffisants, un signe supplémentaire de la propension si française à laisser proliférer si médiocrement l'Etat-touche-à-tout et ses ronds-de-cuir. Néanmoins, rétorqueront les optimistes, qu'une vie commune, certes austère, mais si durable et si entêtante, ait été officialisée entre l'Etat moderne, les pouvoirs locaux et la vie intellectuelle et artistique de la Nation est un autre signe, plus encourageant : il y aurait une sorte de nécessité bien française, une légitimité historique, à étendre les curiosités et les excitations d'une «politique culturelle».
Protection, création, diffusion
Dans la France d'Ancien Régime, la monarchie fut, on le sait, la protectrice des arts et des lettres. Elle exerça sans broncher son droit régalien de conservation, de surveillance et d'enrichissement d'un patrimoine qui venait de loin : d'aussi loin qu'on avait pu percevoir et conserver en mémoire le sentiment que la France était, tout en un, un héritage et un idéal, une personne et un Etat. (3) Et ce fut à l'honneur de l'Etat laïcisé par la Révolution que de n'avoir pas renié cette tradition. De Surintendance des Bâtiments en Maison de l'Empereur, de «Beaux-Arts» en «Arts et Lettres», d'Instruction publique en Education nationale, d'Affaires culturelles en «Culture et Communication», administrations, institutions, établissements publics, associations agréées ont géré cet héritage au nom de la Nation, en ne faisant pas fi de ce décret de 1792 qui chargeait l'Etat, au nom de la collectivité nationale et souveraine, de «préserver honorablement» une mémoire commune.
Ainsi put être mis à peu près à l'abri du vandalisme et des ravages du temps un vaste ensemble devenu bien national, reçu des vaincus de la Révolution. Palais nationaux et anciens domaines de la Couronne tombés dans la Liste civile, édifices religieux émargeant au budget des Cultes, monuments historiques, musées, bibliothèques, lieux de recherche et archives relevant de différents ministères, tout fut tant bien que mal recensé, protégé, conservé et parfois restauré, avec le concours disparate mais constant des administrations centrales, des départements et des communes. Ainsi fut sauvegardée et donc pérennisée par l'Etat souverain la trace patrimoniale d'un être collectif.
Ce même Etat moderne devint, dans la même logique et dans la même continuité, de la Monarchie à la République, le protecteur et le mécène, libéral mais attentif, de la création culturelle. Il sombra certes à l'occasion dans un exercice plus qu'attentif de ses droits de censeur; ce qui, en retour, entretint le topos libertaire sur sa bêtise et son autoritarisme liberticide (4) . Il n'hésita pas aussi à mobiliser l'intelligence pour les besoins exceptionnels de ses propagandes de guerres ou de paix, sans jamais sombrer, il est vrai, dans les perversions d'un art officiel proprement totalitaire (5) . Mais il sut être continûment avocat et protecteur, inscrivant dans la loi un droit et une promotion morale des écrivains et des artistes trop souvent jetés, désarmés, dans le maquis du marché libre ou livrés aujourd'hui, parfois, aux managers des industries culturelles. Il a aidé la création par des commandes, par des politiques du livre, des arts plastiques, du théâtre ou du cinéma, puis par un appel récent, trop peu entendu mais topique, au mécénat privé.
Cette action-là, parce qu'elle touche au plus intime des affirmations de l'esprit, n'a jamais cessé d'être en débat. Elle a été accusée de favoriser par conservatisme les seuls artistes bien-pensants, de violer la conscience des plus purs génies, de dilapider des ressources que la collectivité pouvait mieux utiliser ailleurs, de renforcer un interventionnisme tous azimuts confortant l'autoritarisme parisien, et qui ne serait donc pas à l'honneur de la France plurielle du Progrès.
Ne dissimulons pas qu'il y eut bien souvent dans ces bénédictions et ces aides officielles, dans cet activisme de l'Etat et des collectivités mécènes, du volontarisme patelin ou carrément progressiste, de Dujardin-Beaumetz à Jean Zay ou Jack Lang (6) . Mais n'oublions pas néanmoins qu'il s'agit d'un académisme à part entière, qui donna sa sanction officielle à des canons créateurs que les corporations artistiques avaient déjà intériorisés docilement et que, par conséquent, ces aides n'ont souvent été que l'enregistrement assez mécanique d'un état social donné et daté du rapport des Français à la culture ; et qu'il serait par conséquent bien imprudent de le renier si l'on souhaite toujours se réclamer des continuités françaises. Et donc qu'il n'est ni étrange ni déshonorant de voir une démocratie libérale mettre en place aux heures difficiles, au nom de la collectivité tout entière, un dispositif de soutien défensif à des formes de création menacées par une mutation du marché économique (qu'on pense au livre ou à la musique depuis trente ans, par exemple).
A ces fonctions de conservation et de transmission, de protection et de mécénat, l'Etat et les collectivités territoriales a adjoint un troisième type d'interventions : celles qui favoriseront une redistribution sociale et spatiale des biens culturels entre tous les Français. Au nom de la solidarité nationale dont ils se font l'interprète, forts de l'idéal démocratique qui les inspire, ils ont souhaité favoriser ainsi l'équité d'un partage de la culture et espéré qu'en ralliant au passage des séparés ou des marginaux, ils favoriseraient un enrichissement et un renouvellement de l'activité culturelle générale du pays. Cette politique qui part à la rencontre des publics défavorisés a été inaugurée aux heures ensoleillées du Front populaire. Elle a été poursuivie depuis lors sans hiatus ni regrets, sous des formes diverses, en coordination plus ou moins étroite de différents départements ministériels et avec un très important secours des collectivités locales (7) .
Soutien à l'enseignement universel des arts plastiques, de l'art dramatique, de la musique, de la danse ou du cinéma dans le système scolaire ou en dehors de lui, distribution plus massive et plus indistincte des oeuvres, meilleur partage des biens patrimoniaux dans les bibliothèques publiques, les musées, les conservatoires, les maisons de jeunes ou les Maisons de la culture, renouvellements de la création par l'amateurisme orchestré, aide à une croissance harmonieuse des nouveaux canaux de diffusion et de médiation culturelle, coopérations variées avec les cultures du monde entier, décentralisation des activités d'en-haut et encouragements aux initiatives régionales : le dispositif du meilleur partage a fière allure et sa diversité, sa complexité même, signalent que la mise en oeuvre de la politique qu'il traduit ne fut jamais conçue sur un mode caporalisé et uniforme.
On pourra donc soutenir qu'il y eut historiquement, depuis 1789, amalgame à géométrie variable de rapports anciens et nouveaux des pouvoirs publics à la culture. Dans le brassage du vieux passé régalien, de l'expérimentation d'un libéralisme tempéré et de l'affirmation d'une haute ambition de démocratisation, l'Etat et les pouvoirs locaux n'ont pas démérité. Et le triptyque «Protection, Création, Diffusion» dont les experts du IVe Plan, dans les années 1960, entérineront la pertinence nationale formule assez bien ce qu'on recouvre si volontiers sous le vocable, assez élastique et parfois manié dans l'anachronisme, de «politiques culturelles» publiques.
Dynamique sociale de la consommation culturelle
Toutefois, une question centrale fut historiquement assez mal résolue : celle qui touche à la mise en harmonie de cette somptueuse ambition publique à trois volets avec l'évolution des us et coutumes des Français en matière de création et de consommation de biens culturels. Comment gérer politiquement le dynamisme social de l'appétit culturel ? Et sans que l'Etat de Droit puisse, par nature et par vocation, donner à cette gestion une coloration idéologique trop voyante.
On pourrait suivre cette interrogation au long de maintes périodes historiques. Mais c'est sans doute aux dernières décennies de notre siècle qu'elle s'applique le mieux, dès lors que le marché culturel a connu les bouleversements que l'on sait. Car toutes les politiques culturelles, à tous niveaux de décentralisation éventuelle et quels que soient leur activisme et leur générosité, subissent alors de plein fouet l'impérieuse pression sociale de ce qu' Olivier Donnat nomme les trois «lignes de fuite».
La première tient dans l'expression très prégnante de loisirs de masses (8) , surtout en milieu urbain, auxquels les Français n'ont accédé que dans la confusion des genres, dans la démultiplication d'activités mal hiérarchisées, où la culture entre en compétition pas toujours victorieuse, loin de là, avec le sport, le tourisme ou l'exercice de l'économie souterraine : l'histoire de la lecture depuis un quart de siècle offre, par exemple, la démonstration des effets culturellement ravageurs de cette démultiplication des activités de loisir et souligne combien cette nouveauté sociale prend à contre-pied une politique de la lecture publique dont l'élaboration puis la mise en oeuvre courent parfois assez loin derrière une évolution sociale singulièrement cavalière.
La seconde fuite en avant s'observe à travers la massification proprement économique d'une mise à disposition d'attitudes, de biens et d'équipements qualifiés de culturels. De l'habillement au design ou à la cuisine, de l'exaltation de la «culture d'entreprise» au sponsoring artistique, le culturel a envahi de très larges secteurs de l'activité économique. Et a proliféré un discours très médiatisé et toujours supposé «créatif» qui mêle, dit Paul Yonnet, «jeux , modes et masses» (9) , qui exalte l'individu consommateur et fait appel à sa richesse culturelle intérieure pour exciter une créativité généralisée dont l'économie obéit, de fait, aux strictes lois du marché. Cette propension à magnifier des «industries culturelles» prend elle aussi à rebours, et partant ruine peu à peu, une politique de démocratisation et de décentralisation qui n'entendait résister à la massification marchande des pratiques culturelles qu'en offrant des «produits» supposés meilleurs parce qu'ils auraient été subventionnés par la puissance publique, mais qui, de fait, sont emportés avec tous les autres dans le tourbillon d'une concurrence sauvage qui régit ce marché en pleine expansion désordonnée.
Enfin, la troisième fuite en avant est celle liée aux développements d'une communication tous azimuts, dont l'impétuosité a acculé l'Etat sur une ligne défensive (10) : celle qui, dans les années 1980, consiste à préserver un espace public qui ne subirait pas la concurrence trop déloyale d'un marché des médias largement privatisé et entraîné dans la spirale de la libéralisation extrême et de la dictature de l'Audimat. Ici encore, les politiques trop datées deviennent inévitablement très datées.
Dans ce paysage social zébré par ces trois tendances lourdes qui privatisent le culturel à cadence accélérée, dans ce pays de plus en plus inséré dans un jeu mondial qui favorise l'excitation gratuite et souveraine du marché de la consommation et de la communication culturelles, comment donc tenir désormais ce cap, à si fortes dimensions historiques, d'une intervention de l'Etat et des collectivités locales dans le domaine de la culture ?
La réponse de type administratif n'a pas outrepassé les vertus préventives ou curatives de sa propre logique. L'histoire de l'évolution structurelle qui a conduit des «Beaux-Arts» aux «Arts et Lettres», puis aux «Affaires culturelles» et à la «Culture et Communication», celle des personnels mis à disposition de ces ambitions aux dénominations fluctuantes, seront instructives, assurément, à supposer qu'on les conduise enfin avec détermination.
Elles ne devraient pas dispenser cependant de partir à la recherche d'une autre histoire, plus contemporaine : celle qui tenterait d'expliquer les avatars de ces «décrochages» successifs qui, depuis les années 1930, ont certes singularisé mais isolé aussi une administration de la Culture face aux vastes ensembles de l'Education et de la Communication. Car la redoutable question est toujours ouverte : comment donner vie à des politiques culturelles dont l'administration a été socialement si délestée et dont les attendus ont peine à suivre une France culturelle où les mutations se succèdent sans s'enchaîner, en vagues déferlantes et si peu maîtrisables ?
Définition(s) du métier de bibliothécaire
Comment ces trois lignes politiques, la monarcho-patrimoniale, la libéra-lo-créative et la démocratique ont-elles été appliquées, incarnées, affichées et affinées à la fois par des professionnels, et particulièrement ceux des bibliothèques ? Il me semble qu'à ce propos, il est difficile de parler d'harmonie. Car, à l'évidence, une de ces lignes est tracée en pointillés dès qu'on se penche sur l'histoire des bibliothèques en France : la ligne libérale d'encouragement à la création. Autrement dit, la bibliothèque fut et demeure un réceptacle et un lieu de communication, et fort peu un lieu d'aide à la création de livres, un lieu d'accueil et de débat pour des auteurs qui puiseraient de la force, à la bibliothèque, au contact avec un public ; ce qui, de fait, l'a exclue de maints ressourcements culturels qui ne pouvaient venir que de la création. C'est si vrai qu'aujourd'hui une politique du livre et de la lecture qui aide les créateurs, par le biais de multiples encouragements aux revues, aux éditeurs ou aux auteurs, ne passe pas, ou ne passe guère, par la bibliothèque. Restent les deux autres lignes, la patrimoniale et la démocratique. Celles-ci, en revanche, ont été constamment au coeur du dispositif des politiques publiques pour les bibliothèques et les bibliothécaires. Et la notion-clé, celle qui a pris sa pleine souveraineté tout au long du XXe siècle, en étroite association avec l'émergence et la diversification des personnels des bibliothèques, la notion de lecture publique désigne à la fois un domaine d'intervention de l'Etat ou des collectivités locales, un type de gestion spécifique peu à peu imposée par la profession de bibliothécaire et une pratique plus démocratique de la lecture, par le libre accès, l'abondance et la fraîcheur des collections, la variété des supports médiatiques. Conserver des livres anciens reçus en héritage et encadrer des lecteurs toujours plus nombreux : ces deux références fondatrices de la lecture publique sont celles-là même que mit en exergue, dès sa fondation en 1906, l'association qui sut dire l'essentiel sur l'orientation des bibliothèques modernes : la vôtre, l'Association des bibliothécaires français «De l'orientation des bibliothèques modernes», tel est le titre même de l'article de 1907, sous la plume de Charles Sustrac, votre premier Secrétaire général en titre, qui lança l'offensive pour une définition de la bibliothèque qu'on ne lirait enfin qu'à travers le bibliothécaire (11) .
Celui-ci, est-il dit, ne peut plus être ce savant qui concède à quelques lecteurs, triés sur le volet et toisés d'assez haut, le privilège d'avoir accès, dans un lieu clos, au trésor hérité, ces dix à quinze millions de volumes manuscrits ou imprimés, ex-biens royaux, d'Eglise, d'émigrés ou de suspects qui, en moins de quinze ans, de novembre 1789 à pluviôse an XI, avaient été entreposés, conservés et mis à disposition des citoyens dans des bibliothèques nationales et 150 bibliothèques municipales, dans une grande fièvre de catalogage et d'érudition qui secoua le premier XIXe siècle. Mais le bibliothécaire n'est pas non plus un militant du bonheur du peuple, un bénévole de progrès ou un pédagogue rentré qui rivaliserait à armes inégales avec l'instituteur : l'histoire du XIXe siècle a été tout emplie de ces hésitations sur sa vocation, de ces conflits à la marge, de cette obsession du livre ferment de démocratie, des interrogations sur la nature exacte du lieu où le pain normalisé de la lecture doit être proposé aux esprits méritants, aux amis de l'instruction, aux âmes trempées par le «bon» livre. Non, disent les fondateurs, le bibliothécaire n'est ni un érudit qui décourage le lecteur moyen, ni un militant qui infantilise et catéchise ses frères, ni un conservateur farouche perdu dans ses propres travaux, ni un pédagogue honteux ou au rabais : il est, il n'est qu'un technicien des lectures au service du citoyen, qu'un professionnel de la lecture d'autrui.
Tout était dit. Mais, vous le savez, cette définition ne s'imposa pas sans mal, puisque, tour à tour, le patrimonial et le démocratique, la conservation méticuleuse et la rentabilisation civique et instrumentale, traversèrent la profession, la scindèrent même, avec toutes les tentations séparatistes dont l'histoire de votre ABF est pleine. Je n'ai pas le loisir ici, aujourd'hui, de retracer ce conflit nourricier entre une bibliothèque lieu de mémoire et une bibliothèque boulangerie du pain de l'esprit. Mais l'essentiel fut bien d'avoir dégagé l'idée que dans le rapport des Français au livre devait exister un espace civique qui n'était pas scolaire.
Il faut cependant mesurer le rôle souvent éminent et le poids toujours significatif de la bibliothèque scolaire et universitaire dans la vision d'ensemble de la profession, dès lors qu'il n'a jamais été dénié à l'école son rôle premier et décisif dans l'apprentissage de la lecture, dans la montée en force d'un besoin de livres aussi utiles qu'obligatoires, et dans l'idée que le progrès de la connaissance passe toujours par une consultation de l'imprimé. Cette force du bibliothécaire scolaire a, par contraste, déporté le reste de la profession, dans les bibliothèques non scolaires, bien plus du côté du livre ou du support imprimé ou imagé que du côté de l'activité même qui fait courir des citoyens à la bibliothèque : la lecture, avec ses motivations si diverses. Le bibliothécaire devint ainsi, nécessairement, le professionnel du livre avant d'être celui de la lecture. Grave hiatus, ou permanent écartèlement, entérinés en 1975 dans le partage entre Education nationale et Affaires culturelles, qui expliquent sans doute pourquoi dans ce pays si soucieux de lecture, il n'y a jamais eu, il n'y a toujours pas de loi unique d'ensemble, institutionnelle en quelque sorte, applicable sur tout le territoire, sur les bibliothèques et les bibliothécaires.
Les bibliothécaires ont en outre suivi très banalement la pente sur laquelle ont glissé - le verbe n'est pas péjoratif dans mon esprit - tant d'autres professions de la culture : celle qui fait passer le métier de l'animation au statut, puis de la professionnalisation à la fonctionnarisation, dans une logique de service public. Rien que de très banal ici, je le répète. Mais les bibliothèques, comparées aux musées, aux maisons de la culture, aux archives, aux monuments historiques ou aux théâtres nationaux, ont appliqué cette loi générale de façon originale. Cette originalité lui vient des origines : elle est un lieu où l'on stocke et communique, si bien qu'il y aurait beaucoup à dire sur la spécificité fondatrice de vos métiers : vous avez à gérer conjointement un espace, des objets et un public. Et, par conséquent, les professions de la bibliothèque ne peuvent qu'être particulièrement sensibles, dans leur évolution, à l'ensemble des mutations technologiques et sociologiques qui saisissent chacune de ces trois composantes de la vie quotidienne du bibliothécaire.
Qu'il s'agisse de spécialisation, de hiérarchisation, de formation continue, d'accès aux différents corps, toutes vos professions se sont diversifiées, affrontées, amalgamées ou renouvelées au rythme de ces trois impératifs vécus comme une fierté et une hantise par toutes celles et tous ceux qui travaillent dans une bibliothèque : mieux aménager les murs ; classer et manipuler des objets culturels selon des règles techniques qui évoluent sans cesse ; saisir à temps l'évolution des besoins et des goûts du public. De bibliothèque en médiathèque, de codage en informatisation, d'échange en automatisation et banques de données, la technologie a modelé et modèle toujours les professions de la bibliothèque (12) .
Volonté nationale et décentralisation
J'en viens, pour finir, à l'évolution la plus récente, celle qui, je le sais, vous exalte, vous mobilise et vous tourmente à la fois : la décentralisation. Celle-ci participe sans doute, peu ou prou, des trois lignes anciennes des politiques culturelles dont je parlais tout à l'heure. Mais, par sa massivité et sa soudaineté, elle intervient dans une atmosphère de relative a-pesanteur historique. Vous savez mieux que moi ce qu'a été l'action si neuve des bibliothèques centrales de prêt aux 15 millions de volumes, depuis 1946, en direction des villes de moins de 10.000 habitants et des zones rurales : les voici depuis 1986 dévolues aux départements, sans réglementation assez claire et sans que les vertus culturelles de conseils généraux aient été clairement exposées. Est-ce à dire que l'Etat, dans une politique tacite de désaménage-ment du territoire, aurait abandonné les zones rurales ou semi-rurales à la friche régionale ? Qu'en est-il par ailleurs du mot - si à la mode du côté de la Bibliothèque de France - de «réseaux» entre les bibliothèques, à coup de bibliographie informatisée, de formations communes, de centre national de coopération ? Qu'en est-il aujourd'hui d'une volonté nationale de penser et gérer un service public des bibliothèques sur l'ensemble du territoire français ? (13) Je laisse ouverts tous ces points d'interrogation, et je me garderai d'en tirer des conséquences au plan des statuts présents et à venir des métiers de la bibliothèque. Je signale simplement, en historien, que la profession de bibliothécaire s'est constituée, il y a près d'un siècle, en posant pour axiome, disait notre cher Charles Sustrac déjà cité, que «c'est pour le public que le bibliothécaire doit travailler». Mais ce public a toujours relevé, relève encore et toujours, vous en conviendrez, d'une définition civique et, par conséquent, nationale.
2. 'Voir Paul Gerbod, «L'action culturelle de l'Etat au XIXe siècle», Revue historique, n°548, octobre-décembre 1983. Pour une première approche des questions évoquées dans cet article, voir aussi Guy Saez, «Les politiques de la culture», dans Madeleine Gravitz et Jean Leca dir., Traité de science politique, vol. 4, Les politiques publiques, Paris, P.U.F., 1985, p.387-422 ; André-Hubert Mesnard, L'action culturelle des pouvoirs publics, Paris, LGDJ, 1969; Rémi Caron, L'Etat et la culture, Paris, Economica, 1989; La politique culturelle de la France. Rapport du groupe d'experts européens et rapport national, Paris, La Documentation Française, 1988; Pascal Ory, L'aventure culturelle française (19451989), Paris, Flammarion, 1989; Marc Fumaroli, «De Malraux à Lang : l'excroissance des affaires culturelles», Commentaire, 18, été 1982 et Olivier Donnat, «Politique culturelle et débat sur la culture», Esprit, novembre 1988. retour au texte
3. On convoquera ici toutes les démonstrations de la somme, en voie d'achèvement, sur Les lieux de mémoire , dirigée par Pierre Nora, Paris, Gallimard, depuis 1984. retour au texte
4. Voir, pour le livre, Censures, Paris, Centre Georges Pompidou, 1987. retour au texte
5. Sur le meilleur ou, plutôt, le pire exemple, voir Jean-Pierre Rioux dir., La vie culturelle sous Vichy, Bruxelles, Complexe, 1990. retour au texte
6. Voir Jean-Pierre Rioux, «L'impératif culturel», L'Histoire, n°143, avril 1991, p. 54-60 (numéro spécial sur «Les années Mitterrand, 1981-1991». retour au texte
7. Voir, par exemple, Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli dir., Les politiques culturelles municipales. Eléments pour une approche historique, Paris, CNRS, Cahier de l'IHTP, n°16, septembre 1990. retour au texte
8. Voir Joffre Dumazedier, Révolution culturelle du temps libre (1968-1988), Paris, Méridiens Klincksieck, 1988. retour au texte
9. Voir Paul Yonnet, Jeux, modes et masses. La société française et le moderne (1945-1985), Paris, Gallimard, 1985 et Gilles Lipovetsky, L'empire de l'éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes, Paris, Gallimard, 1987. retour au texte
10. Voir Jean-Noël Jeanneney, Echec à Panurge, Paris, Le Seuil, 1986. retour au texte
11. Voir Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard dir., Discours sur la lecture (1880-1980), Paris, Bibliothèque publique d'information, Centre Georges Pompidou, 1989, p. 106. J'ai beaucoup emprunté pour ces quelques remarques à ce remarquable travail collectif, ainsi qu'à Noë Richter, La lecture et ses institutions. La lecture publique (1919-1989), Bassac, Editions Plein Chant, 1989. retour au texte
12. Voir le récent dossier sur «Lecture et bibliothèques» paru dans Esprit, mars- avril 1991, p. 65-129, où j'ai largement puisé pour formuler ces remarques finales. retour au texte
13. Voir sur tous ces points l'article de Bertrand Calenge dans le numéro d'Esprit cité ci-dessus, auquel j'emprunte beaucoup. retour au texte