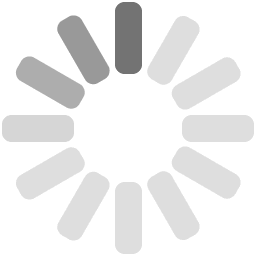Index des revues
- Index des revues
Les approches économiques de la culture
-
Beneteau, René
Allocution d'ouverture, p.8-9. -
Belayche, Claudine
Présentation générale, p.10. -
Sagot-duvauroux, Dominique
Les approches économiques de la culture , p.11-23. -
Rizzardo, René
Les établissements publics culturels territoriaux aujourd'hui , p.24-27. -
Gèze, François
La double nature du livre , p.28-31. -
Belayche, Claudine,
E., M.,
Lemennicier, Bernard
Les bibliothèques municipales et la déréglementation des services publics , p.32-37. -
-
Les coûts de l'information
-
Diez, Alain
La médiathèque de la cité des sciences et de l'industrie , p.39-44. -
Chantereau, Danielle
L'ina entre missions de service public et contexte marchand , p.45-48.
-
Diez, Alain
-
-
Créer des ressources propres pour les bibliothèques
-
Bulpitt, Graham
Les services tarifiés dans les bibliothèques anglaises , p.50-55.
-
Bulpitt, Graham
-
-
Des bibliothèques universitaires et de recherche travaillent aussi pour des entreprises privées
-
Casseyre, Pierrette
La bibliothèque interuniversitaire de médecine , p.57-58. -
Maximin, Anny,
Roche, Dominique
Prestations aux entreprises, p.59-64.
-
Casseyre, Pierrette
-
-
Table ronde autour des coûts des services en bibliothèque
-
Chatenay-Dolto, Véronique
Intervention de Véronique Chatenay-Dolto, p.66-70. -
Jolly, Claude
Intervention de Claude Jolly, p.71-74. -
Casseyre, Jean-Pierre
Intervention de Jean-Pierre Casseyre, p.75-77. -
Groshens, Jean-Claude
Intervention de Jean-Claude Groshens, p.78-81.
-
Chatenay-Dolto, Véronique
-
-
Quels choix financiers pour développer une politique de service public de la lecture et de la documentation?
-
Duperrier, Alain
Présentation, p.83-84. -
Belayche, Claudine
Introduction, p.85-86. -
Rodet, Alain
Intervention, p.87-88. -
Lerebours, Jean-Loup
Quelques résultats de l'influence des politiques tarifaires sur le fonctionnement des..., p.89-92. -
Pasquignon, Anne
La politique tarifaire de la bnf , p.93-95. -
Bertrand, Annie
Un exemple de politique tarifaire dans une bibliothèque universitaire française, p.96-99. -
Guichard, Marc
L'inist-cnrs , p.100-102. -
Borchardt, Peter
Les formes de tarification dans les bibliothèques allemandes , p.103-106.
-
Duperrier, Alain
-
-
Les coûts de la conservation et la valorisation du patrimoine
-
Compte, Jean-Marie
Introduction, p.108. -
Brèthes, Jean-Pierre
Le patrimoine écrit en poitou-charentes , p.109-111. -
Arnoult, Jean-Marie
Le patrimoine et les tutelles , p.112-118. -
Etienne, Michel
La place du patrimoine dans les nouvelles constructions de bibliothèques , p.119-123. -
Marcetteau-paul, Agnès
Le fonds jules verne à la bibliothèque municipales de nantes , p.124-125. -
Firouz-Abadie, Geneviève
Le fonds d'argenson à la bibliothèque universitaire de poitiers , p.126-128. -
Corpet, Olivier
Ce que l'IMEC apporte, p.129-130. -
Bertinet, Lionel
Mécénat d'entreprise et patrimoine, p.131-135. -
Duchemin, Pierre-Yves
La numérisation des documents graphiques , p.136-142. -
Bogros, Olivier
Le recours au multimédia pour la mise en valeur et la diffusion des fonds patrimoniaux , p.143-146. -
Belayche, Claudine,
Jelmini, Thierry,
Van bésien, Hugues
En passant par l'expo, p.147-162.
-
Compte, Jean-Marie
- * Sous l'angle de l'économie industrielle, les activités culturelles sont considérées comme des activités économiques à part entière, créatrices d'emploi et de valeur ajoutée, productrices de biens et services destinés aux ménages. On cherche alors à mesurer le poids de chaque secteur culturel dans le PIB, on analyse les structures de marché et les stratégies des entreprises, on spécifie les caractéristiques de la demande. On en déduit des éléments prospectifs.
- * Sous l'angle de l'économie publique, il s'agit principalement de déterminer les arguments économiques qui fondent ou qui remettent en cause l'intervention publique dans le secteur culturel. L'approche économique libérale attribue à l'État le rôle de correcteur des imperfections du marché. L'État est en quelque sorte le négatif du marché, et son périmètre de compétence est dicté par celui du marché. L'intervention publique en faveur de la culture se justifie sous cet angle en raison de l'inaptitude du marché à produire de façon efficace ces biens. Les économistes d'inspiration keynésienne élargissent le rôle de l'État à une fonction de redistribution et de régulation. Les arguments économiques ne sauraient cependant épuiser les fondements de l'intervention publique dans le secteur culturel.
- * Soit, comme dans les pays anglo-saxons, on privilégie le contrôle des prélèvements obligatoires pour garantir le dynamisme des entreprises : on se résigne alors à voir se développer des services culturels, sociaux ou de santé à deux vitesses, avec d'un côté, pour les classes aisées, des services privés coûteux mais de qualité et de l'autre, pour les classes défavorisées, des services publics peu coûteux mais dont la qualité se dégrade régulièrement faute d'une augmentation des moyens qui leur sont accordés.
- * Soit on refuse une culture ou une santé à deux vitesses : pour maintenir la qualité des services publics, on s'expose alors à une augmentation continue des dépenses publiques et donc des prélèvements obligatoires, au risque de compromettre la croissance.
- * Une première possibilité de limiter l'incertitude relative aux succès publics des biens et services culturels consiste à rechercher des standards qui plaisent aux consommateurs. On identifie et on reproduit des recettes du succès. Le rôle du producteur est en général déterminant dans la définition du produit final, qui répond à de savantes études de marché. L'auteur joue souvent le rôle de simple exécutant. Dans le domaine littéraire, on fait référence ici aux livres de genre, littérature sans auteurs ; dans le domaine cinématographique, les genres hollywoodiens répondent à ce type de préoccupation ; dans le domaine théâtral, c'est le théâtre de boulevard ; une autre facette de cette stratégie consiste à imiter une oeuvre qui a connu le succès. Ce sont par exemple les numéro 2, 3, 4 d'un film à succès, ou la promotion de groupes clones de groupes musicaux à succès, ou encore dans les arts plastiques les peintures « à la manière de ».
- * La deuxième stratégie consiste à investir en amont des coûts importants de façon à s'attacher les services des stars du moment, que ces stars soient des artistes ou des techniciens. Il s'agit pour une galerie de peinture ou un éditeur d'obtenir l'exclusivité d'un grand peintre ou d'un grand écrivain ; il s'agit dans le domaine du cinéma de réaliser des superproductions réunissant le gotha artistique et technique du moment. L'hypothèse sous-jacente à cette stratégie est que l'augmentation des risques financiers liée au gonflement des budgets sera plus que compensée par la diminution du risque artistique. Elle est d'autant plus efficace que, face à l'abondance de produits offerts, les produits stars ont un accès privilégié aux médias et ont donc plus de chances d'atteindre leur public. Ainsi, le succès des films américains tient sans doute au fait que le budget moyen d'un tournage est de l'ordre de 300 millions de francs tandis qu'en France il n'atteint que 31 millions de francs. Enfin, les oeuvres stars ont généralement la chance d'être achetées avant même d'être produites. Pour les films, les télévisions se battent afin d'obtenir les droits de diffusion de ces oeuvres alors qu'elles sont beaucoup plus réticentes à faire de même pour les oeuvres sans notoriété.
- * La troisième stratégie consiste enfin à répartir le risque de production sur un nombre important d'oeuvres, en espérant que le succès de certaines d'entre elles permettra d'éponger les pertes réalisées sur la majorité. Une telle stratégie est souvent qualifiée de modèle éditorial, dans la mesure où elle est surtout présente dans l'édition. Elle n'est cependant possible que si l'écart entre le coût de production et les recettes potentielles est suffisamment grand pour permettre une mutualisation du risque. Une telle hypothèse est effectivement vérifiée dans les domaines du livre ou du disque, pour lesquels les coûts de production sont sans commune mesure avec les recettes obtenues en cas de succès. Qu'un livre obtienne le prix Goncourt et c'est toute la maison d'édition qui en profite. Cette hypothèse est beaucoup moins réaliste dans des secteurs comme le cinéma. Elle est carrément improbable dans le domaine du spectacle vivant.
- La première consiste en l'accumulation d'un capital culturel permettant, en amont, de déchiffrer un certain nombre de signaux de qualité d'une oeuvre et, en aval, de mieux apprécier l'ensemble des qualités de cette même oeuvre. Bien que chaque oeuvre soit singulière, elle présente toujours des caractéristiques communes à des oeuvres antérieures (mêmes auteurs, mêmes acteurs, mêmes collections, mêmes lieux de diffusion...). Toutes ces caractéristiques fournissent des informations aux consommateurs qui ont pu, par le passé, en tester la qualité. Une oeuvre n'est jamais complètement nouvelle. Le capital culturel, les expériences de consommation passées jouent alors un rôle important pour limiter le risque de se tromper. On fait confiance à un directeur de théâtre pour sa programmation, à un éditeur pour ses choix éditoriaux, à un auteur dont on a apprécié les précédents ouvrages.
- La seconde façon de limiter le risque de consommation consiste à faire confiance à des médiateurs dont la fonction est de sélectionner les oeuvres de bonne qualité à notre place. Il s'agit d'une stratégie rationnelle dans un contexte d'information imparfaite. Les associations de consommateurs ou certains journaux spécialisés jouent ce rôle dans les secteurs économiques traditionnels. Ainsi, avant d'acheter une voiture ou un bien électroménager, on lit en général les critiques des journaux spécialisés. Dans le domaine culturel, une telle stratégie présente cependant plusieurs limites importantes.
Les approches économiques de la culture
Par Dominique Sagot-Duvauroux, GEAPE, Université d'AngersLES-Matisse, université de Paris-IL économie de la culture est une discipline relativement récente : elle s'est développée à partir des années 1960 à la suite d'une étude célèbre de deux économistes américains, W. Baumol et W. Bowen (1966), sur le spectacle vivant.
Ce développement s'est fait en trois étapes. Dans un premier temps, ce sont les questions relatives aux fondements de l'intervention publique qui recueillirent l'attention. Puis, à partir des années 1970, on commença à s'intéresser aux spécificités de la demande culturelle après la publication d'un article de G. Becker et G. Stigler (1977) qui comparait la consommation de musique à celle d'une drogue. Enfin, la constitution de grands groupes multimédias à partir des années 1980 a favorisé l'émergence d'une économie des industries culturelles fondée sur les concepts de l'économie industrielle. Plusieurs synthèses retracent cette courte histoire (Throsby, 1994 ; Benghozi, Sagot-Duvauroux, 1994 ; Benhamou, 1996).
Dans cet article, nous privilégions deux angles d'approche : celui de l'économie industrielle et celui de l'économie publique.
Il découle de ces analyses que les marchés culturels se distinguent des autres marchés d'une part par la difficulté de certaines activités à réaliser des gains de productivité compte tenu du caractère nécessairement artisanal de leur production (c'est le cas en particulier du spectacle vivant), d'autre part par l'importance du risque de production et de consommation auquel sont confrontés les acteurs de ces marchés.
Cependant, si les arguments économiques en faveur d'une intervention publique existent, certains économistes (notamment les néolibéraux) remettent en cause cette intervention en soulignant les défaillances de l'État. Les imperfections du marché que les pouvoirs publics sont censés corriger s'avéreraient finalement beaucoup moins préjudiciables que les biais bureaucratiques engendrés par l'absence de contrôle du marché. Sont ainsi dénoncés les surcoûts des institutions subventionnées, le manque de prise en considération du public ou encore les coteries entre élus et artistes qui favoriseraient l'apparition d'un art officiel.
L'approche par l'économie industrielle
L'analyse économique des filières culturelles distingue deux résultats saillants. D'une part, une partie des activités culturelles se caractérise par la difficulté d'y réaliser des gains de productivité. C'est le cas notamment du spectacle vivant ou d'institutions telles que les musées ou les bibliothèques. D'autre part, les secteurs culturels doivent faire face à une forte incertitude sur les débouchés des produits mis en vente.
La question de la productivité
La question de la productivité a été la première à intéresser les économistes. Le mérite en revient au célèbre livre de W. Baumol et W. Bowen publié en 1966, dans lequel les auteurs développent une analyse macroéconomique et de long terme de la croissance des coûts relatifs du spectacle vivant. Ils observent que ce secteur voit sa productivité croître moins vite que celle des secteurs produisant des biens manufacturés. Cependant, le taux de salaire y évolue de façon identique d'un secteur à l'autre. En effet, si le secteur du spectacle veut continuer à disposer de main-d'oeuvre, il lui faut proposer des rémunérations voisines de celles proposées ailleurs, de sorte que le coût relatif du spectacle augmente.
« Comparez l'évolution, au cours des siècles, du coût de production d'une montre par rapport à celui d'une représentation musicale. En facteur travail, l'horlogerie a connu des gains de productivité immenses, et cela continue. Un récital de violon n'a, par contre, pas bénéficié d'innovations qui permettent des économies du même ordre. Son exécution se déroule toujours comme autrefois, et c'est bien ce que nous voulons. Vers la fin du XVIIe siècle, un artisan suisse produisait environ douze montres par an. Trois siècles plus tard, la même somme de travail permet d'en sortir plus de mille deux cents (il ne s'agit pas de montres à quartz). Mais l'exécution d'un morceau de musique de Purcell ou de Scarlatti ne demande ni plus ni moins de temps et de personnes aujourd'hui qu'en 1684. " (Baumol et Baumol 1985.)
L'analyse de W. Baumol et W. Bowen, que Baumol formalisa en 1967, repose sur une conception duale de l'économie. Celle-ci se décompose en deux secteurs, un secteur progressif et l'autre non progressif, auquel appartiennent les activités de spectacle. Le secteur non progressif est fortement utilisateur de main-d'oeuvre et la productivité des travailleurs y est stagnante. Le nombre d'heures de travail par unité produite est constant, et une diminution de ce nombre d'heures aboutit à une perte de qualité du produit ou du service rendu.
Le secteur progressif se caractérise par d'importants gains de productivité et l'intensité capitalis-tique y est lorte (1) . Cela lui permet d'offrir à ses salariés des rémunérations croissantes. Or, dans les pays développés, le fonctionnement du marché du travail, la volonté de réduire les inégalités salariales et le jeu des négociations collectives entraînent à plus ou moins long terme la diffusion des hausses de salaires dans le secteur non progressif. Celui-ci voit alors sa marge bénéficiaire se restreindre jusqu'à atteindre le seuil de rentabilité. Quatre solutions sont alors envisageables : l'augmentation des prix, la diminution de la qualité, la disparition de l'activité, la subvention.
L'augmentation des prix n'est possible que si la sensibilité (l'élasticité) de la demande par rapport aux prix est faible, c'est-à-dire lors-qu'une augmentation de prix fait plus que compenser la perte de recettes liée à l'érosion de la demande consécutive à cette hausse. C'est le cas des spectacles prestigieux et exceptionnels ; c'est aussi le cas des clientèles aisées qui seules peuvent suivre l'évolution des prix. Le spectacle se condamne à l'élitisme. Si l'ajustement ne se fait pas par les prix, il se fait par la qualité. Ce n'est pas lorsque les coûts augmentent qu'il faut s'inquiéter, note Baumol (1984), c'est quand ils n'augmentent plus, car cela signifie un déficit artistique. Ainsi, concluent les auteurs, si l'on souhaite que la culture reste accessible à tous sans qu'il s'agisse d'une culture au rabais, il devient nécessaire de subventionner la culture. Et ces subventions devront être toujours croissantes pour une qualité constante (explication de la croissance des dépenses culturelles). À terme, notent les auteurs, la capacité de croissance de l'économie peut être totalement absorbée par le soutien aux secteurs subventionnés.
Comme non seulement les théâtres, les musées, les bibliothèques, mais aussi l'éducation, la santé, les services sociaux ou encore la police et la justice se trouvent dans une situation identique, le poids de l'État dans l'économie ne peut que croître, sauf à laisser se dégrader la qualité des services publics. D'où l'alternative des politiques publiques :
La réalité est heureusement moins tranchée. D'une part, il existe malgré tout des réserves de productivité dans les activités culturelles, même si celles-ci sont limitées. D'autre part, l'existence d'activités culturelles, et a fortiori d'écoles et d'hôpitaux, contribue à l'efficacité du secteur productif. Il existe un enjeu économique du développement culturel ou du développement de la connaissance (cf. deuxième partie). Enfin, comme le note Jacques Affala (2) le poids croissant des dépenses éducatives, culturelles ou de santé dans les économies occidentales (et en contrepartie l'augmentation des prélèvements obligatoires) traduirait non pas une perte d'efficacité de l'économie, mais au contraire un signe que l'économie arrive, grâce à la technologie et aux savoir-faire, à s'affranchir progressivement de la production de biens manufacturés au profit de biens ou services qui participent à l'épanouissement de l'homme.
La question du risque
Le deuxième grand problème auquel sont confrontées la majorité des entreprises culturelles est celui du risque. Patrice Flichy (1980) note qu'« il n'existe pas d'autre bien de consommation pour lequel les producteurs aient une telle méconnaissance de la demande qu'ils soient obligés de faire dix ou quinze essais pour obtenir un succès » (p. 38).
L'incertitude sur les débouchés a principalement deux causes. D'une part, la fonction de production artistique mobilise des paramètres qui ne sont pas tous maîtrisables par le producteur, même lorsque l'auteur n'est que le salarié du producteur. D'autre part, face à l'abondance de produits singuliers et nouveaux, les consommateurs de biens et services culturels sont confrontés à une grande incertitude sur la qualité des biens ou services offerts. Ils se retrouvent dans la situation périlleuse de devoir payer pour un bien avant d'en connaître la qualité.
Dès lors, les activités culturelles peuvent être analysées comme de prodigieux laboratoires de gestion du risque tant du côté de l'offre que du côté de la demande. Du côté de l'offre, cette gestion du risque s'opère au niveau de la structure des marchés, au niveau de la gestion de l'emploi et au niveau du choix des produits. Du côté de la demande, l'apprentissage personnel ou l'imitation de médiateurs censés être bons juges de cette qualité constituent des moyens efficaces de limiter ces risques. Ce dernier moyen n'est pourtant pas sans danger puisqu'il favorise la concentration de la demande sur quelques produits fortement médiatisés.
Le risque des offreurs
Les secteurs culturels jouent un rôle de plus en plus important dans la croissance économique. Les industries « de contenu ont connu, selon l'OCDE, un taux de croissance de l'ordre de 10 % par an depuis 1992. En Europe, ce serait 2 millions d'emplois qui seraient concernés, dont 50 % dans l'audiovisuel.
De grands groupes multimédias se sont constitués au niveau mondial : certains, comme Disney ou Bertelsmann, sont issus du secteur culturel ; d'autres, comme News Corp. de Rupert Murdoch, viennent du secteur de l'information ; d'autres enfin ont une société mère dont l'activité est très éloignée de la culture, comme Microsoft aux États-Unis, Vivendi ou Lagardère en France. Ces groupes cherchent à valoriser au mieux les économies d'échelle et d'envergure que permettent les industries de contenu. Ainsi, un même contenu peut être utilisé sous forme de livre, de film, de série télévisée. Ce contenu peut donner lieu à de nombreux produits dérivés, jouets divers, supports promotionnels. Il est l'enjeu d'une guerre économique acharnée pour le contrôle des catalogues de droits.
La croissance des activités de contenu ne supprime pas pour autant le risque qu'il y a à produire ces contenus, surtout lorsque ceux-ci sont élaborés en laissant une large autonomie à l'auteur. L'intérêt d'une analyse économique des secteurs culturels est alors de montrer comment s'organise une activité qui, plus que toute autre, est soumise aux aléas des marchés (Farchy, 1999).
Cette gestion du risque s'opère, du côté de l'offre, à un triple niveau : celui de la filière de production et de la structure des marchés, celui de la gestion de la main-d'oeuvre, celui enfin du choix des produits.
Structure des marchés culturels et organisation de la filière de production
Les marchés culturels se caractérisent par une concentration importante qui va de pair avec une remontée des risques vers l'amont, c'est-à-dire sur les producteurs, et un contrôle de l'aval, c'est-à-dire la distribution et les lieux de consommation.
Les marchés culturels sont le plus souvent des oligopoles. Quelques grosses entreprises contrôlent une part majoritaire des marchés et peuvent ainsi agir directement sur la structuration de l'offre et sur la formation des prix. L'industrie du disque est ainsi contrôlée, au niveau mondial, par cinq entreprises qui réalisent à elles seules environ 80 % des ventes. De la même façon, l'édition française est dominée par les groupes Hachette (Lagardère) et Havas Publication Édition (Vivendi). Dans le domaine des ventes aux enchères, deux sociétés, Sotheby's et Christie's, se partagent la quasi-totalité des grandes ventes d'objets d'art.
Cette concentration par secteurs se double aujourd'hui d'une concentration intersectorielle puisque les entreprises sont en général présentes à la fois dans le cinéma, l'audiovisuel, la presse, l'édition littéraire ou phonographique. Ainsi, le groupe Murdoch, qui a commencé à construire son empire sur la presse, occupe aujourd'hui une place déterminante dans l'audiovisuel et la production de films, qui assurent près de 60 % de son chiffre d'affaires. Il contrôle par ailleurs l'éditeur américain Harper et Collins. Bertelsmann, le numéro un mondial de l'édition depuis son rachat de Random House aux États-Unis, est aussi présent dans la presse (Géo, Voici, Capital...) et dans la télévision (CLT/UFA et donc RTL, M6, Channel 5), ce qui fait de lui le troisième groupe de communication mondial. Enfin, Vivendi assure désormais un quart de son chiffre d'affaires dans les industries culturelles et contrôle notamment dans l'édition l'ancien Groupe de la Cité, dans l'audiovisuel Canal Plus, Canal Satellite et plus d'une dizaine de chaînes thématiques, dans le cinéma Pathé et UGC, dans la presse L'Express, L'Expansion, dans le téléphone Cégétel et SFR, etc. Ces groupes sont en général présents tout au long de la filière de production, ce qui leur permet d'assurer la diffusion de leurs productions sans avoir à convaincre préalablement un acheteur indépendant.
Cependant, le renforcement de la concentration ne se traduit pas par la disparition des petites entreprises. C'est pourquoi l'on parle à propos de ces marchés d'oligopoles à frange. Ainsi, aux États-Unis, la part de la production de films assurée par des « indépendants » est d'environ 85 %. Dans le même temps cependant, les six premières compagnies récupèrent 80 % des recettes distributeurs (Augros, 1996).
Les entreprises de la frange tirent leur compétitivité de deux facteurs. Elles ont des coûts fixes relativement faibles qui abaissent le seuil de rentabilité et permettent de prendre davantage de risques sur de nouveaux auteurs ou artistes. Elles occupent des niches très spécialisées pour lesquelles les économies d'échelle et d'envergure sont limitées.
Les entreprises de la frange ont cependant une existence souvent précaire. Qu'elles se trompent dans leur choix, et c'est généralement la fermeture. Qu'elles rencontrent le succès, et alors les entreprises de l'oligopole ont soit la possibilité de racheter leur catalogue, soit celle de passer des accords avec elles, soit celle de débaucher leurs artistes, soit enfin celle d'imiter les productions à succès. Cette dynamique est particulièrement présente dans l'industrie du disque.
Elles sont en outre généralement tributaires des grandes entreprises pour la distribution et la vente de leurs produits, d'autant plus que ces grandes entreprises contrôlent désormais l'ensemble des supports. Dans le domaine cinématographique par exemple, la mainmise des grands distributeurs sur les multiplexes explique en partie le poids des films américains sur le marché français. Ainsi, sur les neuf premiers mois de l'année 1998, un film aura disposé en moyenne de 90 salles, mais de 161 s'il est américain et de seulement 61 s'il est français (Le Monde, 30/1/1999).
Cette structure de marché gère donc l'incertitude à un double niveau. D'une part, la concentration de l'activité, notamment en aval de la filière, conditionne en partie le succès des oeuvres, dont certaines ont un accès prioritaire aux lieux de diffusion et aux investissements promotionnels. D'autre part, en isolant les risques d'une création innovante sur des producteurs indépendants en amont de la filière, on crée une flexibilité apte à amortir les fluctuations des marchés sur les produits risqués.
Incertitude et mode de gestion de la main-d'oeuvre
La flexibilité assurée grâce à l'organisation de la filière est renforcée par une gestion de la main-d'oeuvre qui permet d'ajuster les coûts du travail en fonction d'un succès en grande partie imprévisible. Cette gestion de la main-d'oeuvre présente deux caractéristiques singulières : l'intermittence et la rémunération sous forme de droits d'auteur.
Dans les industries du spectacle, la règle est l'intermittence de l'emploi. En France par exemple, sur les quelque 155 000 personnes recensées par le Groupement des institutions sociales du spectacle (GRISS) en 1992, 65 % avaient un statut intermittent pour seulement 35 % de permanents. Chaque nouvelle production correspond quasiment à la création d'une nouvelle entreprise qui embauche pour cette occasion et débauche une fois la production assurée. La durée des contrats de travail est ainsi directement dépendante du succès de la production.
De la même façon, la rémunération des artistes sous forme de droits d'auteur permet d'ajuster les dépenses de « main-d'oeuvre » au succès du produit culturel. Cela évite ainsi au producteur d'avoir à avancer une partie importante des coûts de création (3) . Au-delà d'un éventuel droit des auteurs à percevoir des rentes sur les usages à venir de leurs oeuvres, les droits d'auteur constituent d'abord un moyen efficace de faire remonter les risques non plus des distributeurs vers les producteurs, mais cette fois-ci des producteurs vers les artistes.
Le marché du travail artistique apparaît sous cet angle comme un observatoire privilégié des mécanismes d'ajustement à mettre en place dans une économie dominée par l'incertitude (Menger, 1997 ; Paradeise, 1998).
Incertitude et stratégies de produit
Le dernier niveau de gestion du risque par les entreprises culturelles concerne le choix des produits. Trois principales stratégies dominent : la standardisation (politique de genres ou de séries par exemple), le star-system et la surenchère des coûts, la répartition des risques suivant ce que l'on a coutume d'appeler le modèle éditorial.
Dans un contexte de mondialisation, ces évolutions ne peuvent que se renforcer. Elles n'auront pas nécessairement pour conséquence la fin des cultures régionales ou locales. Dans le domaine du livre et du disque par exemple, les faibles coûts de production peuvent être couverts par des ventes relativement modestes, à condition que les consommateurs potentiels puissent être facilement informés de l'existence de ces oeuvres.
Le risque des consommateurs
Car un des principaux problèmes auxquels se heurtent les consommateurs, c'est le choix des oeuvres dans un contexte d'incertitude sur la qualité. À l'incertitude des producteurs correspond ainsi logiquement l'incertitude des consommateurs. Ceux-ci sont confrontés à l'abondance des biens offerts (4) , dont la qualité, pour la plupart d'entre eux, ne peut être connue qu'après usage. Il faut donc payer avant de connaître. Et le risque de se tromper, pour des individus dont les ressources financières sont réduites ou dont la disponibilité en temps est limitée, peut aboutir à une non-consommation.
Ce risque de consommation peut être réduit de différentes façons.
Par ailleurs, comme le remarque Scitowsky (1976), l'expérience et l'instruction élargissent la capacité à apprécier les sources de stimulation comme la musique, la littérature, la peinture ; une partie de la connaissance rend la source de divertissement agréable. De la même façon, Barthes (1980) distingue dans son appréciation d'une photographie ce qui relève de l'impression immédiate (le punctum) et ce qui relève de la connaissance générale ou spécifique dont il dispose sur cette photographie (le studium).
La dépendance entre apprentissages passés et consommations futures caractérise ce que les économistes appellent un phénomène d'assuétude ou d'addiction, phénomène que l'on retrouve pour la consommation de drogue ou d'alcool (Stigler, Becker, 1977). Cela a d'importantes conséquences économiques. En effet, si le développement des marchés futurs dépend des consommations présentes, il peut être nécessaire d'« amorcer la pompe des consommations culturelles en facilitant les premières expériences et en limitant le risque lié à ces premières expériences. Dans le domaine de l'édition, les bibliothèques jouent un rôle majeur en familiarisant les individus à la lecture et à certains auteurs. La seconde conséquence est que les individus sont naturellement portés vers les produits culturels qui renferment de nombreuses caractéristiques déjà connues et appréciées, d'où le succès des genres ou des séries évoqués plus haut, d'où également le succès des produits stars et peu innovants.
La première tient au caractère subjectif de l'évaluation de la qualité des biens et services culturels (Rouget, Sagot-Duvauroux, 1996). Pour une automobile ou un « frigidaire ", la critique porte sur des caractéristiques objectives des biens et une évaluation scientifique est généralement faisable. En matière de produits culturels, cette évaluation revêt un caractère beaucoup plus subjectif. Peut-on apprécier la qualité d'un livre par son nombre de pages ou par la qualité de son impression, la qualité d'un film par sa durée ? Le mystère du processus de création fait qu'une combinaison de mêmes caractéristiques (même auteur, même réalisateur, mêmes acteurs, etc.) peut déboucher sur des résultats très variables d'une oeuvre à l'autre. C'est d'ailleurs l'une des contraintes majeures des producteurs culturels que de ne pas maîtriser parfaitement leur fonction de production. Par ailleurs, la qualité d'une oeuvre dépend d'une relation singulière entre un consommateur et une oeuvre. Et deux individus peuvent avoir des jugements radicalement différents face à une même oeuvre, comme en témoignent les polémiques autour des prix du Festival de Cannes 1999. L'opinion sincère d'un critique ne coïncide pas toujours avec notre propre opinion.
Deuxièmement, l'avis des critiques n'est pas toujours totalement désintéressé. Tel journal, spécialisé dans l'art contemporain, tire par exemple l'essentiel de ses ressources de la publicité payée par les galeries dont il est censé critiquer les expositions ; telle chaîne de télévision ou de radio appartient au même groupe que la société de production dont elle est censée critiquer le film...
Troisièmement enfin, cette attitude rationnelle d'imiter les individus qui sont supposés connaître la qualité contribue fortement à la concentration de la consommation sur certains produits (Rouget, Sagot-Duvauroux, 1996). Une toute petite distinction sur une oeuvre peut se traduire par des différences considérables en matière de ventes, comme l'attestent les différences de résultats entre la vente des livres ayant reçu un prix littéraire et la vente de ceux qui ont été battus sur le fil. Car un des traits les plus saillants des consommations culturelles, c'est le contraste entre l'abondance de produits offerts et la concentration de la consommation sur certains d'entre eux. Le film Titanic a ainsi réalisé en 1998 environ 5 % de la totalité des entrées de cinéma en salles dans le monde. Dans le domaine du spectacle vivant, pour quelques salles abondamment remplies, une majorité de spectacles se jouent devant des gradins dégarnis.
Cette concentration est en outre renforcée par le besoin d'avoir vu ou lu les oeuvres à succès. À l'imitation motivée par une carence d'information s'ajoute l'imitation motivée par le souci d'appartenir à une communauté (Moureau, 1996). Apparaît alors un mécanisme que les économistes appellent des « rendements croissants d'adoption ". L'utilité tirée de la consommation d'un bien est d'autant plus forte qu'un nombre important d'individus l'ont déjà adopté.
La concentration de la consommation sur quelques produits stars et la domination de quelques groupes sur l'ensemble des filières ne se traduisent pas par la disparition des productions indépendantes. Celles-ci ont cependant une existence chaotique, et la probabilité d'échouer dépasse de loin celle de réussir. Elles se maintiennent en partie par le fait qu'elles mobilisent des gens, artistes, producteurs, techniciens, dont la motivation n'est pas prioritairement financière. Elles se maintiennent également parce qu'une minorité de consommateurs disposent d'un capital culturel qui les dispense de suivre aveuglément le choix des critiques et qui développe leur demande de variété.
Les enjeux de l'intervention publique: l'approche par l'économie publiques
(5) L'analyse de l'intervention publique est le deuxième angle d'approche économique pour étudier la culture. L'analyse économique de l'intervention de l'État fut du reste longtemps la principale préoccupation des économistes de la culture. Depuis le travail fondateur de W. Baumol et W. Bowen sur le spectacle vivant, les économistes ont à la fois recherché des arguments fondant scientifiquement l'intervention publique dans ce champ et mis en évidence les dysfonctionnements que cette intervention était susceptible de provoquer.
Les arguments en faveur de l'intervention publique dans la culture
Les économistes assignent généralement à l'État trois missions : une mission de correction des imperfections des marchés, une mission de redistribution et une mission de régulation macroéconomique. Seules les deux premières concernent directement le secteur culturel.
Pour les économistes libéraux, l'intervention publique ne se justifie que si elle améliore l'efficacité des marchés. L'État est en quelque sorte le négatif du marché, et son champ d'intervention est entièrement déterminé par les zones d'inefficacité du marché. Celui-ci est en effet considéré comme le système économique le plus efficient. Il permet la convergence des aspirations individuelles des agents supposés rationnels et de l'intérêt général. Cependant, dans un certain nombre de cas, cette convergence ne peut être assurée. Il y a alors divergence entre les choix individuels rationnels et l'intérêt général. Il se trouve que ces cas se rencontrent fréquemment dans les activités culturelles.
e Le principal obstacle auquel se heurtent les marchés culturels est l'existence d'externalités.
On dit qu'il y a externalité lorsque l'action ou les décisions d'un agent économique modifient le bien-être d'autres agents sans que cette modification fasse l'objet d'un système de compensation marchand. Plus concrètement, cela signifie que les équipements culturels rendent à la collectivité des services qui sont généralement plus larges que ceux qu'ils peuvent directement facturer. Par exemple, les flux financiers tirés du tourisme sont largement tributaires de l'existence de musées ou de monuments. Mais le gestionnaire privé d'un musée ou d'un monument n'a généralement pas la possibilité de taxer les entreprises de tourisme qui profitent de son existence. En l'absence d'intervention publique, le musée ou le monument risque de fermer alors que sa rentabilité serait assurée s'il avait pu récupérer une partie des recettes que son existence génère. Sur le Festival d'Avignon, on a calculé que 1 F de subvention générait près de 2 F de chiffre d'affaires à l'économie locale (Pflieger, 1990). Sur la ville d'Amsterdam (Van Puffelen, 1990), une étude a montré qu'environ 25 % des touristes se déplaçaient principalement pour visiter les équipements culturels et que 15 % supplémentaires considéraient ces visites comme la deuxième motivation de leur voyage. Leurs dépenses finançaient l'équivalent de 13 500 temps plein, pour moitié dans le secteur culturel et pour moitié dans les autres secteurs, principalement les hôtels et les restaurants.
Les flux financiers ne sont pas les seules externalités engendrées par la présence d'équipements culturels. L'image de la ville est transformée par l'existence d'équipements ou d'événements culturels. Et ceux-ci permettent d'économiser de coûteuses et aléatoires campagnes de promotion. Ils favorisent également l'accueil d'une main-d'oeuvre qualifiée qui hésitera à se déplacer dans une ville dépourvue de bibliothèques, de théâtres ou de cinémas.
Les activités festivalières sont celles qui engendrent généralement le plus d'externalités. Il faut sans doute voir là une des explications à la prolifération des festivals en France depuis une vingtaine d'années.
e Les marchés s'avèrent défaillants également lorsqu'on est en présence de demandes d'option.
Les demandes d'option concernent des biens ou des services, généralement des équipements, dont on souhaite l'existence dans l'éventualité d'une consommation future qui ne se réalisera peut-être jamais (6) .Les motivations d'une telle demande peuvent être intéressées (se préserver la possibilité d'une consommation future) ou altruiste (transmettre le patrimoine aux générations futures). La production de ces biens est marquée par une forte irréversibilité, leur consommation par une forte incertitude qui tient à une mauvaise information sur les besoins futurs. Dans le domaine culturel, ces demandes d'option sont fréquentes. On souhaite habiter une ville bien pourvue en équipements culturels dans la perspective éventuelle d'utiliser ces derniers. Des parents peuvent désirer que leurs enfants présents ou futurs puissent avoir la possibilité de se cultiver.
Le domaine patrimonial illustre bien le risque d'irréversibilité et par suite la présence de demandes d'option. Les monuments se dégradent avec le temps. On doit donc les entretenir régulièrement si on veut les conserver pour pouvoir les visiter plus tard ou les transmettre aux générations futures. Qu'une génération refuse de les entretenir et ce sont toutes les générations futures qui sont sacrifiées. Baumol et Bowen (1966) relatent ainsi l'histoire d'un touriste qui demande à un gardien du château de Versailles le secret des pelouses verdoyantes du parc. Ce dernier lui répond : " C'est très simple, il suffit de les arroser tous les jours pendant trois cents ans. »
Une des caractéristiques économiques de ces demandes d'option est qu'elles sont très difficilement captables par le propriétaire de l'équipement qui en fait l'objet, puisque la demande ne se traduit pas, comme habituellement, par un acte de consommation. Il risque de disposer de ressources insuffisantes pour entretenir un équipement qui serait rentable s'il pouvait capter cette demande. C'est aux collectivités publiques de solvabiliser cette demande. On dit alors qu'il existe une demande privée de subvention publique.
L'existence de rendements intergénérationnels et de surcroît aléatoires est un troisième argument en faveur de l'intervention publique.
La production d'un certain nombre de biens procure des ressources sur plusieurs générations. Le marché étant myope et les individus ayant un horizon de vie mais aussi de décision limité, des projets risquent d'être écartés faute d'une rentabilité à court terme suffisante, alors que cette rentabilité serait acquise si elle était estimée sur une longue période. Dans ce cas, les décisions individuelles n'aboutissent pas nécessairement à un choix optimal pour la collectivité.
En matière culturelle, dans la mesure où la réaction initiale des consommateurs à l'avant-garde artistique peut être très négative alors même que ces créations seront acceptées comme conventionnelles avec le temps, il y a tout lieu de penser que la production sera moins élevée que ce qui est souhaitable, d'autant plus que cette rentabilité future est fortement aléatoire (7) . En l'absence d'intervention publique, seules se maintiennent des oeuvres dont la rentabilité est rapide et relativement sûre. L'intervention publique, comme du reste un mécénat privé, peut remédier à cette situation en subventionnant une création affranchie des contraintes de marché. Les pièces de Molière, les opéras de Mozart, les chefs-d'oeuvre de la littérature figurent sans doute parmi les produits dont la rentabilité a été la plus forte. Mais quel investisseur rationnel aurait misé sur de tels projets ?
Les bibliothèques, en tant qu'elles collectionnent et conservent les d'ouvrages, permettent effectivement aux oeuvres d'avoir une durée de vie plus longue que celle imposée par le marché, qui se traduit par la disparition de la plupart des nouveautés quelques semaines après leur parution.
L'intervention publique peut aussi être motivée pour éviter la constitution de monopoles.
En économie de marché, si la rentabilité est une fonction croissante de la taille (existence d'économie d'échelle), la structure de marché évolue inévitablement vers un monopole. Et celui-ci est alors en mesure d'abuser de son pouvoir auprès des consommateurs dont le choix se réduit à acheter ou à ne pas acheter le bien du monopole (cf le procès fait actuellement à l'entreprise Microsoft). Les rendements d'échelle existent dans l'audiovisuel. Plus une chaîne de télévision a une large audience, plus il lui est facile d'amortir les coûts de production de ses émissions. Si, de plus, l'audience est une fonction croissante du coût des émissions, c'est la chaîne qui disposera des moyens les plus importants qui aura la plus large audience et qui finira par évincer les autres. L'État intervient alors pour garantir la diversité d'approvisionnement des consommateurs. L'enjeu est de taille si le bien en question est l'information.
Il existe également plusieurs arguments économiques qui plaident en faveur d'un accès démocratique aux biens culturels (mission de redistribution).
Premièrement, nous avons vu que la culture faisait l'objet d'une consommation addictive. Les consommations futures dépendent des investissements passés. Favoriser l'accès à la culture des plus jeunes, notamment à l'école ou grâce à l'existence de bibliothèques, constitue un moyen de soutenir la demande future de ces jeunes et donc de favoriser le développement économique ultérieur des secteurs culturels.
Deuxièmement, le patrimoine culturel d'aujourd'hui est le résultat des investissements et des efforts de l'ensemble des générations qui nous ont précédés. Il apparaît justifié que cet héritage soit largement accessible à tout le monde, car personne ne peut individuellement s'approprier les efforts de nos ancêtres. On retrouve là l'argument de ceux qui préconisent l'instauration d'un revenu minimum d'existence, non seulement au titre de la solidarité mais comme un dû, puisque le niveau de développement d'un pays résulte de l'effort des actifs et aussi des efforts des générations précédentes, dont l'héritage appartient à tout le monde.
Enfin, on peut penser que la diffusion de la culture au plus grand nombre contribue à stimuler la créativité de chacun et est susceptible de réduire les tensions sociales. C'est la raison pour laquelle les institutions culturelles sont souvent mobilisées pour intervenir dans les quartiers difficiles.
Cependant, si tous ces arguments plaident en faveur d'un soutien public aux activités culturelles, il serait très dangereux de ne faire dépendre ce soutien public que d'arguments économiques qui restent fragiles. Dans la théorie des biens sous tutelle, la prise en charge publique des activités artistiques traduit l'existence de demandes propres des collectivités publiques qui n'ont pas forcément de légitimité économique et qui répondent à d'autres ambitions : assurer l'indépendance de la culture nationale par rapport à l'étranger, favoriser une création culturelle pluraliste, élargir l'accès de toutes les catégories de population à la culture, ou encore satisfaire des groupes de pression ou les intérêts de la classe au pouvoir. La légitimité économique ne saurait donc suffire à expliquer les politiques culturelles, héritières des choix passés et reflets d'enjeux stratégiques multiples.
Les arguments d'une remise en cause
Une fois définis les fondements économiques de l'intervention publique dans la culture, les économistes se sont penchés sur la question de l'efficacité de cette intervention. Les entreprises culturelles subventionnées n'ont pas toujours bonne réputation. Elles font l'objet des mêmes critiques que le secteur public en général, accusé de mal gérer les fonds toujours croissants qui lui sont accordés et de ne pas tenir suffisamment compte des attentes des usagers. Le financement public, en desserrant l'étreinte du marché, autoriserait tous les gaspillages, lorsque ce ne sont pas toutes les manipulations et détournements de fonds.
Ne pourrait-on pas produire à moindre coût ? Ne pourrait-on pas mieux satisfaire le consommateur au lieu de donner des subventions à des entreprises culturelles sans public ? Finalement, la subvention ou la réglementation remédient-elles vraiment aux carences du marché, n'entraînent-elles pas elles-mêmes des carences beaucoup plus considérables, ne s'o-rientent-elles pas prioritairement vers des organisations soutenues par de puissants lobbies qui bénéficient ainsi de rentes financées par la collectivité ?
Qui n'a pas en tête un musée poussiéreux réservé à quelques érudits, peu soucieux de rendre ses trésors accessibles au grand public ? Qui ne s'est pas interrogé sur le bien-fondé des dépenses relatives à tel ou tel décor, à tel ou tel costume ? Qui n'a pas été choqué du versement de certains cachets au sein d'institutions censées vivre dans une précarité permanente ? Les quotas de programmes télévisés ou la réglementation sur le prix du livre n'offrent-ils pas des possibilités de rente pour les acteurs de ces marchés au détriment des consommateurs ?
De nombreux travaux économiques, d'inspiration très libérale, se sont interrogés sur la capacité des organisations culturelles à se gérer de façon efficace, compte tenu de leur financement public (Pommerehne, Frey, 1993 ; Grampp, 1989). L'analyse économique de la bureaucratie constitue la référence théorique de la plupart d'entre eux. Elle débouche sur la mise en évidence d'effets pervers qui remettent en cause l'intervention publique. Dans le secteur privé, les contraintes du marché sont censées permettre d'éliminer les entreprises mal gérées, c'est-à-dire celles qui fabriquent des produits inadaptés ou trop coûteux. Comme les contraintes de marché disparaissent avec l'intervention publique, les gestions bureaucratiques et inefficaces peuvent se développer.
A ainsi été dénoncé le surcoût des institutions culturelles, lié tout à la fois à l'incapacité des institutions publiques à être gérées correctement et aux stratégies de directeurs-artistes davantage soucieux de gérer leur carrière artistique par la production de spectacles somptueux que de satisfaire le public ou de remplir leur mission de démocratisation. On a aussi beaucoup parlé du développement d'un art officiel, notamment dans les arts plastiques, enfermé dans une relation exclusive entre l'artiste et son commanditaire, dans une sorte de nouvelle académie d'autant plus sournoise qu'elle est informelle.
Ces dénonciations, souvent justifiées, ont largement contribué à remettre en cause l'intervention publique au nom de la stratégie du moindre mal. Certes, disent les néolibéraux, le marché n'est pas toujours efficient, mais, lorsque les pouvoirs publics se proposent d'en améliorer l'efficacité, le remède est souvent pire que le mal. Ces économistes proposent alors soit, de façon radicale, de remettre en cause l'intervention publique, soit d'introduire les règles du privé dans la gestion des organismes subventionnés.
En fait, le discours néolibéral sur la culture est habile mais biaisé. Dans un premier temps, on dénonce un certain nombre d'inefficacités du service public au regard d'indicateurs de performances qui sont ceux du privé. On propose alors d'appliquer les méthodes de gestion du privé au service public. Enfin, s'apercevant que le service public fait la même chose que le secteur privé, on se demande à quoi sert le service public et la boucle est bouclée (Farchy, Sagot-Duvauroux, 1993).
Personne ne nie la nécessité d'une meilleure gestion des organismes culturels subventionnés, fondée sur le suivi d'une série d'indicateurs de « performances Mais ces indicateurs doivent être choisis en fonction des objectifs de service public que ces institutions se voient assigner. Par ailleurs, dans ce type d'organisation, il est illusoire de penser que le renforcement des contrôles permettra la disparition des dérives. La fonction de production artistique est telle qu'elle laisse forcément beaucoup d'autonomie au directeur. C'est dans le choix de celui-ci que se situe souvent le véritable enjeu. Une politique culturelle a d'autant plus de chances d'aboutir qu'elle correspond aux objectifs personnels des dirigeants d'institution. Mieux vaut ne pas choisir un artiste comme directeur d'une institution dont on souhaite qu'elle poursuive une politique de démocratisation. Le choix presque systématique de dirigeants-artistes dans les institutions de spectacles subventionnées traduit donc, au-delà des discours, la préférence de l'État pour une politique de création ou de prestige.
Conclusion
L'analyse économique permet donc d'identifier un certain nombre de logiques qui prévalent dans les secteurs culturels, que ceux-ci soient subventionnés ou non. Elle apporte des éclairages prospectifs qui peuvent aider les professionnels et les pouvoirs publics à définir leurs stratégies. Elle ne saurait pourtant être le seul éclairage pertinent des dynamiques en présence dans ces secteurs. Dans le domaine des industries culturelles, le travail des auteurs et des producteurs échappe en partie à l'analyse économique. La volonté de faire oeuvre ou de défendre des oeuvres constitue, en tout cas pour une partie de la profession, une motivation forte qui domine souvent la logique économique. Celleci ne s'impose qu'en aval, une fois la décision prise, parce qu'il faut bien que les artistes vivent et que les entreprises couvrent leurs frais pour pouvoir continuer à soutenir la création.
Il en est de même de l'intervention publique. S'il existe des fondements économiques à cette intervention, celle-ci est généralement motivée par des considérations d'abord culturelles, politiques ou sociales. Par exemple, la démocratisation culturelle est un objectif politique, même si l'on peut montrer qu'elle présente aussi des enjeux économiques. Faire dépendre l'intervention publique de la seule pertinence des arguments économiques, c'est suspendre une épée de Damoclès redoutable sur cette intervention publique.
Faire de l'économie de la culture, ce n'est donc pas réduire l'ensemble des comportements des acteurs de ce champ à la rationalité économique, c'est mettre en évidence les contraintes économiques qui s'imposent aux personnes décidées à investir dans ce domaine.
2. « La prochaine utopie », Le Monde, 6/1/1999. retour au texte
3. La pratique des à-valoir contredit un peu cette analyse. Cependant, seuls les auteurs réputés bénéficient d'à-valoir importants. Et ce sont généralement ceux qui sont assurés d'un minimum de ventes. retour au texte
4. Plus de 30 000 nouveautés ont été publiées en 1998 en France selon Livre Hebdo, cité par te Monde, 22/12/1998. retour au texte
5. On pourra se reporter à Farchy J., Sagot-Duvauroux D., Économie des politiques culturelles, 1993, pour une présentation détaillée de ces arguments. retour au texte
6. On cite généralement les hôpitaux comme exemples d'équipements faisant l'objet d'une demande d'option. On souhaite leur existence sans souhaiter les utiliser. retour au texte
7. Proust note à ce propos : « Les beautés que l'on découvre le plus tôt sont aussi celles dont on se fatigue le plus vite et pour la même raison qui est qu'elles diffèrent moins de ce qu'on connaissait déjà. Mais quand celles-là se sont éloignées, il nous reste à aimer telle phrase que son ordre trop nouveau pour offrir à notre esprit rien que confusion nous avait rendu indiscernable et gardée intacte ; et alors, elle devant qui nous passions tous les jours sans le savoir et qui s'était réservée, qui par le pouvoir de sa seule beauté était devenue invisible et restée inconnue, elle vient à nous la dernière... Ce temps qu'il faut à un individu pour pénétrer une oeuvre un peu profonde n'est que le raccourci et comme le symbole des années, des siècles parfois, qui s'écoulent avant que le public puisse aimer un chef-d'oeuvre vraiment nouveau. » (À ombre des jeunes filles en fleur, Garnier-Flammarion, p. 201-202). retour au texte