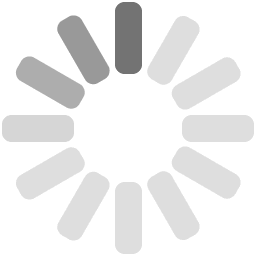Index des revues
- Index des revues
La double nature du livre
-
Beneteau, René
Allocution d'ouverture, p.8-9. -
Belayche, Claudine
Présentation générale, p.10. -
Sagot-duvauroux, Dominique
Les approches économiques de la culture , p.11-23. -
Rizzardo, René
Les établissements publics culturels territoriaux aujourd'hui , p.24-27. -
Gèze, François
La double nature du livre , p.28-31. -
Belayche, Claudine,
E., M.,
Lemennicier, Bernard
Les bibliothèques municipales et la déréglementation des services publics , p.32-37. -
-
Les coûts de l'information
-
Diez, Alain
La médiathèque de la cité des sciences et de l'industrie , p.39-44. -
Chantereau, Danielle
L'ina entre missions de service public et contexte marchand , p.45-48.
-
Diez, Alain
-
-
Créer des ressources propres pour les bibliothèques
-
Bulpitt, Graham
Les services tarifiés dans les bibliothèques anglaises , p.50-55.
-
Bulpitt, Graham
-
-
Des bibliothèques universitaires et de recherche travaillent aussi pour des entreprises privées
-
Casseyre, Pierrette
La bibliothèque interuniversitaire de médecine , p.57-58. -
Maximin, Anny,
Roche, Dominique
Prestations aux entreprises, p.59-64.
-
Casseyre, Pierrette
-
-
Table ronde autour des coûts des services en bibliothèque
-
Chatenay-Dolto, Véronique
Intervention de Véronique Chatenay-Dolto, p.66-70. -
Jolly, Claude
Intervention de Claude Jolly, p.71-74. -
Casseyre, Jean-Pierre
Intervention de Jean-Pierre Casseyre, p.75-77. -
Groshens, Jean-Claude
Intervention de Jean-Claude Groshens, p.78-81.
-
Chatenay-Dolto, Véronique
-
-
Quels choix financiers pour développer une politique de service public de la lecture et de la documentation?
-
Duperrier, Alain
Présentation, p.83-84. -
Belayche, Claudine
Introduction, p.85-86. -
Rodet, Alain
Intervention, p.87-88. -
Lerebours, Jean-Loup
Quelques résultats de l'influence des politiques tarifaires sur le fonctionnement des..., p.89-92. -
Pasquignon, Anne
La politique tarifaire de la bnf , p.93-95. -
Bertrand, Annie
Un exemple de politique tarifaire dans une bibliothèque universitaire française, p.96-99. -
Guichard, Marc
L'inist-cnrs , p.100-102. -
Borchardt, Peter
Les formes de tarification dans les bibliothèques allemandes , p.103-106.
-
Duperrier, Alain
-
-
Les coûts de la conservation et la valorisation du patrimoine
-
Compte, Jean-Marie
Introduction, p.108. -
Brèthes, Jean-Pierre
Le patrimoine écrit en poitou-charentes , p.109-111. -
Arnoult, Jean-Marie
Le patrimoine et les tutelles , p.112-118. -
Etienne, Michel
La place du patrimoine dans les nouvelles constructions de bibliothèques , p.119-123. -
Marcetteau-paul, Agnès
Le fonds jules verne à la bibliothèque municipales de nantes , p.124-125. -
Firouz-Abadie, Geneviève
Le fonds d'argenson à la bibliothèque universitaire de poitiers , p.126-128. -
Corpet, Olivier
Ce que l'IMEC apporte, p.129-130. -
Bertinet, Lionel
Mécénat d'entreprise et patrimoine, p.131-135. -
Duchemin, Pierre-Yves
La numérisation des documents graphiques , p.136-142. -
Bogros, Olivier
Le recours au multimédia pour la mise en valeur et la diffusion des fonds patrimoniaux , p.143-146. -
Belayche, Claudine,
Jelmini, Thierry,
Van bésien, Hugues
En passant par l'expo, p.147-162.
-
Compte, Jean-Marie
- quand les vrais éditeurs restent aux commandes et quand les financiers ne sortent pas de leur rôle;
- quand il existe un réseau dense de librairies (plus il y a de librairies dans une agglomération et plus on y achète de livres, d'où l'importance fondamentale d'une réglementation sur le prix unique pour préserver cette diversité) ;
- quand l'organisation économique des différents maillons de la chaîne du livre assure l'équilibre entre les deux logiques qui y cohabitent : la logique nécessairement « artisanale » des éditeurs (même dans les grands groupes) et des libraires, et entre les deux la logique nécessairement industrielle des outils de distribution ; c'est quand cet équilibre toujours fragile est rompu au profit de la seconde que l'on entre dans le monde à l'américaine des « grandes surfaces du livre débitant de la « littérature industrielle ».
- la plus importante est que la baisse du nombre de forts lecteurs affecte directement l'édition de création : plus curieux que les autres des nouvelles tendances littéraires ou des ouvrages de connaissance « primaires (par opposition aux livres de vulgarisation), ils encourageaient traditionnellement par leurs achats les éditeurs à se montrer innovateurs ; leur diminution produit un effet inverse (particulièrement marqué ces dernières années dans l'édition de sciences humaines, où plusieurs éditeurs importants ont été confrontés à des crises graves) ;
- * la baisse des ventes moyennes par titre, observée dans tous les secteurs de la production, conduit les éditeurs à augmenter considérablement le nombre de titres produits pour tenter de maintenir le niveau de leurs revenus, d'où une inflation maintes fois dénoncée du nombre de nouveautés, dont beaucoup sont inutiles (du fait notamment de la recherche de « coups » éditoriaux trop souvent productrice de livres médiocres vite promis au pilon, ou du « panurgisme » de certains éditeurs qui cherchent à « cloner les succès imprévus de leurs confrères) ;
- pour faire face à la baisse des ventes, les éditeurs et les imprimeurs ont été contraints à d'importants efforts de productivité (3) , ce qui a eu un effet paradoxal : la baisse du niveau d'investissement nécessaire pour couvrir les frais de fabrication (composition, impression, papier) a encouragé certains éditeurs (petits ou gros) à produire de plus en plus, en rognant simultanément sur les autres frais (travail éditorial, droits d'auteur, promotion), d'où un autre facteur d'inflation de la production et de baisse de la qualité des nouveautés ;
- on observe enfin une polarisation croissante du marché entre une petite minorité de titres bestsellers (quelques centaines à peine par an) et les autres, dont la majorité se vendent peu ou très peu, la catégorie des livres intermédiaires (ventes comprises entre 3 000 et 15 000 exemplaires) tendant à se réduire fortement : d'où des difficultés accrues pour appliquer la règle de péréquation que j'évoquais précédemment, et la nécessité de mettre en oeuvre des actions de marketing très « fines pour accroître les ventes des livres spécialisés intéressant des publics ciblés (ce pour quoi les petites structures d'édition innovantes sont mal équipées).
La double nature du livre
Par François Gèze, Directeur général éditionsLa Découverte et SyrosLa double nature du livre, à la fois objet culturel et bien marchand, n'est pas facile à prendre en compte - et ce constat ne vaut pas, loin s'en faut, que pour les bibliothécaires. D'autant que, au vu des évolutions de ces dernières années (concentration éditoriale accrue, explosion du nombre de parutions, obsolescence de plus en plus forte des nouveautés), la tentation est grande d'en déduire que le divorce est consommé entre ces deux dimensions (au détriment - faut-il le dire ? - de la première). Dans cette perspective, une polarisation néfaste opposerait désormais les « gros éditeurs (synonymes de logique du profit et de livres « commerciaux,,) et les « petits » (synonymes de logique culturelle et de livres « de création »).
Que de telles tendances se soient affirmées au cours de ces vingt dernières années, cela est indiscutable. Pour autant, s'agissant de la production éditoriale française, ce tableau est loin de refléter la réalité, autrement plus complexe. Car ces identités (gros = pur commerce ; petits = pure création) sont loin d'être avérées. Il existe dans les grands groupes des pôles puissants de création aussi bien que des gestionnaires froids qui n'ouvrent jamais un livre. Et, chez les petits éditeurs, on trouve aussi bien de véritables militants de la culture - souvent plus agiles que les gros à découvrir de nouveaux talents - que des entrepreneurs dénués de tout souci culturel qui recherchent (et obtiennent souvent) le profit au détriment de la qualité.
Logique marchande contre logique de création ?
C'est d'abord ce simple constat qui m'amène à récuser la vision manichéenne opposant de façon irréductible les deux dimensions (créatrice vs marchande) du livre. Mais il y a aussi une autre raison, plus politique pourrais-je dire : si l'on est convaincu que la dimension marchande ne peut, comme une fatalité, que tuer la dimension créatrice, et si l'on est attaché à la défense de cette dernière, alors cette analyse implique qu'il n'est pas d'autre solution que de les séparer ab initio. En d'autres termes, la préservation d'une création éditoriale et littéraire de qualité relevant de l'intérêt général, ce serait à la collectivité nationale - et donc à l'État - de la garantir en la finançant, pour la soustraire aux pressions de la logique marchande.
On retrouve là apparemment le débat sur le financement de l'audiovisuel public et sur la part respective dans celui-ci de la publicité et de l'impôt. Mais ce qui peut être pertinent pour cette « industrie culturelle qu'est aussi la télévision ne l'est pas nécessairement pour le livre, au moins pour deux raisons.
En premier lieu, l'univers du livre est composé d'un nombre de « produits singuliers beaucoup plus important que dans celui de l'audiovisuel, et les investissements unitaires y sont beaucoup plus faibles, donc plus accessibles. En second lieu, du fait même de la spécificité de l'économie de la création du livre (il s'agit, on l'a souvent répété, d'une « industrie de prototypes.), de son extraordinaire diversité, il est beaucoup plus difficile de garantir une véritable autonomie de la création éditoriale dans l'hypothèse d'un financement exclusivement public. (Il suffit d'évoquer ici le modèle », ou plutôt le contre-modèle, de ce que fut l'édition publique dans les anciens États communistes d'Europe de l'Est : certains espaces de création y étaient parfois préservés, avec souvent de magnifiques résultats, mais au prix d'une censure et d'une autocensure largement aussi violentes, et souvent beaucoup plus, que celles exercées à l'Ouest par les obsédés de la bottom line.)
Mais, au-delà de ces constats factuels, je fonde ma conviction sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité à ce que la logique marchande tue la logique de création pour le livre. Certes, dans d'autres champs où l'intérêt général et la défense des valeurs de la démocratie (liberté d'expression, lutte contre les inégalités...) sont également en cause, il n'en va pas ainsi. S'agissant en particulier de l'éducation et de la lecture publique, il me paraît essentiel que la tutelle publique (État et collectivités locales) soit forte et entière, en termes de financement comme de régulation, pour éviter des écoles et des bibliothèques à à plusieurs vitesses ».
Cela ne peut être le cas pour le livre. Même si la tension entre les deux logiques - marchande et créatrice - peut être difficile à assumer, elle est « gérable » et, surtout, elle est le meilleur garant de la liberté de création. C'est cet apparent paradoxe que je vais essayer d'expliciter.
La péréquation économique au service de la création
Pour un éditeur, la prise en compte conjointe de ces deux logiques, le souci de rester un créateur culturel tout en assurant les fins de mois de son personnel mais aussi la juste rémunération de ses auteurs (sans lesquels il ne serait rien), de ses fournisseurs et de ses actionnaires (sans lesquels il ne pourrait exister), implique la mise en oeuvre de deux règles essentielles.
La première, sur le court terme, est la péréquation entre titres « difficiles » et titres de fortes ventes (les seconds finançant les premiers) : cette contrainte est sévère, mais elle préserve la liberté de choix de l'éditeur. (Dans le cadre d'un financement public, cette contrainte disparaît, mais la liberté de choix de l'éditeur-fonctionnaire ne peut à terme qu'être réduite à néant, car la logique de celui qui le finance est nécessairement politique et s'applique donc d'abord au contenu des livres.)
La seconde, complémentaire de la première, s'inscrit dans le long terme : il est essentiel de construire une « politique d'auteurs D'abord, bien sûr, parce que c'est la vocation même du métier d'éditeur, ce qui caractérise avant tout sa dimension créatrice. Mais aussi parce que cela lui permet d'assurer sa pérennité et celle de son catalogue : l'auteur « difficile d'aujourd'hui pourra devenir un auteur à succès dans dix, vingt ou trente ans (comme le montre de façon exemplaire le travail des éditions de Minuit depuis plus d'un demi-siècle : les ouvrages de Duras ou de Beckett n'ont eu qu'un écho confidentiel au début, avant de devenir des best-sellers bien des années plus tard). Dans cette perspective, dès lors qu'ils s'inscrivent dans le long terme, les impératifs de la rentabilité ne sont pas contradictoires avec ceux de la création.
Le modèle européen et le « contre-modèle » américain
Ces règles ont permis depuis des décennies le fonctionnement globalement efficace (du point de vue tant créatif qu'économique) de l'édition dans les pays développés. Restent-elles encore réalistes et praticables aujourd'hui, à l'heure où la mondialisation et la concentration n'épargnent pas ce secteur ? Si l'on en juge à la seule aune du « modèle américain », la réponse est clairement non, comme l'a brillamment montré André Schiffrin, directeur de The New Press à New York (après avoir longtemps été celui de Pantheon Books).
Dans son livre récemment publié en France L'Édition sans éditeur (1) , il souligne la concentration de la production éditoriale américaine sur les titres de forte vente au détriment des autres (et donc des ouvrages de création) : alors que la population américaine est quatre fois et demie plus importante que celle de la France, on ne produit aux États-Unis que trois fois plus de nouveaux titres qu'en France (70 000 par an, contre 24 000) ; et les ventes globales y sont huit fois plus importantes (2 500 millions de volumes vendus chaque année, contre 320 millions en France). Même si l'on pondère ces chiffres en tenant compte de l'importance du marché anglophone au-delà des seuls États-Unis, ils sont révélateurs : comme l'illustre l'expérience personnelle d'André Schiffrin, les patrons des grands groupes d'édition américains (qui sont en fait des groupes d'édition multimédias) sont obsédés par la recherche de la rentabilité maximum à court terme. Au nom de cette logique, ils éliminent impitoyablement les titres dont le « potentiel économique est jugé insuffisant (c'est-à-dire inférieur à 20 000 ventes) et... les éditeurs qui continuent à travailler dans le long terme.
Ce « modèle -là, où les patrons d'édition se vantent de ne jamais lire un livre, ne risque-t-il pas de triompher en France ? La question peut se poser quand on constate que la concentration éditoriale y est encore plus forte qu'aux États-Unis (où cinq groupes assurent 80 % du chiffre d'affaires de la profession, alors qu'en France deux groupes seulement représentent plus de la moitié de l'activité).
On ne peut bien sûr exclure complètement cette hypothèse, mais elle me semble très improbable, pour plusieurs raisons. D'abord, ce modèle économique pour le livre est loin d'être si efficace, comme le montre d'ailleurs l'exemple américain : la course folle aux à-valoir pour attirer les auteurs les plus « rentables » se traduit souvent par des pertes considérables en cas d'échec ; et l'obsession du profit à court terme finit par tuer les perspectives de profit à long terme, faute d'une véritable politique d'auteurs. Ensuite, les exemples européens (France, Italie et Alle-magne notamment) montrent que la dynamique de la création éditoriale, dans les grands groupes comme dans les petites structures, peut être préservée, pour autant que certaines conditions soient remplies :
Évolutions du marché et menaces sur la création
Ces conditions sont globalement remplies en Europe aujourd'hui, mais l'avenir de la création n'est pas assuré pour autant. Car les risques de rupture ont été aggravés depuis vingt ans par les évolutions spécifiques du marché du livre. Comme l'ont montré les enquêtes sur les « pratiques culturelles » du ministère de la Culture, on observe en effet une baisse très préoccupante du nombre des «forts lecteurs » (ceux qui lisent plus de vingt-cinq livres par an) : leur part dans la population française de plus de quinze ans est passée de 22 % en 1973 à... 14 % en 1995. (Certes, dans le même temps, la part des « faibles lecteurs », qui lisent moins de neuf livres par an, est passée de 24 à 33 %, et celle des « non-lecteurs » est passée de 30 à 25 % : ces évolutions indéniablement positives ont permis un développement important des ventes des clubs de livres et des emprunts en bibliothèque.)
On connaît à peu près les raisons de cette évolution (concurrence des nouveaux médias, affaiblissement du statut culturel du livre, etc (2) ), et je voudrais surtout insister sur ses conséquences les plus importantes pour la création éditoriale :
Pour un grand « lobby du livre »
Ces évolutions sont en effet inquiétantes, d'autant que se profile à l'horizon une nouvelle phase de perturbation importante liée au développement du numérique et de l'Internet. Pour autant, je reste convaincu que le pire n'est pas sûr. Et que, sous certaines conditions, la double nature » du livre nous offre de bien meilleures armes pour résister au déclin de la création éditoriale que la solution de facilité qui serait de la placer sous la tutelle de l'État. Certes, le règne absolu de la logique marchande ne peut être que mortifère, comme le montre l'exemple américain : le marché doit être régulé, et c'est à cela que doit se limiter le rôle de l'État, en particulier en confortant la législation sur le droit d'auteur et sur le prix unique du livre (qui n'existe pas, rappelons-le, aux États-Unis).
Si ces conditions sont remplies, tout n'est pas gagné pour autant : tout dépendra de la capacité des acteurs de la chaîne du livre à oeuvrer de concert pour procéder aux nécessaires adaptations de leurs pratiques afin de préserver la liberté de création. Il leur faut résister aux tentations de courber l'échine face à la contraction du marché ou aux contraintes nouvelles qui pèsent sur les missions de service public des bibliothèques, et de s'en prendre les uns aux autres dans le souci compréhensible de maintenir leurs places respectives (auteurs contre éditeurs, éditeurs contre libraires, éditeurs et libraires contre bibliothécaires, etc.). Ils doivent au contraire nouer de véritables collaborations - ce qu'ils ont trop peu fait dans le passé -, mieux connaître leurs spécificités respectives afin d'en finir avec les représentations réductrices, et engager ensemble les actions de modernisation indispensables au renouveau du livre (y compris sous ses nouvelles formes « virtuelles » : il ne s'agit pas d'un combat d'arrière-garde !).
Je ne suis pas naïf - je crois l'avoir montré - au point d'ignorer la force des pressions qui s'exercent de toutes parts pour faire du livre une marchandise « comme les autres », pour réduire l'accès à la lecture et à l'information à de purs services marchands. Contre tout cela, il importe de résister. Mais pas n'importe comment, pas chacun pour soi. Et c'est pour cela que je plaide pour la constitution d'un efficace « lobby du livre ». Non pas au sens corporatiste, comme certains pourraient l'entendre. Mais au sens de tous ceux, quelle que soit leur profession, qui partagent le même attachement à la puissance culturelle et citoyenne de l'écrit et de la lecture.
Dans cette perspective, j'observe qu'il existe des « contre-tendances convergentes. Ainsi les auteurs de la Société des gens de lettres viennent-ils de procéder à un aggiornamento pour mieux répondre aux défis de l'écrit numérique. Ainsi les éditeurs du Syndicat national de l'édition, des microstructures aux grands groupes, sont-ils unanimes dans la défense du prix unique. Ainsi les libraires indépendants ont-ils enfin uni leurs forces pour constituer un nouveau « Syndicat de la librairie française attaché à ces valeurs. Ainsi l'Association des bibliothécaires français n'hésite-t-elle pas, à l'occasion de ce congrès, à prendre à bras-le-corps les problèmes que lui posent les contradictions entre « politique de service public et économie marchande ». Ce sont tous ces efforts qu'il faudrait aujourd'hui unir pour préserver les forces (et combattre les faiblesses) de la « double nature » du livre.
2. Voir Fabrice Piault : Le Livre, la fin d'un règne, Paris, Stock, 1995. retour au texte
3. Rappelons que la baisse des tirages initiaux entraîne, du fait de l'importance des frais fixes, une augmentation mécanique du coût unitaire d'un livre (et donc de son prix de vente). Depuis vingt ans, l'introduction de nouvelles techniques très performantes (PAO, presses Cameron, offset CTP...) a permis de limiter considérablement la hausse du prix du livre. retour au texte